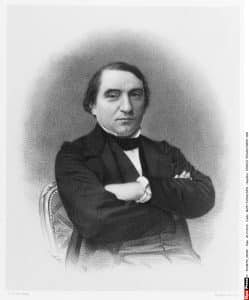La politique taïwanaise et la trêve entre Trump et Xi signifient que les risques pesant sur l’île seront suspendus pendant quelques années.
Tom Miller, analyste chez Gavekal
Un sujet a été remarquablement absent de la rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping : Taïwan. Avant le sommet en Corée du Sud, de nombreuses spéculations laissaient entendre que Trump allait affaiblir le soutien des États-Unis à l’île en échange d’un accord commercial favorable. Mais Taïwan n’a apparemment même pas été mentionné. Cela semble logique : étant donné que les États-Unis et la Chine ont tous deux un intérêt majeur à conclure une trêve, aucun des deux pays ne souhaitera déstabiliser le détroit de Taïwan dans les mois à venir.
À plus long terme, rien ne presse la Chine à contraindre Taïwan à se réunifier. Il n’y a certainement aucune preuve d’un « calendrier » d’invasion, même si la date butoir de 2027 que Xi aurait fixée pour que l’armée chinoise soit en mesure d’envahir Taïwan est exacte. Capacité ne signifie pas intention. Quoi qu’il en soit, la purge en cours menée par Xi Jinping à l’encontre des hauts responsables de l’Armée populaire de libération ne laisse guère penser que la Chine se prépare à la guerre. De plus, la situation politique interne à Taïwan donne à Pékin des raisons de rester en retrait et d’attendre le résultat de la prochaine élection présidentielle en janvier 2028.
À lire également
L’opposition taïwanaise élit un nouveau dirigeant qui souhaite la paix avec la Chine
Le retour de l’ambiguïté stratégique
L’inquiétude quant à l’avenir de Taïwan s’est accentuée sous Trump, qui ne considère pas sa sécurité comme une priorité politique. Il lui a imposé des droits de douane de 20 %, supérieurs à ceux imposés au Japon et à la Corée du Sud, alimentant les doutes quant à la durabilité du « bouclier de silicium » de Taïwan, c’est-à-dire l’hypothèse selon laquelle sa domination dans la fabrication de semi-conducteurs la protégera des attaques. Certains craignent que les États-Unis ne cherchent plutôt à vider l’industrie taïwanaise des puces électroniques avant d’abandonner définitivement l’île.
Bras-de-fer chinois
Ce que Trump a principalement fait, c’est ramener la politique américaine à la ligne traditionnelle de l’ambiguïté stratégique. Dans une interview accordée à 60 Minutes après sa rencontre avec Xi, il a refusé de dire si les États-Unis défendraient Taïwan. « Il le saura si cela se produit », a-t-il déclaré. Biden, en revanche, s’est engagé à quatre reprises à venir en aide militaire à Taïwan en cas d’attaque chinoise. Trump s’attache à faire pression sur Taïwan pour qu’elle s’engage à dépenser des sommes importantes, conformément à sa politique consistant à exiger des alliés qu’ils paient pour la protection américaine. Le gouvernement du président William Lai Ching-te s’est engagé à augmenter ses achats d’armes américaines dans le but de négocier une baisse des droits de douane.
À lire également
États-Unis / Taïwan : vers la fin de l’ambiguïté stratégique ?

Le président taïwanais, Lai Ching-te, pose pour une photo avec des tankistes. 31 octobre 2025. (C) SIPA
L’APL ne semble pas prête au combat
Malgré les provocations de la Chine dans le détroit de Taiwan, il y a peu de chances qu’elle passe rapidement à l’action pour accélérer le processus d’unification, que ce soit par une intervention militaire ou, plus probablement, par diverses formes de coercition économique. D’une part, la répression menée par Xi contre les dirigeants de l’APL signifie que celle-ci n’est pas en mesure de gérer un conflit. He Weidong, deuxième général le plus haut gradé de Chine et membre du Politburo, et l’amiral Miao Hua, ancien officier politique supérieur de l’armée, sont les derniers hauts responsables militaires à avoir été visés par une campagne anti-corruption. Sept autres ont également été récemment expulsés pour faute grave, selon une annonce faite par le ministère chinois de la Défense le 18 octobre.
Il est également peu probable que Pékin se laisse intimider par un renforcement important de l’armée taïwanaise. Lai affirme qu’il augmentera les dépenses de défense au-delà de 3 % du PIB en 2026, et à 5 % d’ici 2030. Il parle de construire un « T-Dome » pour la défense aérienne, sur le modèle du Dôme de fer israélien. Son problème est que le pouvoir législatif taïwanais reste effectivement contrôlé par l’opposition du Kuomintang, qui favorise de meilleures relations avec la Chine et considère les dépenses militaires incontrôlées comme un gaspillage d’argent.
La tâche de Lai vient de se compliquer. Le 18 octobre, le KMT a élu une dirigeante relativement jeune qui critique vivement l’augmentation des dépenses de défense. Cheng Li-wun affirme que l’objectif de 5 % fixé par Lai transformera Taïwan en « distributeur automatique de billets pour les États-Unis » et alimentera une « course aux armements ». Souvent qualifiée de « provocatrice », Cheng souhaite transformer son vieux parti conservateur et séduire les jeunes électeurs. Elle est également considérée comme plus proche de Pékin que ses prédécesseurs, déclarant : « Je suis chinoise ». Après sa victoire, Cheng a reçu un message de félicitations de Xi. Le Parti démocratique progressiste au pouvoir a accusé Pékin de s’être ingéré dans l’élection en sa faveur.
Étreignez, ne vous battez pas
Être leader ne signifie pas que Cheng est assurée d’être la candidate du KMT à la présidence en 2028, même si elle a de bonnes chances d’être dans la course. Son premier test sera les élections locales de 2026 : les électeurs se révolteront s’ils la considèrent comme trop pro-chinoise. Mais toutes choses égales par ailleurs, le KMT a de bonnes chances de remplacer le DPP lors des élections de 2028, surtout s’il se présente en coalition avec le Parti populaire taïwanais, de plus en plus populaire, avec lequel il est actuellement allié au parlement. Le gouvernement de Lai est extrêmement impopulaire ; le DPP a également remporté trois élections consécutives, ce qui signifie que l’anti-incumbency jouera un rôle.
Pour Pékin, il n’est pas logique d’intensifier ses agressions contre Taïwan avant les élections de 2028, étant donné la possibilité que celles-ci aboutissent à la formation d’un gouvernement plus favorable à ses intérêts. Cheng Li-wun et le KMT ont également plus de chances de remporter les élections si Pékin se retire de la politique intérieure et met fin à ses intimidations envers Taïwan, qui ne font que renforcer le soutien au DPP. Mieux vaut prendre du recul, attendre et se rapprocher de Taïwan.