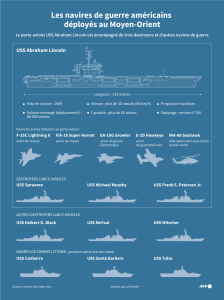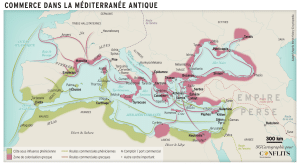Le retrait des États-Unis de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques marque, selon Samuel Furfari, une rupture stratégique majeure dans l’histoire de la gouvernance climatique mondiale. En revenant sur les fondements juridiques, diplomatiques et politiques de cette décision, l’auteur analyse un basculement durable de la position américaine et interroge les conséquences pour l’Union européenne, désormais confrontée au risque d’un isolement stratégique dans la lutte contre le changement climatique.
Le 7 janvier, le président Donald Trump a signé un décret retirant les États-Unis de 66 organisations internationales jugées « redondantes, mal gérées, inutiles, coûteuses ou inefficaces », ou considérées comme des instruments des adversaires américains. Parmi elles figurent diverses agences des Nations unies, dont le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), mais surtout la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), qui constitue l’épine dorsale de la gouvernance climatique mondiale. Cette décision implique donc également un retrait durable de l’Accord de Paris, puisque l’adhésion à cet accord est légalement liée à la participation à la CCNUCC.
Lors de son premier mandat, le président Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris en utilisant la clause de retrait prévue dans le texte. Mais en 2021, le président suivant, Joe Biden, a rapidement ramené les États-Unis dans l’accord, en faisant un geste central de sa diplomatie climatique. Cet épisode a mis en lumière la fragilité de la politique climatique internationale : un simple changement d’administration pourrait en effet faire sortir les États-Unis de l’accord, transformant les engagements climatiques mondiaux en de simples extensions de la politique partisane intérieure.
Cette fois, cependant, ce changement est plus pérenne. En ciblant la CCNUCC elle-même, l’administration Trump a démantelé le cadre juridique qui permettait d’annuler une politique par un simple décret exécutif.
Le fondement juridique des renversements de politique climatique américaine
La question centrale est la relation entre l’Accord de Paris et la CCNUCC. Adopté légalement en vertu de la convention de 1992, l’accord de Paris s’appuie sur l’architecture institutionnelle de la CCNUCC, dont les organes apportent le soutien nécessaire. Cela inclut la Conférence des parties (COP), le secrétariat, ainsi qu’un système d’objectifs et de contributions financières déterminés au niveau national.
Le paragraphe 3 de l’article 28 de l’Accord de Paris est rédigé comme suit : « Toute Partie qui se retire de la Convention sera considérée comme ayant également retiré de cet Accord. » En quittant la Convention-cadre, Washington rompt le lien qui avait permis à Biden de réintégrer l’Accord de Paris. Le retrait de Trump est structurel, et non tactique.
Le précédent historique clé qui rend cette décision très difficile à contester est l’affaire Goldwater c. Carter. En 1979, le président Jimmy Carter a unilatéralement décidé de mettre fin au traité de défense mutuelle avec Taïwan afin d’établir des relations diplomatiques complètes avec la République populaire de Chine. Le sénateur républicain Barry Goldwater et d’autres législateurs ont contesté cette mesure, arguant qu’un traité ratifié avec le consentement des deux tiers du Sénat ne pouvait pas être résilié par un simple acte présidentiel. L’affaire est parvenue devant la Cour suprême, qui a refusé de statuer sur le fond, estimant qu’il s’agissait d’une « question politique » non justiciable, c’est-à-dire d’une question relevant du processus politique plutôt que du contrôle judiciaire. Ce refus de décider a créé un précédent particulièrement favorable à l’exécutif, ce qui a des conséquences sur le long terme.
En pratique, un président peut donc se retirer d’un traité sans qu’il existe de voie judiciaire claire pour l’en empêcher. L’administration Trump est donc dans une position juridiquement confortable. Les opposants n’ont aucun levier pour annuler cette décision. Il serait également politiquement risqué pour les démocrates de demander une nouvelle décision de la Cour suprême, car cela risquerait d’établir un pouvoir exécutif supplémentaire sur la résiliation du traité.
Les démocrates paient aujourd’hui le prix d’avoir conçu l’accord de Paris en 2015 afin d’éviter une ratification par le Sénat. Sachant qu’ils ne disposaient pas de la majorité des deux tiers au Sénat nécessaire pour ratifier un traité climatique contraignant, l’administration Obama a insisté pour que les contributions soient volontaires et non contraignantes. C’est l’épisode célèbre « shall » versus « should », lorsque John Kerry a personnellement refusé le mot « shall » dans le texte final (il y a 141 fois le mot « should », qui n’implique aucune contrainte, et 41 fois le mot « shall », qui détermine des obligations, mais celles-ci sont toutes de nature bureaucratique. Voir ma leçon à l’académie royale de Belgique).
Lors des négociations de l’Accord de Paris, les négociateurs américains ont clairement signifié au commissaire européen en charge du climat et de l’énergie, Miguel Arias Cañete, que leur « ligne rouge » était l’absence d’objectifs contraignants, afin d’éviter de passer par le Sénat et le risque d’un rejet nécessitant une majorité des deux tiers. Le résultat est que l’Accord de Paris n’est pas un protocole, contrairement au Protocole de Kyoto. Ce dernier n’a jamais été soumis au Sénat, ni par Clinton (démocrate) ni par Bush (républicain), notamment parce qu’avant la conférence de Kyoto, le Sénat avait adopté à l’unanimité la résolution Byrd-Hagel. Cette résolution exigeait que les pays développés ne soient pas les seuls à se voir imposer des mesures de réduction des émissions. Une telle condition aurait rendu impossible tout protocole de Kyoto, ce qui explique que les États-Unis ― y compris l’administration Démocrate ― ne l’aient jamais ratifié. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, Obama a veillé à ce que l’Accord de Paris reste un simple accord, qui ne nécessitait pas l’approbation du Sénat.
La fenêtre de fermeture pour le réengagement climatique des États-Unis
L’administration Trump a pleinement tiré les leçons de cette expérience. Durant son premier mandat, il ne s’est retiré que de l’Accord de Paris, laissant la CCNUCC intacte, ce qui a permis à son successeur de réintégrer facilement l’accord. Cette fois, l’action de Trump est bien plus radicale. En ciblant la Convention-cadre elle-même, il prive les futurs présidents d’échanges diplomatiques commodes. Politiquement, le message est clair : Washington considère la diplomatie climatique comme un instrument de contrainte extérieure bénéfique pour les concurrents stratégiques américains, un fardeau coûteux pour la compétitivité industrielle américaine. Les États-Unis quittent donc définitivement, du moins pour cette génération, la gouvernance climatique.
Pouvons-nous imaginer un renversement de la situation ? Formellement, les États-Unis pourraient réintégrer la CCNUCC, mais politiquement, cela nécessiterait désormais un niveau de consensus qui n’existe plus. Adoptée en 1992 avec la naïve croyance en une transition énergétique indolore, la Convention est aujourd’hui confrontée à des réalités économiques et géopolitiques qui révèlent les illusions antérieures et rendent peu probable une renaissance à court terme. Trente ans plus tard, les conséquences dramatiques de la gouvernance climatique rendent peu probable qu’une majorité des deux tiers puisse être trouvée pour relancer le climatisme. C’est terminé, car il n’y aura plus de majorité significative de sénateurs prêts à sacrifier l’économie de leur pays pour des utopies climatiques. La grande majorité des politiciens ont compris que les émissions mondiales avaient augmenté de 66 % depuis que l’on affirme qu’elles seront réduites grâce à la CCNUCC. C’est donc terminé. Une bonne fois pour toutes.
Que sont censés faire aujourd’hui les croyants climatiques de l’UE ? Une question rarement exprimée publiquement à Bruxelles, à Strasbourg, Paris ou Berlin, et parfois timidement à Rome : combien de temps l’Union européenne perdurera-t-elle dans une stratégie climatique qui ne lie plus de manière significative ni les États-Unis ni les nations émergentes, pour ces dernières, au-delà de déclarations bienveillantes ?
L’UE continue de se fixer des objectifs toujours plus ambitieux (réduction de 90 % des émissions de CO₂ d’ici 2040 par rapport à 1990), tout en érodant sa base industrielle, en approfondissant sa dépendance à l’égard de la Chine et en creusant l’écart entre la rhétorique et la réalité des émissions mondiales. Avec une indignation rituelle, Trump a fait comprendre aux dirigeants européens qu’ils devaient tirer les leçons de ce tournant : si la principale puissance économique et militaire mondiale conclut qu’elle n’a plus aucun intérêt à rester prisonnière de l’architecture climatique dirigée par l’ONU, alors il est temps que l’Union réévalue ses propres engagements avec lucidité.
La mauvaise réponse laisserait l’UE découvrir trop tard qu’elle a sacrifié sa prospérité et son autonomie stratégique au profit d’une folie climatique abandonnée par ses alliés les plus proches, les États-Unis, ainsi que par les grandes puissances émergentes qui, loin de suivre le même chemin, continuent d’accroître leurs émissions et de défendre farouchement leur souveraineté. Cet isolement place l’UE face à un défi géopolitique majeur, l’affaiblissant dans le conflit mondial pour la prospérité.
Une version plus courte a été publiée dans National Review
Dernier livre de Samuel Furfari :
La vérité sur les COP. Trente ans d’illusions.
Éditions L’Artilleur