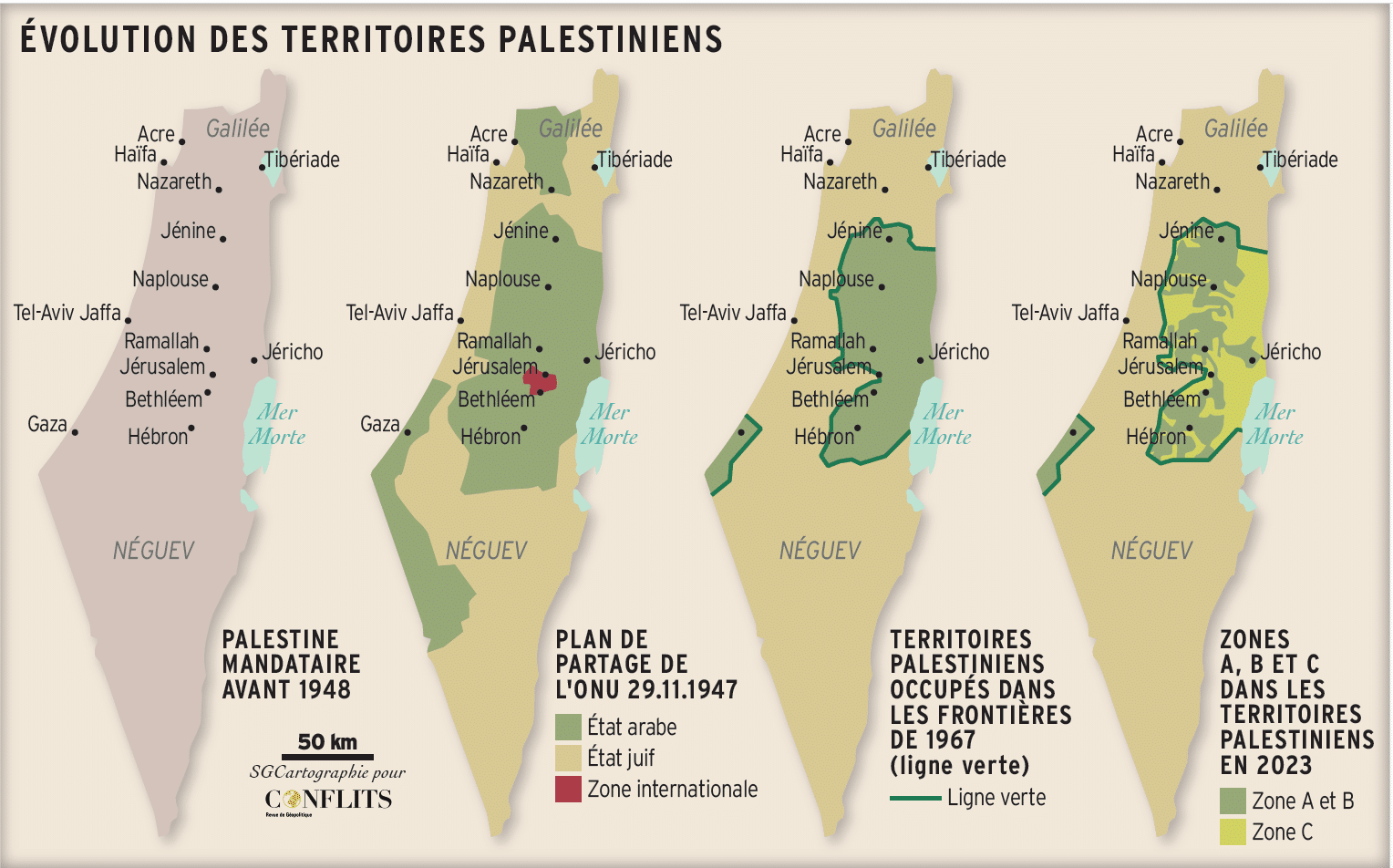Au cours des trente dernières années, l’espace géographique du Moyen-Orient n’a cessé de croître, allant désormais du Maroc à l’Afghanistan. Cette croissance accompagne l’extension du djihadisme et de l’islamisme, noyant dans un tout général la problématique du conflit en Palestine.
Historien, sociologue à l’EHESS, Hamit Bozarslan a notamment publié aux éditions du CNRS L’anti-démocratie au xxie siècle. Iran, Russie, Turquie (2021), Le temps des monstres. Le monde arabe, 2011-2021 (2022), Crise, violence, dé-civilisation (2019) et Histoire de la violence au Moyen-Orient, La Découverte, 2008.
Propos recueillis par Tigrane Yegavian, membre du comité de rédaction de Conflits.
Avec le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, la violence a franchi un nouveau seuil dans le conflit israélo-palestinien. La barbarie l’emporte sur toute considération d’ordre éthique et morale. Peut-on parler d’une dimension ontologique dans le cas du conflit israélo-palestinien ?
Il y a bien entendu un arrière-fond historique qu’il faut prendre en considération, mais ce dernier n’explique pas nécessairement tout. Il n’explique surtout pas l’attaque du 7 octobre qui a visé essentiellement des civils et qui a fait fi de toute considération éthique au nom de la résistance ou d’une idée de la résistance consistant à supprimer l’éthique. On voit très clairement une contradiction entre les engagements qu’on peut avoir et qu’on doit chercher dans un mouvement de résistance et un cynisme parfait qui a pu être mobilisé. De l’autre côté, on voit la réaction israélienne qui consiste à détruire l’espace et le temps palestinien.
Il faut aussi avoir à l’esprit que depuis une dizaine d’années on assiste à une brutalité sans nul équivalent, qui est cautionnée d’une manière ou d’une autre par la communauté internationale comme quelque chose qui va de soi. Prenez le cas de la ville d’Afrin dans le nord-ouest de la Syrie. Elle a été occupée par la Turquie au bout de soixante-douze jours de bombardements avec la complicité de la Russie. Cette ville a été transformée en un djihadistan. 90 % de la population qui était kurde se trouve aujourd’hui déplacée. Toujours en Syrie, la destruction de la Ghouta orientale en 2013, dans la banlieue de Damas. La brutalité dans le cas du conflit ukrainien est elle aussi minorée. De même, le nettoyage du Haut-Karabagh : 120 000 personnes chassées en quarante-huit heures dans l’indifférence générale.
A lire aussi
» Le Hamas n’admet pas la présence d’Israël ». Entretien avec Ayman Chanaa
Nietzsche utilisait une allégorie très précieuse : « Le désert grandit : malheur à celui qui recèle des déserts[1] ! » Au-delà d’un vide ontologique, ce concept renvoie de nos jours à un nouveau processus de dé-civilisation. La civilisation est avant toute autre chose la capacité à disposer des repères de confiance dans le temps et dans l’espace. Ces repères sont aujourd’hui délibérément et systématiquement détruits dans une indifférence relativement générale. On observe aussi une biologisation des conflits. Prenez le cas de la perception turco-azérie vis-à-vis des Arméniens et des Kurdes, perçus comme une menace biologique et organique, idem pour les Ukrainiens considérés comme nazis potentiels par leur essence même. Cette biologisation extrême, qui n’est pas un phénomène inédit dans l’histoire, mais qu’on observe de nouveau depuis une dizaine d’années, est extrêmement inquiétante.
Faut-il également prendre en compte le facteur démographique dans ce processus de décivilisation ?
La donne démographique intervient non pas comme un facteur explicatif, mais comme un facteur inscrit dans la très longue durée, qui va produire des générations extrêmement mélancoliques et malheureuses. C’est le cas de Gaza, mais aussi de la Syrie. Les adolescents syriens qui ont grandi avec le conflit à partir de 2011 n’ont connu qu’une socialisation militarisée et de destruction. Des classes d’âges de 13-15 ans sont entrées dans la vie dans un contexte de violence sans pouvoir disposer d’une manière ou d’une autre d’un horizon, d’une perspective si ce n’est de quitter le pays au risque de leur vie s’ils traversent la Méditerranée. En Syrie, sur une population de moins de 23 millions d’habitants en 2011, on compte à présent 7 millions de réfugiés et 6 à 7 millions de déplacés internes. Une deuxième génération va se radicaliser davantage pour ressembler à ce qui existe déjà en Haïti, en Amérique centrale avec les cartels, en Somalie, etc., pour laquelle l’éthique ne compte pas. Cette violence de survie, qui n’est pas forcément politisée, va se muer en une violence pour le pouvoir pour une très courte durée.
Je ne pense pas davantage que la démographie constitue en amont le facteur explicatif dans le cas palestinien. Depuis quelque temps, on observe que les tendances démographiques des Palestiniens sont à la baisse. Idem en Ukraine et en Russie, où la natalité est déclinante dans les deux pays. Nous ne sommes pas dans un monde malthusien, mais nous produisons des générations totalement perdues et historiquement condamnées.
Si le conflit israélo-palestinien était historiquement resté cantonné au périmètre d’Israël et de la Palestine, sans doute aurait-il trouvé une solution beaucoup plus facilement.
Vous citez souvent la phrase de Gramsci à propos de la période que nous traversons, cette période de transition entre l’ancien monde achevé et le nouveau monde qui tarde à émerger. Dans quelle mesure sommes-nous dans « le temps des monstres » ?
J’ai du mal à utiliser le terme de phase transitoire parce que je ne vois pas encore de lumière au fond du tunnel. Ce qui m’inquiète énormément, c’est que cette situation continue, en se transfigurant constamment, depuis 1979. Dans un Bilan stratégique que j’avais rédigé pour la revue Moyen-Orient, j’avais utilisé le terme d’une guerre de quarante ans : la révolution iranienne et la guerre Iran-Irak, l’occupation de l’Afghanistan et la guerre, l’intensification de la guerre civile libanaise. Alors que se mettait en place une transhumance djihadiste à l’échelle du monde musulman voire au-delà, les frontières interétatiques devenaient le lieu de production d’une violence massive et la distinction entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques disparaissait. La transformation des États en milices coexiste avec d’autres milices, la dissolution des sociétés dans certains cas au sens propre du terme comme c’est le cas en Syrie, résultent d’un processus de longue durée. On assiste aussi à une transformation de l’espace : il y a cinquante ans, personne n’aurait inclus l’Afghanistan dans le Moyen-Orient ou pensé le djihadisme en partant du Maghreb, du Mali ou encore du Niger. Il s’est produit un élargissement spectaculaire du Moyen-Orient à partir des dynamiques locales propres parfois microscopiques et des dynamiques de longue durée à l’échelle macro, qui interagissent et produisent l’islamisme sous sa forme djihadiste, ou la confessionnalisation. Il en va de même de la pratique de la contestation qui peut faire fi de toute éthique. Parfois, les États ne s’estiment plus tenus à aucun critère en termes de droits humains ou de droits internationaux. Nous avons le cas de la Turquie qui, par exemple, considère que la souveraineté turque ne peut pas se limiter à l’espace westphalien, que la souveraineté de la turcité l’emporte sur celle de la République de Turquie. Les interventions turques à Chypre, en Irak et au Kurdistan syrien, dans le Caucase et peut-être dans les Balkans demain se justifient par cette redéfinition de la souveraineté.
Si le conflit israélo-palestinien était historiquement resté cantonné au périmètre d’Israël et de la Palestine, sans doute aurait-il trouvé une solution beaucoup plus facilement. Or, il s’inscrit dans un cadre bien plus large, où l’Irak, la Syrie, l’Iran et la Turquie aujourd’hui endossaient ou endossent le rôle de héraut de la cause palestinienne et s’en servent comme un pion géostratégique, quitte à l’abandonner finalement si nécessaire demain.
Vous interrogez longuement la rationalité des individus, ceux qui sont à la tête du Hamas, ceux qui sont au pouvoir en Israël, ceux qui sont au pouvoir en Iran. Tous ces acteurs-là sont-ils vraiment rationnels ? Peut-on parler d’une dimension eschatologique, millénariste ?
Le temps se décline de multiples manières, il peut être millénariste ou eschatologique, se fixant une finalité qui ne peut pas se réaliser dans un cadre terrestre, comme l’arrivée ou la deuxième arrivée du Messie annonçant l’avènement de la Jérusalem céleste, restauration de l’âge du bonheur prophétique ou le retour du 12e imam. Pour les évangéliques sionistes chrétiens des États-Unis, l’avènement de Jérusalem ne se ferait pas sans le retour des juifs dans la Jérusalem terrestre. De l’autre côté, on voit aussi que ce temps très long peut échapper finalement à tout ce qu’on peut mesurer dans un cadre terrestre, peut être réduit à une durée extrêmement courte comme l’illustre l’attaque du Hamas du 7 octobre. Le Hamas a sans doute pensé qu’il allait pouvoir, en l’espace de soixante-douze heures, bouleverser l’histoire palestinienne, l’histoire israélienne, l’histoire du Moyen-Orient. S’est-il posé la question de ce qui allait se passer après ces soixante-douze heures ? On peut se demander si l’on n’est pas dans la destruction pure et simple de la rationalité terrestre.
A lire aussi
Détroit de Bab el-Mandeb : le commerce mondial va-t-il s’arrêter ?
Les philosophes de l’entre-deux-guerres se sont interrogés sur cette notion de destruction de rationalité, tout comme sur la fonction de la nouvelle mythologie. Alphonse Dupront (1905-1990) disait que la vraie révolution du xxe siècle c’était la révolution mythologique : le mythe aryen, le mythe du IIIe Reich, le mythe de la délivrance du genre humain sur terre, etc. Tous étaient des mythes, voire pensés à la fois comme des mythes et comme des objectifs ultimes à réaliser, et disposaient d’une force d’action invraisemblable.
Les philosophes de l’entre-deux-guerres se sont interrogés sur cette notion de destruction de rationalité, tout comme sur la fonction de la nouvelle mythologie.
Vous êtes très attachés aussi aux dates, aux symboles de l’affirmation de la souveraineté politique turque. Nous sommes dans le 100e anniversaire de la République de Turquie, un État érigé sur les décombres de l’extermination des Arméniens et des Assyro-Chaldéens. Vous parlez de la Turquie comme d’un État paramilitaire, d’un cartel…
Il y a un rapport entre la cartellisation et la paramilitarisation de l’État et la notion de la souveraineté comme étant celle de la turcité. Si la souveraineté est celle de la turcité, il devient normal que ce soit, non pas l’État comme institutionnalité supra sociale, mais des acteurs qui estiment l’incarner, qui l’exercent directement. Ils portent la « cause turque » « sur leurs épaules » et se définissent comme l’incarnation de la mission historique de la turcité. On le voit très bien en 1915 pendant le génocide des Arméniens où l’État ottoman avait cédé la place à un cartel chargé de la mission sacrée de sauver l’empire, voire d’en créer un autre, pantouranien. Aujourd’hui, nous faisons face à une situation relativement analogue. L’État turc n’a rien en commun avec la légalité et la rationalité wébériennes. Les unités spéciales de la police, de la gendarmerie, les forces paramilitaires au sein de la société ne relèvent pas d’une rationalité d’État, ce sont des forces parfaitement idéologiques, nationalistes. Elles incarnent et exercent la turcité là où elle doit intervenir en Syrie, en Irak, en Libye, dans le Karabagh…
L’État turc, dans sa vision visible, détruit systématiquement sa propre rationalité pour assurer sa propre survie. Il suffit de voir la conduite de son économie, de sa politique étrangère. Il y a douze ans, c’était la Russie qui était l’ennemi, aujourd’hui, elle est l’ami. Il y a dix ans, la Turquie était pratiquement en guerre avec l’Égypte et avec Israël et en froid avec l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, le régime d’Erdogan veut se rapprocher de ces pays. Mais il n’est pas tenu à justifier ces volte-face. Et bien sûr, il ne s’agit pas uniquement d’un phénomène d’hommes unique. Le cartel au pouvoir en Turquie fédère des forces qui lui sont radicales comme la droite radicale, le Hizbullah kurde.
Peut-on parler d’opportunisme ou est-ce une idéologie ?
C’est un bloc. Un bloc qui peut se retrouver autour de dénominateurs communs : le nationalisme extrême, la fusion entre la nation et la confession ou plutôt l’idée que la nation turque a une mission à accomplir, que celle-ci ne peut être uniquement territorialisée et étatisée. Aux yeux de l’erdoganisme, mais aussi de la droite radicale turque, la nation turque constitue une entité organique, presque biologique. Elle dispose d’une ontologie pure, mais qui est menacée par d’autres ontologies. Tout cela permet à plusieurs acteurs de se retrouver autour de ces dénominateurs communs et de se rallier, en tout cas pour le moment.
Quid des vases communicants entre la question kurde et la question palestinienne ? Y a-t-il une fluidité entre ces deux conflits ?
La comparaison de ces deux causes est partiellement pertinente. Nous sommes en présence de deux causes parfaitement légitimes. La question kurde est de nature transfrontalière, la question palestinienne est supra territoriale par la force des choses. Dans les années 1970-1980, les deux mouvements évoluent pratiquement de manière parallèle, avec les mêmes aspirations. Beaucoup de Kurdes ont pris part au mouvement palestinien au prix de leur vie. Les premiers « martyrs » du PKK ont été tués non par l’armée turque mais par l’armée israélienne, en 1982. Les Kurdes recevaient un entraînement au Liban, dans la plaine de la Bekaa, aux côtés des Palestiniens et des Arméniens. Jalal Talabani, devenu par la suite président de l’Irak, était très pro-palestinien. Mais il faut observer depuis une vingtaine d’années une différentiation de fait pour des raisons historiques multiples. Les Américains, mais aussi les Européens d’une manière générale, soutiennent, en partie du moins, la cause kurde notamment dans le contexte de la répression de Saddam Hussein, la mise en place d’une région autonome kurde dans le nord de l’Irak, puis la résistance kurde à Kobané contre l’État islamique.
A lire aussi
Podcast. Gaza : la guerre des images
De ce point de vue-là, on voit effectivement qu’il y a une différence entre les deux questions. Peut-être que demain les Américains et les Européens soutiendront un acteur palestinien, qui accepte la démocratie et rejette l’islamisme et qui soit accepté par la population palestinienne.
[1] Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 4e partie.