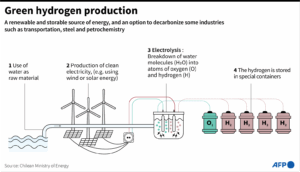On ne peut parler de l’Amérique latine sans parler du Brésil et pourtant, ce dernier n’est pas un pays latin mais une nation atlantique décrite pour la première fois par Pero Vaz de Caminha, l’écrivain du bord de Pedro Alvares Cabral, le « découvreur » du Brésil. Le 1er avril de l’an 1500, la flotte s’ancre dans une baie que les navigateurs prennent pour les abords d’une île si belle qu’ils pensent au paradis terrestre. « Ils ont la peau sombre, légèrement cuivrée », écrit Caminha dans une lettre à son roi, Manuel 1er, en lui décrivant les habitants du lieu, « bien faits, ils vont nus, sans aucune couverture, et il semble qu’ils vous montrent leurs parties intimes comme ils vous montreraient leurs visages. À ce sujet, ils sont d’une grande innocence ».
Pendant près de trente ans, une paisible relation commerciale s’installe entre indigènes et navigateurs, la plupart portugais et français. Ces nouveaux venus achètent du bois brésil – qui donne une belle teinture rouge appréciée par les dames des cours européennes – contre de la bimbeloterie. Ils n’ont rien de commun avec les conquistadores espagnols tels Cortes ou Pizarro venus piller or et argent du Mexique et du Pérou.
Le Portugal, pays peu peuplé, réalise quelque trente ans après sa « découverte » qu’il faut coloniser cette terre immense pour éviter qu’elle ne tombe entre les mains des Français. Le Brésil est alors divisé en capitaineries qui forment un fragile archipel de villages tout au long de la côte. Les premiers colons sont les « indésirables du royaume », des prisonniers graciés en échange de leur exil. Il s’agit là d’un moment tragique qui met fin à l’aimable commerce entre Européens et indigènes, lesquels considèrent les nouveaux venus non plus comme des commerçants, mais comme des envahisseurs.
A lire aussi: Brésil : du crime à l’espoir ?
Dans un livre remarquable, Racines du Brésil[1], Sergio Buarque de Holanda voit dans « l’esprit indolent » des Portugais, dans leur absence « d’orgueil de race », et leur « esprit d’aventure », les raisons de la singularité brésilienne. « Ce que le Portugais venait chercher, c’était évidemment la richesse, mais une richesse qui demande de l’audace, et non du travail. » Et c’est ainsi que le Brésil devient un extraordinaire importateur d’esclaves africains. Pendant trois siècles, entre trois et cinq millions d’Africains – les statistiques sont incertaines – traversent l’Atlantique. Ils travaillent dans les champs de cannes du Pernambouc, puis dans les mines du Minas Gerais où l’on découvre de l’or en 1695. Viendra enfin le boom du café au début du xixe siècle à Rio et São Paulo, avant que soit enfin proclamée l’abolition, le 13 mai 1888, date tardive qui fait du Brésil le dernier État esclavagiste du monde occidental.
La fin de l’esclavage est aussi celle de l’empire. Le dernier souverain, Pedro II, avait réussi, non sans mal, à faire du Brésil, animé par des forces centrifuges, une nation cohérente peuplée de bons patriotes parlant le portugais. La fin de l’empire ouvre la voie à l’indépendance, puis à une république fragile et clientéliste.
Des dictatures à la démocratie
Les temps modernes s’ouvrent, assez mal, avec les années 1930 et le régime autoritaire de Getúlio Vargas. Dans son Estado Novo dominent le centralisme et une organisation sociale corporatiste et fascisante. Le présidentialisme musclé et l’étatisme quasi religieux des années Vargas vont marquer le Brésil jusqu’à aujourd’hui.
Après le suicide de Vargas, en 1955, arrive Juscelino Kubitschek, un homme enjoué qui semble initier une époque plus heureuse. On y invente la bossa nova et une nouvelle capitale en plein cœur du pays, Brasilia. Mais le président est lui aussi un étatiste volontariste qui poursuit une industrialisation à marche forcée en oubliant l’essentiel : une réforme agraire, donc les paysans pauvres.
Dans un climat de guerre froide née de la révolution castriste à Cuba, les forces armées chassent un président très à gauche, João Goulart, et se saisissent du pouvoir le 31 mars 1964 sous les acclamations de la foule. La dictature militaire va durer une éternité, vingt et un ans, et ce n’est pas avec elle que le pays abandonnera centralisation et étatisme. La junte finance par la planche à billets une croissance artificielle et laisse en héritage à la démocratie, revenue en 1985, une inflation de 221,7 %[2], des routes amazoniennes inachevées, une dette de 102 milliards de dollars[3], 300 morts et disparus, des souvenirs de tortures et le retour d’exilés.
Après trois ans de démocratie, les malheurs du Brésil moderne sont consolidés par une constitution absurde promulguée en 1988. Elle présente une liste interminable d’intérêts particuliers à protéger, sacralise le corporatisme de l’époque Vargas, verrouille l’emploi à vie des fonctionnaires et le caractère public des estatais, les entreprises nationales. Elle offre enfin aux États fédérés une part accrue des recettes au détriment du gouvernement fédéral dont les compétences, cependant, ne changent pas. Ce dernier garde ainsi la responsabilité du système des retraites des fonctionnaires, si généreux que les pensions dépassent souvent les salaires d’activité. L’État fédéral devient une machine à déficits budgétaires.
A lire aussi: Les horizons de la puissance brésilienne
Depuis lors, le Brésil n’a compté que trois tentatives de débloquer le pays du carcan de cette constitution calamiteuse : la première est menée par Fernando Collor de Mello, la deuxième par Fernando Henrique Cardoso, la troisième, qui semble très mal partie, par Jair Bolsonaro.
Collor se présente à l’élection présidentielle de 1989 comme un Kennedy brésilien qui fera enfin entrer le pays dans le premier monde. Face à lui le syndicaliste Lula, leader du Parti des travailleurs (PT), est associé au « communisme agonisant » alors que le Mur de Berlin vient de tomber. Collor l’emporte avec 53,04 % des voix. Dès le lendemain de sa prise de fonction, le 16 mars 1990, il ordonne la confiscation pour dix-huit mois de tous les comptes courants et d’épargne des particuliers dont le solde est supérieur à 50 000 cruzados novos, soit environ 600 dollars américains. 60 millions de Brésiliens sont concernés, sur une population de 146 millions[4], et 80 % de la masse monétaire se voient retirés de la circulation. « Collor a coupé le souffle de l’inflation », déclare un économiste, laquelle avait atteint le taux stratosphérique de 2 737 %.
Pour Collor, il ne s’agit pas d’un hold-up – l’argent sera rendu, avec intérêts – mais d’une arme de « guerre économique » qui s’assigne de réduire la taille du secteur public et l’ampleur de ses déficits, et d’ouvrir le pays à la concurrence étrangère. Il prévoit un programme de désétatisation qui privatiserait une soixantaine d’entreprises publiques. Nous n’en connaîtrons jamais les effets, car Collor, accusé d’avoir détourné quelque 350 millions de dollars d’argent public, démissionne en décembre 1992 pour échapper à une procédure d’impeachment.
Itamar Franco, vieux garçon socialiste, succède à Collor. En 1993, il nomme Fernando Henrique Cardoso, un sociologue social-démocrate, ministre des Finances. Ce dernier résume aussitôt son programme : « Le Brésil a trois problèmes : l’inflation, l’inflation, et l’inflation. » En décembre, il lance le « Plan real » qui s’appuie sur la maîtrise de la masse monétaire et le retour à l’équilibre budgétaire. Cardoso se présente à l’élection présidentielle du 3 octobre 1994 et la remporte au premier tour avec 54,3 % des voix.
Son plan a instauré une nouvelle monnaie – le real – et a réussi à faire passer l’inflation de 2 240,02 % en 1994 à 77,4 % en 1995. Ce succès aide Cardoso. Durant ses deux mandats, l’inflation ne va plus jamais dépasser 10 %. Au-delà de l’amélioration de la conjoncture, le président veut aussi en finir avec les monopoles d’État et ouvrir son pays à la mondialisation. Lula le traite de « néolibéral ». « Je suis un social-démocrate, répond le président à l’auteur de cet article, mais tout le monde sait très bien que le marché l’a emporté face à l’État[5]. »
Comme du temps de Vargas, l’État reste l’agent du développement industriel. Fort de sa probité et d’une majorité de 75 % au Parlement qui lui permet d’amender la constitution, Cardoso reprend le programme de Collor. L’exploration du pétrole est privatisée (mais pas Petrobras) ainsi que la Companha Vale do Rio Doce, géant de l’extraction du fer, et Telebras, qui détenait le monopole du téléphone. Son second mandat sera marqué par la crise qui secoue le Mexique en 1994, l’Asie en 1997, la Russie en 1998. Le Brésil est désigné comme le prochain « domino » et Cardoso tente de résister, mais le marché l’emporte, le real perd 35 % de sa valeur avant de se stabiliser, faisant naître l’espoir d’une reprise. Le président Cardoso n’a cependant plus les moyens ni le temps de ses ambitions.
Le nouveau Brésil de Lula
« Agora é Lula », maintenant, c’est Lula, proclament les slogans de la gauche. Le 6 octobre 2002, Inácio « Lula » da Silva est élu président, ce qui déclenche aussitôt une tempête financière. Mais « le nouveau Lula » qui prône « un nouveau Brésil » se présente comme un révolutionnaire amadoué. Il affirme à l’auteur de ces lignes « qu’il n’a pas l’intention de renationaliser les entreprises privatisées[6] ». 50 millions de Brésiliens sont pauvres et 30 millions d’entre eux vivent dans l’indigence. L’urgence est là et Lula va leur offrir des subsides, mais peu d’investissements durables dans la santé, l’éducation ou les infrastructures. Au cours de ses deux mandats, alors que la reprise mondiale joue en faveur du Brésil, Lula pratique « la vieille politique » du clientélisme et de la corruption.
A lire aussi: Entretien: Brésil, le pays sans ennemi
Après Dilma Rousseff, qui succède à Lula en 2010 sans avoir son charisme ni la chance d’une conjoncture favorable, puis une présidence de transition avec Michel Temer, l’actuel président Jair Bolsonaro, élu le 28 octobre 2018 avec 55,13 % des voix, incarne la troisième version de cette volonté de déverrouiller le Brésil de ses entraves institutionnelles.
Il se saisit des trois priorités des Brésiliens : retour de la sécurité, lutte contre la corruption, libération de l’économie. De nombreux électeurs font confiance à ce capitaine de réserve, député fédéral depuis 1991, qui s’oppose à la gauche et s’entoure de deux personnages incarnant l’espoir d’un renouveau : le juge Sérgio Moro, champion de l’opération Lava Jato (lavage express) liée à Petrobras, et Paulo Guedes, un vieux « Chicago boy » décidé à donner un tour libéral à l’économie. Ce dernier apporte à Bolsonaro l’appui des entrepreneurs et des milieux d’affaires, tempérant ainsi les inquiétudes que suscite le président avec l’embauche de nombreux militaires, ses louanges de la dictature militaire et son usage de la torture. Guedes s’engage dans la réforme des retraites qui consomme 45 % du budget fédéral et qui est finalement adoptée. Mais Bolsonaro, animé par l’illusion que sa victoire électorale le dispense de nouer des alliances pour renforcer sa majorité, s’avère vite un frein aux réformes qu’il prétend porter. Il dénigre la justice, se fâche avec les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, essentiels pour faire avancer l’agenda présidentiel. Les réformes de Guedes – fiscalité, fonctionnaires, dépenses publiques – sont en panne et la popularité de Bolsonaro s’effrite.
Isolé, influencé par les évangélistes et les groupes d’extrême droite qui l’entourent, le président nie la gravité du coronavirus, provoquant la démission de deux ministres de la Santé en moins d’un mois. En s’attaquant à la police fédérale qui soupçonne deux de ses fils de corruption, Bolsonaro provoque la démission de Sérgio Moro qui devient aussitôt son concurrent potentiel aux élections de 2022. Hélas, ce n’est donc pas avec ce président erratique et dérangeant que le Brésil retrouvera enfin le chemin d’une économie libéralisée, condition essentielle d’une société apaisée et prospère.
[1] Première édition en portugais, 1936. Édition française Gallimard/Unesco, 1998.
[2] Estatisticas do seculo xx, IBGE, Rio de Janeiro, 2006.
[3] Dívida externa brasileira, Banco Central do Brasil, Brasilia, 1997.
[4] https://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-e-culturais/busca-por-palavra-chave/populacao
[5] L’Express, 2 mars 2000.
[6] L’Express, 16 mai 2002.