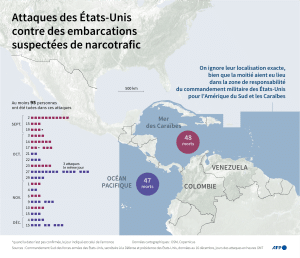Partant d’un passé oligarchique et d’un modèle économique commun à ses voisins, le Costa Rica a su se transformer face aux crises. Il a bâti un modèle social original et un appareil d’État innovant.
Un article à retrouver dans le N60 de Conflits. Vatican. La puissance du temps long.
Un article de Guilhem Lugagne-Delpon et Tito Mejia
Dictatures militaires, guerres civiles et fragilités démocratiques sont des sujets récurrents de l’Amérique centrale. Au milieu de cette tourmente, le Costa Rica fait figure d’exception. Alors que le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua et le Honduras connaissent des cycles d’autoritarisme et de violence au cours du xxᵉ siècle, le Costa Rica consolide la plus ancienne démocratie de la région¹, ainsi que l’une des plus stables du continent. C’est aussi le pays le plus riche et développé de l’Amérique centrale. Faut-il y voir l’expression d’une culture politique particulière, d’un contexte économique spécifique, ou le produit d’institutions politiques originales ?
Un passé commun, mais des différences décisives
Au xixᵉ siècle, peu de choses distinguent San José, de Guatemala ou San Salvador. Au même titre que ses voisins, le Costa Rica est caractérisé par un libéralisme oligarchique. Le modèle économique agro-exportateur privilégie la domination d’une élite terrienne restreinte dans tous ces pays. Ces jeunes États souffrent des mêmes maux : domination de la grande propriété par les élites, exclusion sociale et fragilité institutionnelle.
Toutefois, ces similitudes masquent des nuances structurantes. En effet, depuis l’ère coloniale, la main-d’œuvre indigène au Costa Rica est rare. Cette homogénéité ethnique relative, ainsi que la faible offre de main-d’œuvre ont favorisé des relations de travail centrées sur l’entente, « entente cafetière », plutôt que l’exploitation. De plus, la caféiculture costaricienne, plus ouverte à la concurrence, permet l’émergence d’élites plus fragmentées et dont l’emprise sur l’appareil étatique est mineure. En contraste, le Guatemala est marqué par une oligarchie puissante et une masse indigène marginalisée. En raison de son faible appareil militaire, l’État costaricien est incapable d’imposer son autorité par la force, favorisant la délibération entre des groupes sociaux divers. L’épisode fondateur des élections de 1889 illustre cette spécificité ; force est de constater que la tradition électorale perdure depuis.
Bien que doté de structures économiques homologues à celles de ses voisins, le Costa Rica comptait un certain nombre de différences qui, à terme, ont favorisé une trajectoire politique plus inclusive et prédisposée à la démocratisation.
L’inflexion des réformes des années 1940-1950
Dans les années 1940, le modèle agro-exportateur sur lequel s’était centrée l’économie atteint ses limites ; la société dans son ensemble demande des réformes. Elles sont mises en œuvre sous la présidence du conservateur Rafael Ángel Calderón Guardia, qui forge une alliance improbable entre l’Église catholique, les communistes et les travailleurs. L’alliance permet la mise en place des piliers de l’État social : création de la Caisse costaricienne de sécurité sociale (1941), adoption du Code du travail (1943), fondation de l’Université du Costa Rica (1940). Ces réformes élargissent les droits sociaux, tout en transformant l’équilibre politique. Mais la contestation ne se fait pas attendre. En 1948, une crise électorale débouche sur une brève guerre civile où José Figueres, figure de proue de l’opposition, émerge victorieux.
La Junte qu’il commande pendant les dix-huit mois suivants n’abolit pas les acquis du gouvernement de Calderón mais au contraire, les consolide : abolition de l’armée, promulgation de la Constitution de 1949, limitation des pouvoirs de l’exécutif et création du Tribunal suprême électoral. Paradoxalement, le processus violent de 1948 débouche sur la création d’un ordre institutionnel plus solide, qui contribue à la stabilité de la démocratie costaricienne.
À l’opposé, le Guatemala entame son cycle réformiste à la suite de la révolution d’octobre 1944. Les réformes commencées sous Arévalo puis Árbenz culminent avec la réforme agraire de 1952. Rapidement, la contre-réforme des militaires et des élites met brutalement fin à ce cycle avec le coup d’État soutenu par la CIA en 1954. La restauration de l’autoritarisme militaire anéantit toute avancée sociale pendant les décennies à venir.
Dès lors, le même élan réformateur crée des trajectoires divergentes entre « la Suisse centraméricaine » et le reste de la région. Tandis que le Guatemala sombre dans l’autoritarisme et devient emblématique de la violence, le Costa Rica consolide les bases de sa démocratie stable et durable : un fort investissement social de la part de l’État, un véritable culte du vote et un attachement « religieux »² aux institutions politiques.

(C) Revue Conflits
Une ouverture au monde stabilisatrice
La stabilité institutionnelle à laquelle s’est attaché le Costa Rica dans la seconde moitié du xxe siècle lui permet de jouir depuis lors d’une certaine stabilité économique. Pour cause, les investisseurs trouvent dans ce pays les garanties propices au développement économique. Ces garanties se fondent sur une dualité entre stabilité des institutions et attractivité économique. D’un côté, le régime de zone franche offre aux entreprises des exonérations d’impôts, attirant de nombreuses entreprises étrangères, en leur garantissant également un cadre normatif bien rodé, le pays étant membre de l’OCDE depuis mai 2021. S’ajoute à cela un niveau de corruption particulièrement faible au sein des institutions, qui ont permis au pays de gagner la confiance des investisseurs étrangers. D’un autre côté, l’indépendance en ressources du pays, qui jouit d’un parc énergétique intégralement vert et local, lui garantit une certaine stabilité énergétique.
À la fin des années 1990, le Costa Rica s’ancre dans le commerce international et devient un acteur majeur de l’industrie technologique de la région. Conquise par les avantages fiscaux, l’environnement politique et l’efficacité réglementaire du pays, la superpuissance américaine est la première à conclure une série d’accords commerciaux solides avec le pays centre-américain. En plus d’y implanter des entreprises multinationales, les dirigeants américains y laissent se développer des entreprises particulièrement stratégiques. C’est dans ce contexte que le géant de la fabrication de semi-conducteurs Intel établit une usine d’assemblage et de tests de ses technologies. Cette installation marque le début d’une série de délocalisations stratégiques des États-Unis au Costa Rica.
Au total, depuis les années 1990, plus de 500 multinationales se sont installées dans le pays, lui permettant de bénéficier d’un vaste réseau commercial d’exportateurs de premier plan. Parmi ces sociétés, plus de la moitié sont américaines et ont comme conséquence directe une création massive d’emplois, ce qui alimente la stabilité du pays.
Le modèle démocratique du Costa Rica repose donc sur une stabilité garantie par une économie prospère. Dès lors, les États-Unis apparaissent comme nécessaires dans le développement du pays. En 2022, 73 % des investissements directs étrangers dans le pays proviennent des États-Unis. Cette relation économique étroite incite le Costa Rica à maintenir son attractivité et attire l’attention des Américains quant à la nécessité de stabilité. Un enjeu bien décelé par les dirigeants costariciens, qui s’attelle particulièrement depuis la dernière décennie à adapter l’offre économique du pays aux transformations du monde moderne.
Le président Rodrigo Chaves, élu en 2022, ancien ministre des Finances et fonctionnaire de la Banque mondiale, mène depuis le début de son mandat de vastes projets de modernisation, tout en attirant des investissements des fabricants dans les secteurs stratégiques, en particulier la haute technologie, l’électronique et des dispositifs médicaux. Cette politique conduit le Costa Rica à une croissance de 4,3 % du PIB en 2022 et de 5,1 % en 2023. Un cercle vertueux qui semble confirmer son efficacité au fil des années.
Un modèle solide, mais pas infaillible
Si la croissance économique et l’ouverture au libre-échange du Costa Rica constituent des piliers majeurs de sa stabilité démocratique et institutionnelle, les limites inhérentes à ce modèle prennent chaque fois plus de place dans le débat public. Bien qu’elles ne soient pas encore à un stade d’avancement suffisant à la remise en cause du modèle même, les voix citoyennes s’élèvent pour venir le contester.
Sur le plan économique d’abord, la position de faiblesse du Costa Rica attire particulièrement l’attention des détracteurs du modèle. En 2023, selon la Banque mondiale, plus de 40 % des opérations commerciales du Costa Rica se sont réalisées avec les États-Unis. Ce chiffre significatif vient créer une dépendance certaine du pays d’Amérique centrale envers la puissance américaine ce qui réduit la liberté du pays, son économie nationale étant fortement exposée aux fluctuations de la demande américaine. De plus, toutes les structures de l’économie ne tirent pas parti des investissements étrangers. Si le secteur de la haute technologie et de l’innovation médicale se développent grâce aux zones franches, le secteur agricole est davantage soumis à la concurrence directe des importations subventionnées en provenance des États-Unis.
Cette tension entre pérennisation de l’économie et démocratie a atteint son paroxysme en 2007, lors du traité de libre-échange CAFTA-DR (Central America – Dominican Republic – United States Free Trade Agreement). Cet accord avait alors pour objectif d’accroître les exportations et d’attirer les investissements étrangers, mais il fut critiqué. Ses opposants craignaient une privatisation des services publics, une perte de souveraineté et une fragilisation des petits producteurs agricoles face à la concurrence américaine. Face aux vives contestations, le président du moment, Óscar Arias (prix Nobel de la paix et président du Costa Rica de 2006 à 2010) choisit de soumettre l’approbation du traité à un référendum populaire, une première dans l’histoire démocratique du pays. Le oui l’emporta avec 51,6 % des voix.
D’une certaine manière, le vote populaire a donné une forme de légitimité démocratique au traité, mais a aussi révélé les limites du consensus social autour de la question commerciale et de la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Ce référendum a mis en lumière la polarisation profonde de la société costaricienne, avec d’un côté les classes moyennes urbaines, les employés des milieux d’affaires et les élites politiques favorables au traité et d’un autre côté les syndicats, les paysans et une partie des intellectuels opposés à celui-ci.
Si cet épisode constitue à ce jour la plus grande crise politique du Costa Rica au xxiᵉ siècle, il semble que l’actuel président Rodrigo Chaves, avec ses réussites économiques et démocratiques, a réussi à fédérer à nouveau les citoyens. Sa popularité supérieure à la moyenne après trois années de mandat en est l’illustration parfaite.
¹Dorénavant l’expression « la région » désigne l’Amérique centrale.
²Olivier Dabène, Costa Rica: juicio a la democracia, 1992.