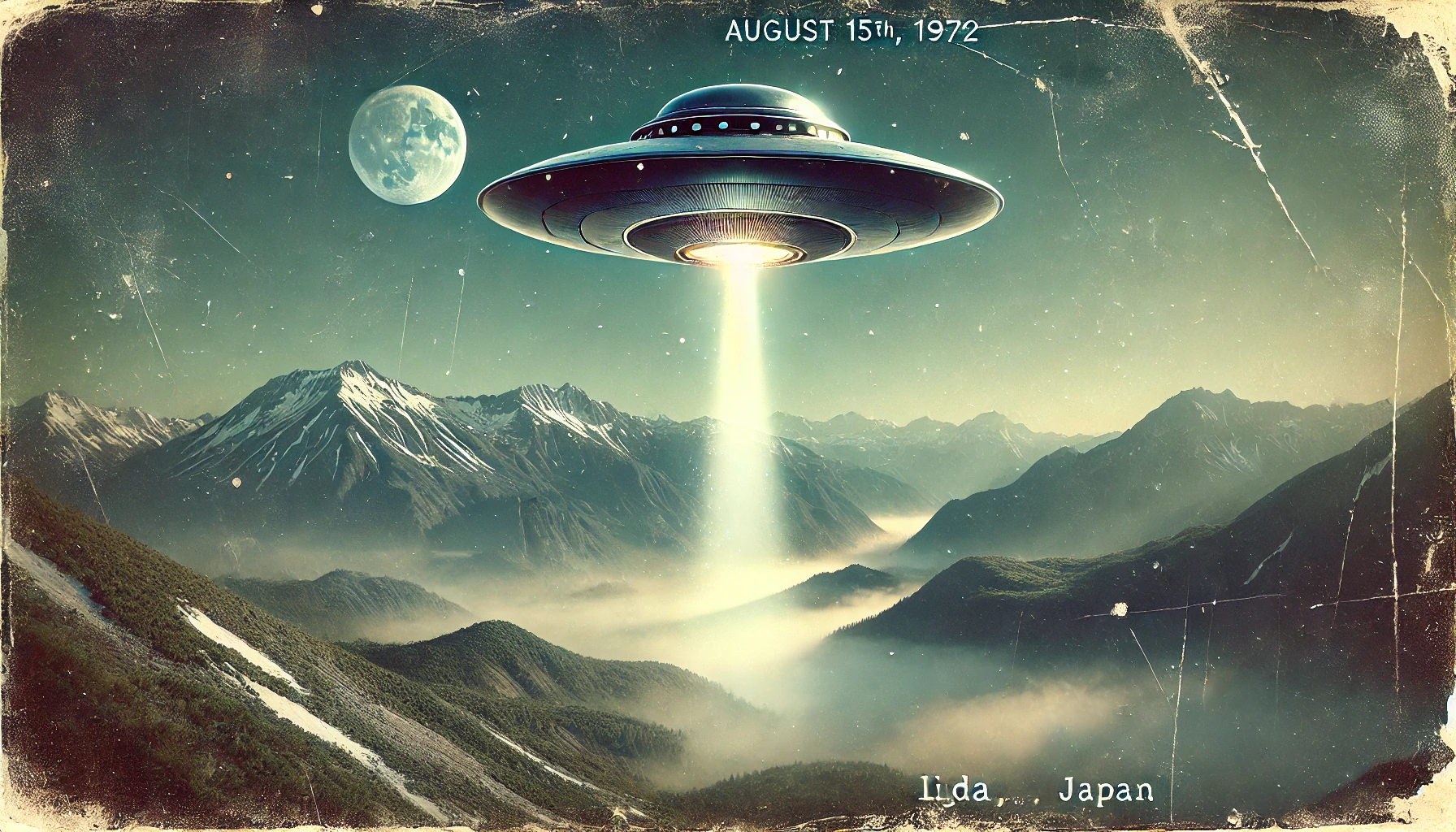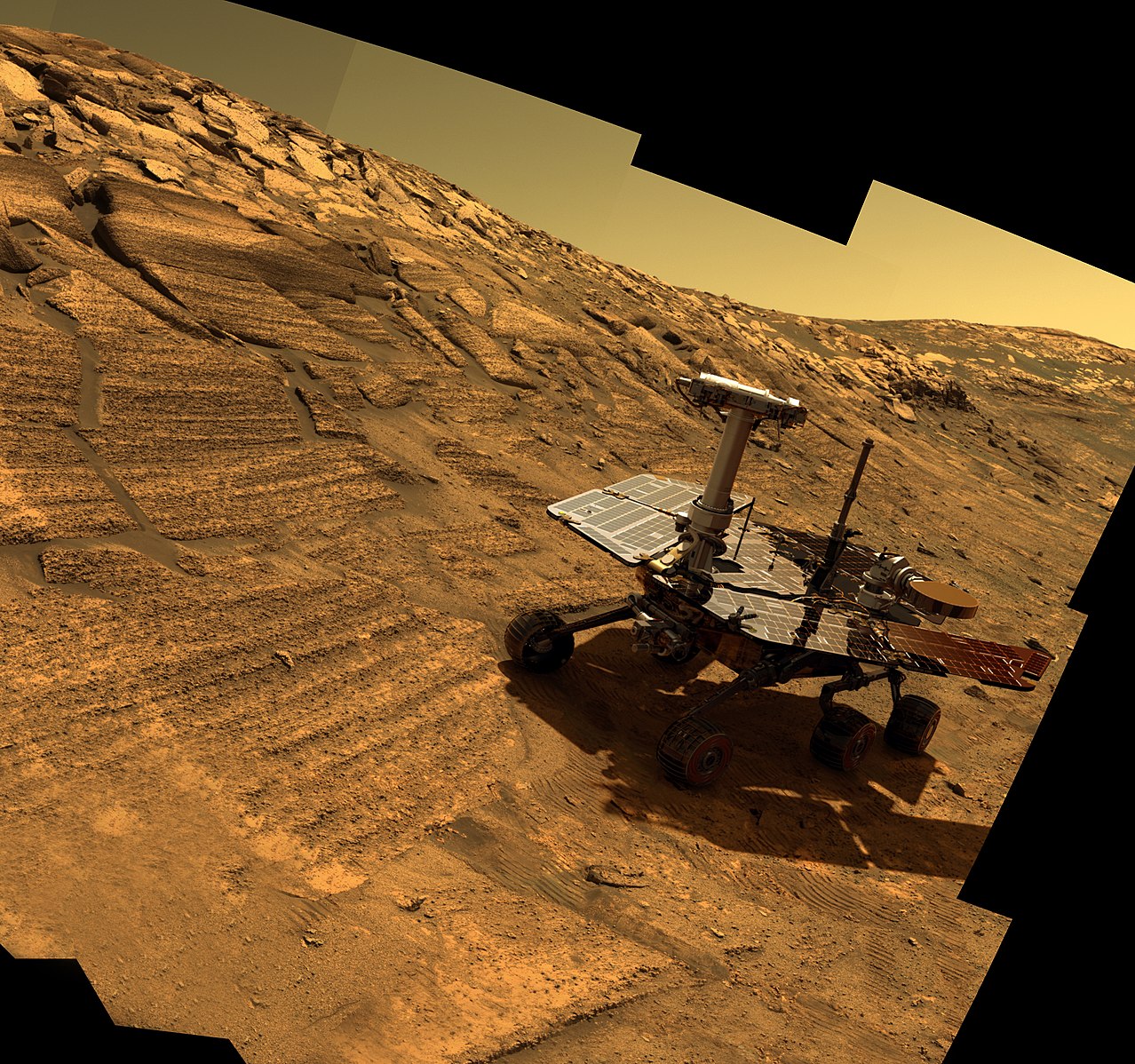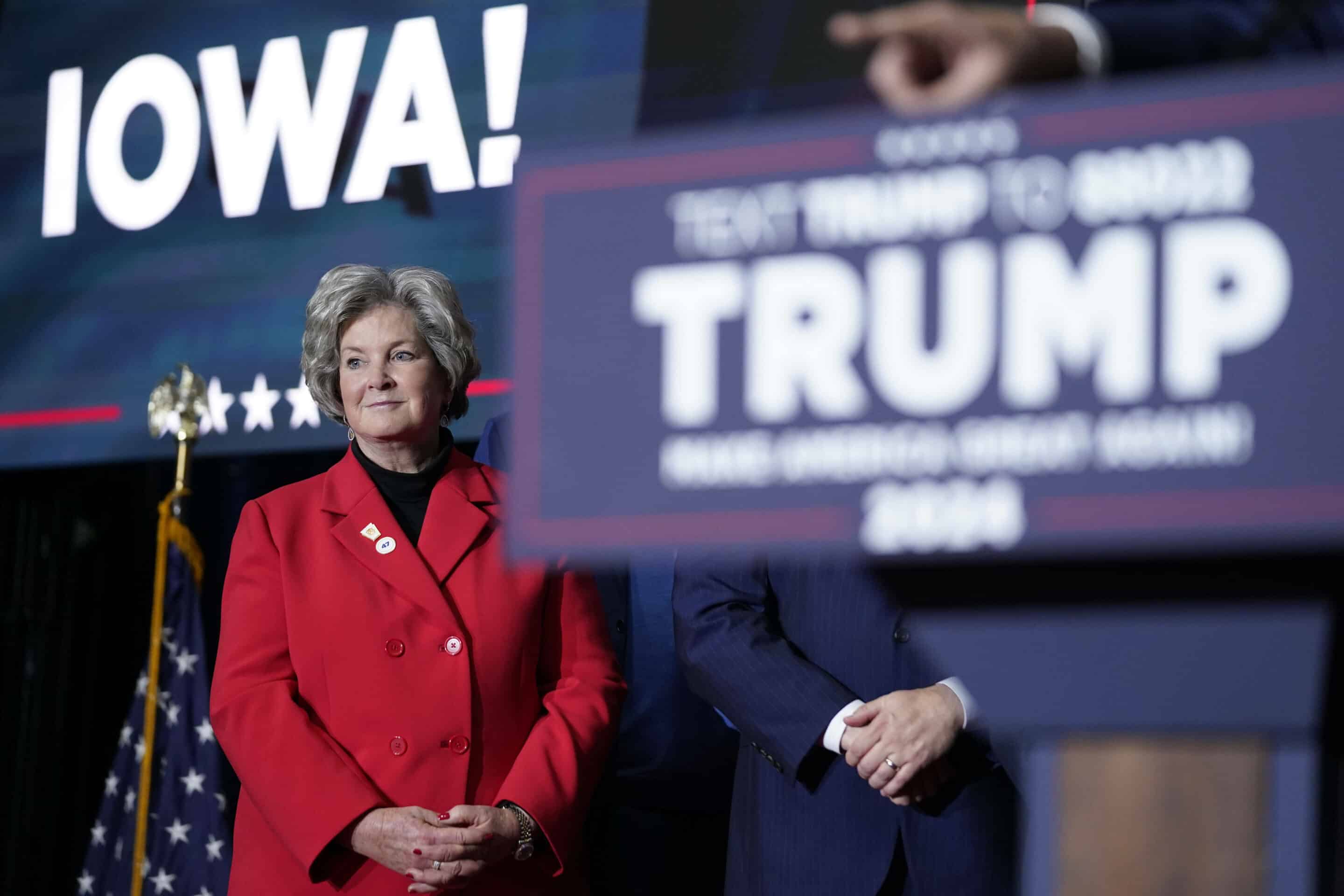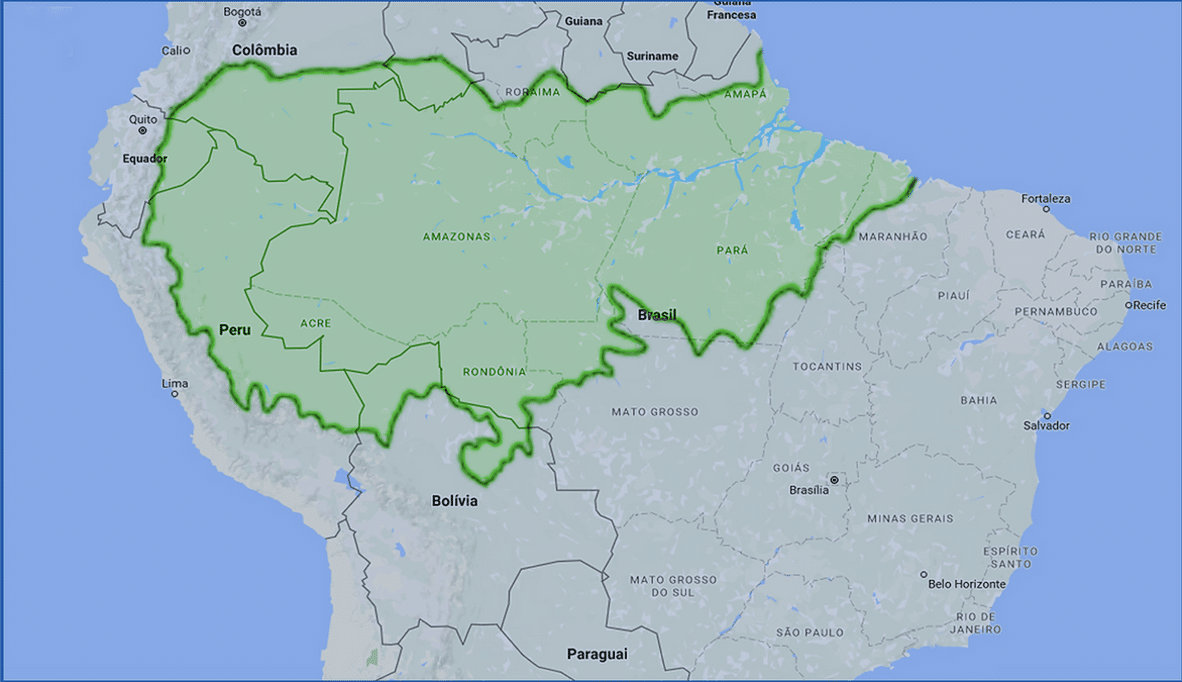La formule de Roosevelt a connu un indéniable succès. Les termes « Empire du mal » pour désigner l’URSS auraient été inspirés à Ronald Reagan par la « Guerre des étoiles », l’un de ses films préférés.
« Nous combattons pour débarrasser le monde du mal. »
Nos souvenirs historiques sont jalonnés de mots et de formules à succès. Malheureusement, ces mots ne sont pas toujours aussi « historiques » qu’il semble. Débusquer le caractère apocryphe de certains d’entre eux, ou retrouver leur sens originel en retraçant leur contexte, telle est l’ambition de cette rubrique.
Cette formule définitive a été lancée par Franklin D. Roosevelt, président des États-Unis, lors de son discours sur l’état de l’Union du 6 janvier 1942. Le pays est alors en guerre depuis à peine un mois, après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l’Allemagne et de l’Italie, quelques jours après. Ce discours achève de faire de la Seconde Guerre mondiale un conflit idéologique, et même moral.
A lire aussi: Iran / Etats-Unis : embargo réel, guerre rituelle
L’entrée en guerre tardive des États-Unis pourrait être à l’origine d’un contresens, qui serait de croire en une réticence du président à épouser la cause des démocraties occidentales, alors que si cela n’avait tenu qu’à lui, ils auraient soutenu les Franco-Britanniques bien plus tôt. L’effondrement de la France en 1940 prend Roosevelt au dépourvu, d’une part à cause de sa rapidité, d’autre part parce que lui-même sollicite un troisième mandat présidentiel, fait exceptionnel dans l’histoire ; heurter une opinion encore fortement isolationniste semblait risqué – il obtint néanmoins une réélection confortable en novembre.
L’effort de guerre américain est pourtant déjà engagé : dès juillet 1940, le Congrès vote le Two Oceans Navy Act pour augmenter de 70 % la capacité navale des États-Unis avec notamment 18 porte-avions, tandis qu’en septembre les États-Unis cèdent 50 destroyers au Royaume-Uni pour assurer la protection contre les sous-marins, en échange de droits à construire des bases sur des terres britanniques (Terre-Neuve, les Bahamas, la Jamaïque, les Bermudes…). L’effort de formation de pilotes et de navigateurs pour l’aviation est également accru très sensiblement. De sorte qu’en 1941 Roosevelt parachève son projet de faire de son pays le « grand arsenal des démocraties » avec la loi « prêt-bail » (lend-lease) qui lui permet d’alimenter tout pays jugé vital pour la sécurité des États-Unis – la loi coûtera finalement 42 milliards de dollars : 50 dépensés, 8 remboursés ; ses plus gros bénéficiaires furent le Royaume-Uni (60 %) et l’URSS (22 %). Paradoxe apparent : en cette année 1941, où ils ne sont officiellement pas en guerre, les États-Unis produisent plus de chars que l’Allemagne, pourtant engagée dans Barbarossa, et plus d’avions que n’importe quel belligérant, et notamment plus que tous les pays de l’Axe réunis !
C’est aussi en 1941 que Roosevelt engage le bras de fer avec le Japon qui aboutira à l’attaque sur Pearl Harbor ; l’engagement des États-Unis dans la guerre en fera non seulement un arsenal, mais aussi une des deux grandes puissances militaires mondiales, pour la première fois de leur histoire, et en particulier la première puissance atomique de l’Histoire, interdisant tout « retour en arrière » vers une politique isolationniste. Pour justifier cette transformation, il fallait évidemment des buts de guerre à la hauteur de l’idée que les Américains se font de leur nation – une nouvelle Jérusalem. Mais placer le combat sur un terrain métaphysique permettait aussi de fixer un but de guerre absolu puisque « seule une victoire totale peut récompenser les champions de la tolérance, de la liberté et de la foi ». C’est donc une capitulation sans conditions qui est exigée, évitant les déboires consécutifs au précédent conflit où les hostilités s’étaient arrêtées à la demande d’armistice, occasionnant le malentendu du traité de Versailles, imposé et non négocié. Ou comment réconcilier impératif moral et Realpolitik…
A lire aussi: Leçon de réalisme à destination des dirigeants américains
Roosevelt avait d’ailleurs choisi entre deux maux, en sauvant Staline pour détruire Hitler. Ses successeurs continuèrent donc cette croisade sans fin, le mal prenant sans cesse d’autres visages : Fidel Castro, Ho Chi Minh, l’ayatollah Khomeiny, Saddam Hussein, plus récemment la dynastie Kim en Corée du Nord. La figure du Mal est au cœur de la culture américaine, comme le montre sa personnification la plus récente : Dark Vador, de la saga Star Wars, qui inspira sans doute Ronald Reagan quand il qualifia l’URSS d’« Empire du Mal » en 1983.