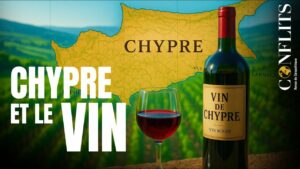En matière hydraulique, l’Espagne accumule les contradictions. Certains territoires sont en situation de stress hydrique quand d’autres ont un trop plein d’eau. L’aménagement hydraulique du territoire est donc un enjeu capital pour alimenter les villes et pour maintenir les activités agricoles et touristiques.
En octobre 2018, pendant une semaine, les îles Baléares ont été touchées par d’importantes précipitations qui provoquèrent des inondations dans la commune de San Lorenzo del Cardezar, à l’est de Majorque [simple_tooltip content=’ López, María, « Siete días de la riada: Las inundaciones de Sant Llorenç en imágenes », Diario de Mallorca, 15 octobre 2018.’](1)[/simple_tooltip]. Moins d’un an plus tard, en septembre 2019, c’est le littoral du Levant et son arrière-pays qui se voient dévastés par des inondations d’une ampleur inédite : Orihuela et Onteniente (Communauté de Valence), Caudete (Castille-La Manche) ou encore Níjar, Dúrcal et Padul (Andalousie). Cela faisait 140 ans que l’on n’avait pas vu un tel déluge dans la région : 300 000 hectares agricoles détruits, des dizaines de millions d’euros pour tout rebâtir et, surtout, six personnes décédées.
Au même moment, la sécheresse touche la moitié septentrionale du pays, avec des lacs de barrage à sec et un grave déficit de précipitations. En Aragon et dans La Rioja, plusieurs bassins hydrographiques sont dans un état inquiétant. À l’autre bout du pays, les crues et débordements ne permettront pas de combattre durablement la désertification de provinces comme Almería, Grenade ou encore de la région de Murcie – défi dont la société locale est bien consciente [simple_tooltip content=’Martín-Arroyo, Javier, « El reto hercúleo de frenar al desierto », El País, 11 mars 2019.’](2)[/simple_tooltip].
Ces épisodes extrêmes, qui ne sont pas inhabituels par eux-mêmes, imposent une redéfinition de la gestion de l’eau outre-Pyrénées. Le paradoxe apparent entre pénurie et surabondance présente donc une facette environnementale évidente, mais se double également de tensions politiques.
Une utilisation intensive et mal répartie
Le tourisme est un secteur économique espagnol bien connu des étrangers, qui en sont les premiers pourvoyeurs. Il représente en 2019 environ 11 % du produit intérieur brut et sa concentration est patente : côte méditerranéenne (Catalogne, Baléares, Communauté de Valence, région de Murcie, Andalousie) et îles Canaries. L’agglutination de millions de visiteurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique sur une portion réduite du territoire a entraîné une logique spéculative, mais également des problèmes environnementaux. Comment faire face à la consommation en eau accrue que suppose la haute saison, surtout dans des régions menacées par la désertification ?
De la même façon, la filière agroalimentaire espagnole est une très grande consommatrice de ressources hydriques : 80 % de l’eau absorbée outre-Pyrénées est destinée à exploiter les sols (environ 15 milliards de mètres cubes). Bien que la quantité d’eau disponible par Espagnol soit globalement comparable à ce que nous connaissons en France, il existe de fortes disparités entre Espagne humide (España húmeda) et Espagne sèche (España seca). La première, bien arrosée, se concentre sur 11 % du territoire péninsulaire (Galice, Asturies, Cantabrie, Pays basque, Navarre septentrionale, bordure des Pyrénées) et concentre 40 % des ressources hydriques totales du pays. La seconde, quant à elle, représente 89 % de la superficie nationale pour 60 % de l’eau [simple_tooltip content=’Petit, Olivier, « Comprendre les conflits environnementaux : le cas de l’eau en Espagne » in L’Économie politique, Paris : Alternatives Économiques, 2016, n° 69, page 70.’](3)[/simple_tooltip]. Elle a donc plus massivement recours à l’agriculture irriguée (cultivos de regadío) qu’à l’agriculture sans irrigation (cultivos de secano). Les huertas (ensemble de petites parcelles très arrosées) de la Communauté de Valence et de la région de Murcie sont donc très gourmandes en eau, tout comme les vegas (basses vallées inondables) andalouses et la mer de serres qui s’étend autour d’Almería – le « verger de l’Europe ».
La politique nationale des transferts
C’est pour tenter de mettre fin à ces disparités régionales que, dès le début du siècle dernier, les penseurs, ingénieurs et gouvernants espagnols proposent puis mettent en place des systèmes de redistribution de l’eau. L’idée dominante depuis les années 1890 est la suivante : pour favoriser le développement équitable de l’ensemble de l’Espagne, il faut que les bassins versants excédentaires acceptent de transférer leur surplus vers les régions déficitaires. La planification étatique desdits transferts (trasvases) commence sous la Seconde République (1931-1939) puis se poursuit durant le franquisme (1939-1975) par un ambitieux plan de construction de barrages (600 ouvrages d’art de ce type sont créés dans tout le pays entre 1940 et 1972) et de réseaux d’adduction.
A lire aussi : La tragédie de l’Espagne vide et ses multiples facettes
Deux grands fleuves, le Tage (1 202 kilomètres) et l’Èbre (928 kilomètres), sont mis à contribution depuis les années 1970, notamment par le biais d’un canal entre le bassin du Tage et celui du Segura (fleuve de 341 kilomètres qui se jette en Méditerranée à Guardamar del Segura, au sud d’Alicante) [simple_tooltip content=’Loyer, Barbara, op. cit., page 265.’](4)[/simple_tooltip]. Du côté de l’Èbre, c’est la moyenne vallée du cours d’eau, autour de Saragosse, qui est sollicitée afin d’abreuver l’aire urbaine de Barcelone.
Mais les oppositions aux transferts sont nombreuses dans les régions dites « excédentaires ». Les Aragonais, par exemple, sont terrifiés à l’idée que leur région devienne un désert. En Castille-La Manche, la baisse régulière du niveau du Tage inquiète les écologistes, les agriculteurs, les dirigeants régionaux (traditionnellement de gauche) et, plus largement, les habitants. La région de Murcie, dont les présidents sont de droite depuis 1995, réclame au contraire de l’« eau pour tous » (agua para todos) car ils craignent plus que tout l’avancée du désert. Castillans et Aragonais leur opposent le fait que le littoral méditerranéen est plus dynamique et riche que l’intérieur du pays. Retirer de l’eau à ce dernier reviendrait donc à lui ôter des potentialités de développement et un poids politique au sein de l’ensemble espagnol.
La division de l’Espagne en dix-sept communautés autonomes devenues de vraies baronnies aux intérêts contradictoires multiplie les sources de conflits, parfois à l’échelle locale. Les habitants de Murcie sont aussi très angoissés par l’agonie du mar Menor, lagune (albufera) d’eau salée de 135 kilomètres carrés que les intempéries violentes et la pollution détruisent à petit feu. Les mauvaises pratiques sont elles aussi de plus en plus nombreuses, agriculteurs et habitants allant parfois puiser l’eau là où elle se trouve, même si ce « là » est un parc national fragile. Le manque de précipitations est évidemment à la source de graves incendies qui ravagent les régions les plus sèches, 2019 étant un triste exemple de ce phénomène [simple_tooltip content=’Miranda, Isabel, « El tiempo seco y la quema de pastos multiplican los fuegos en España », ABC, 10 mars 2019 ; et Olcina, Jorge, « 2019, el año en que probablemente ardan más bosques en España », La Razón, 28 juin 2019.’](5)[/simple_tooltip].
Les contraintes européennes et l’opposition traditionnelle entre la droite (le Parti populaire prône la poursuite de la politique de transvasement) et la gauche (le Parti socialiste ouvrier espagnol est partisan de son arrêt en faveur d’autres politiques, comme le dessalement de l’eau de mer) accentuent le problème. Les conflits hydriques inter-régionaux se résolvent souvent devant les tribunaux tandis que les investissements dans les infrastructures de répartition de l’eau ont énormément baissé à la suite de la crise économique de 2008.
Les évolutions climatiques modifient par ailleurs la division classique entre « Espagne humide » et « Espagne sèche ». La Galice, par exemple, faisait jadis partie de la première région, mais son déficit pluviométrique est toujours plus prononcé [simple_tooltip content=’Pichel, José, « Galicia se seca, Asturias se «hunde»: así han cambiado las lluvias en 50 años en tu CC. AA. », El Confidencial, 18 juillet 2019.’](6)[/simple_tooltip].
La Catalogne, de son côté, réclame des mesures spécifiques en raison de la concentration des activités économiques le long de la côte méditerranéenne36. Le conflit hydrique n’est au demeurant pas étranger à la poussée nationaliste qui marque la communauté autonome depuis 2012.
La submersion, danger hydrologique majeur
Filons le paradoxe du début d’article : face à la pénurie récurrente que nous venons de décrire, l’excès d’eau frappe également l’Espagne à intervalle régulier. Nous parlions précédemment des inondations de San Lorenzo del Cardezar et surtout de la « goutte froide » (gota fría) qui a dévasté plusieurs villes du sud-est péninsulaire, également désigné sous l’acronyme DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) par les médias de notre voisin ibérique.
Plus encore, ce sont les pratiques humaines et les choix d’urbanisme qui sont en cause dans le caractère catastrophique de ces pluies intenses. Le recours généralisé à l’asphalte et au béton ainsi que la construction de lotissements et immeubles d’habitation sur les littoraux (là où se massent touristes et citoyens espagnols en quête d’un cadre de vie agréable) aggravent les effets délétères de ces épisodes orageux. En périphérie de Madrid, la commune d’Arganda del Rey (55 000 habitants environ), bâtie dans une cuvette, est systématiquement plus touchée que ses voisines par les « gouttes froides ». Des mesures techniques devraient donc être prises afin de pallier ces effets les plus désastreux.
A lire aussi : Ralentissement économique de l’Espagne – Entre facteurs internes et tensions géopolitiques
De manière générale, il semble plus que jamais nécessaire d’investir massivement dans le réseau hydrique national, y compris pour aménager ou réaménager le cours des fleuves et rivières. Les polémiques sur l’état du lit de l’Èbre ou du Segura ne manquent jamais après des crues ravageuses. Le gouvernement national et les exécutifs régionaux sont aussi appelés à se pencher sur la répartition de l’habitat dans des zones inondables.
La montée du niveau de la mer est, dans ce cadre, une autre préoccupation de moyen et long terme pour l’Espagne. Environ 210 000 Espagnols pourraient être touchés par le phénomène d’ici à 2050, principalement dans les agglomérations littorales (Barcelone, Valence, Málaga, La Corogne, Saint-Sébastien, Cadix, Huelva) ainsi que dans la basse vallée des principaux fleuves (Séville, delta de l’Èbre) [simple_tooltip content=’ Granda, Gerardo, « Estas son las ciudades españolas que se verían más afectadas si sube el nivel del mar », La Razón, 25 septembre 2019 ; et Fresneda, Carlos, « Las inundaciones costeras afectarán a 210.000 españoles en 2050 », El Mundo, 29 octobre 2019.’](7)[/simple_tooltip].
Prendre soin des hommes… et de la nature
De tels bouleversements ont donc des répercussions politiques, économiques, sociales et environnementales. Ce constat est d’autant plus fort que les activités humaines provoquent d’importants dégâts sur une faune aquatique particulièrement riche. Les modifications de température ou de composition des étendues d’eau douce et salée sont à l’origine d’invasions zoologiques que les autorités ont tout le mal du monde à combattre, que ce soit en bord de mer ou dans le lit des fleuves.
Amoureux de la nature et simples citoyens alertent depuis longtemps sur certaines dégradations imputables aussi bien aux industries qu’aux responsables de gauche comme de droite. À cet égard, l’exemple le plus éloquent est sans doute celui de Huelva, capitale de province andalouse. Pôle pétrochimique de premier ordre outre-Pyrénées (traitement et production de polyphosphates, cyclohexane, acide phosphorique, acide sulfurique et ammoniaque), la ville se trouve à la confluence de deux fleuves (le Tinto et l’Odiel) dans lesquels 2 à 3 millions de tonnes de déchets sont déversés chaque année. La pêche intensive dans l’océan Atlantique et la culture de la fraise sous serre en périphérie de l’agglomération sont autant de sources de pollution à prendre en compte [simple_tooltip content=’Voir Baron, Nacima, op. cit., page 48.’](8)[/simple_tooltip].
Les communautés autonomes, encore et toujours au cœur de la discussion
La protection de la santé humaine, de la biodiversité et des ressources hydriques entre par conséquent en contradiction avec la croissance économique et les impératifs industriels. L’eau est une ressource convoitée à l’échelle mondiale. Outre-Pyrénées, sa rareté et son excès (qu’ils surgissent alternativement dans un même endroit ou simultanément en plusieurs points du territoire) expliquent de nombreux problèmes face auxquels les Espagnols déploient parfois des trésors d’ingéniosité.
Une fois de plus, cependant, l’existence de baronnies régionales qui cherchent à défendre leurs intérêts propres plutôt que ceux de la collectivité est souvent en cause. Dans un domaine aussi sensible, semblable comportement ne peut qu’être dommageable.