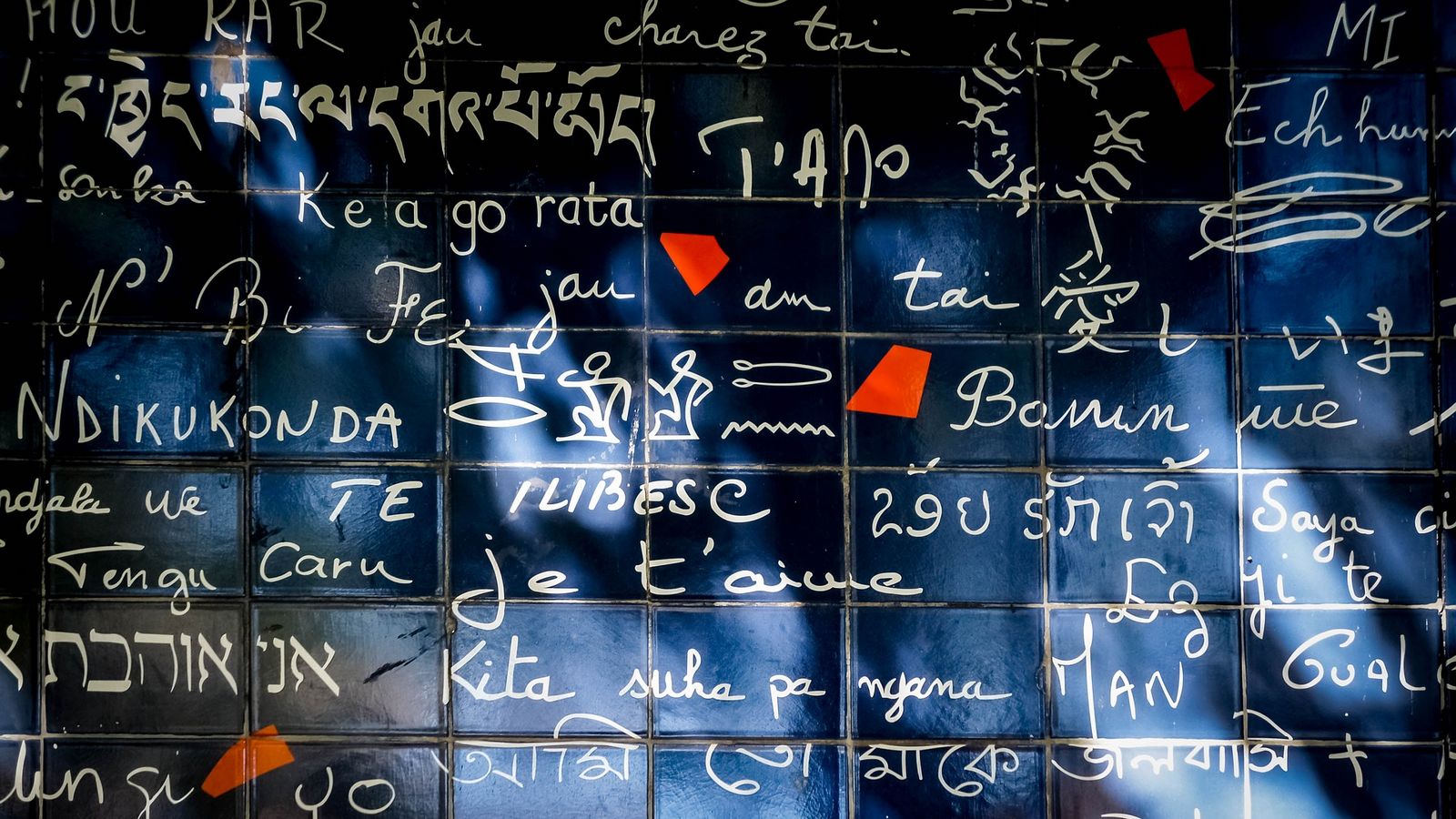Créée au XIXe siècle, l’espéranto a connu des succès d’estime et une véritable communauté s’est organisée autour de cette langue. Son échec montre qu’il est difficile de créer une langue déconnectée des nations et des territoires.
L’anglais est aujourd’hui la langue de la mondialisation, et cet état de fait ne semble pas devoir être remis en cause dans l’immédiat. Mais à la fin du XIXe siècle, dans le contexte d’un monde multipolaire, un médecin juif de Bialystok, Ludwig Zamenhof, a réussi à créer une langue qui fédérera beaucoup d’espoirs des décennies durant, mais n’obtiendra jamais la consécration attendue.
C’est en 1887 que le docteur Zamenhof publie son livre, Langue Internationale. C’est certes un manuel de langue, mais aussi un véritable manifeste, et à la fin, se trouvent des coupons à renvoyer à l’auteur, consistant en un engagement à diffuser cette langue si le nombre de souscriptions dépasse les 10 millions. Le succès est au rendez-vous, puisqu’une vingtaine d’années plus tard, en 1905, se tient le premier congrès mondial d’esperanto à Boulogne-sur-Mer.
Une langue bien conçue et résistante
Le succès de l’esperanto tient d’abord à une conception réussie qui lui a permis de supplanter les autres projets de langue universelle. Une grammaire réduite à 16 règles, des racines issues des principales langues européennes sur lesquelles on peut former nom, verbe et adjectif par simple changement de terminaison, rendent son apprentissage aisé. En outre, il s’est imposé face au volapük, moins aisé d’apprentissage, et dont le mouvement était miné par les divisions. Ce problème a aussi concerné l’Espérantie [simple_tooltip content=’Nom donné à la communauté espérantophone’](1)[/simple_tooltip], mais ne l’a pas significativement affecté : l’Ido, langue créée à la suite d’une scission, n’a jamais connu un réel succès.
Dès ses premières années, elle séduit de nombreuses personnalités : écrivains, scientifiques et explorateurs apprécient souvent le concept, et l’adoptent parfois avec la même facilité que l’apprentissage de la langue. Mais c’est parmi les pacifistes qu’elle fait le plus d’émules : Jean Jaurès propose d’ailleurs qu’elle soit utilisée par l’Internationale socialiste pour la diffusion des nouvelles par son Office bruxellois.
Une langue sans territoire, mais pas en dehors de l’histoire
Le mouvement espérantiste s’est rapidement doté d’emblèmes, il a ainsi un hymne et un drapeau. Il a même eu sa propre monnaie, le Stelo, qui était indexée sur le Florin néerlandais. Certains militants du mouvement ont voulu territorialiser ce mouvement hors sol, sans succès toutefois. L’exemple le plus notable est celui du Moresnet neutre en 1908, territoire situé à la limite de la Belgique et de l’Empire allemand, et disputé par les deux. Il connaîtra un succès d’estime, puisque reconnu capitale du mouvement par le congrès de Dresde de la même année, mais il sera rapidement balayé par la Première Guerre mondiale.
A écouter aussi : Les langues : enjeux indirects de la puissance, entretien avec Jean-Yves Bouffet
Dans tous les cas, l’importance du mouvement ne laissait pas indifférent lors des plus grands soubresauts du XXe siècle. L’Allemagne nazie fit interdire cette langue, assimilée au judaïsme de son fondateur. Staline ne l’appréciait pas plus, en raison de son « cosmopolitisme ». Mais à contrario, Fidel Castro permit l’accueil du 75e congrès du mouvement à La Havane, et déclara que l’esperanto devait être la « langue de l’humanité ». Quant à l’Église catholique, malgré la sympathie affichée par plusieurs papes, dont Jean-Paul II qui l’utilisa pour la bénédiction Urbi et Orbi, elle n’y dépasse pas le succès d’estime.
La force du réseau communautaire
La pratique de l’esperanto dans le monde est difficile à mesurer, étant donné qu’elle n’est pas langue officielle ou administrative. Le meilleur indice reste la présence des associations espérantophone, car c’est le principal cadre de son utilisation et de sa transmission. On constate ainsi qu’il s’agit avant tout d’un phénomène européen, qui s’est transmis sur le continent américain et en Océanie, en particulier dans les pays d’émigration du XXe siècle (États-Unis, Brésil, Argentine…). Dans le reste du monde, l’Esperanto rencontre peu de succès en Afrique, et est quasiment absent des mondes arabe et turc. En revanche, son succès est notable en Asie, notamment au Japon et surtout en Chine, où il a entre autres l’intérêt de constituer une langue européenne facile d’accès.
L’avènement des années 1990 et de la mondialisation aura eu raison du projet universaliste de l’Esperanto. En effet, cette époque a consacré l’anglais en tant que langue universelle, portée par les États-Unis. Le projet universaliste devant transcender les nations, constitutif de l’esperanto, aura été autant une force qu’un handicap : il en a résulté qu’il n’a jamais eu le soutien d’un État, élément décisif dans le succès de l’anglais. Cependant, l’Espérantie survit en tant que communauté transnationale, son fonctionnement étant tout à fait adapté à la société façonnée par l’Internet. Utopie née au XIXe siècle, ayant vécu au XXe siècle, elle semble survivre aux affres du XXIe siècle, continuant à prouver son caractère inoxydable. Et si elle finissait par gagner à l’usure ?