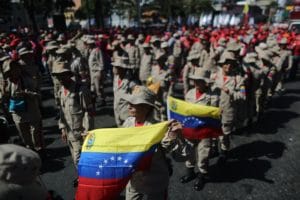La droite a une nouvelle coqueluche : Gramsci. Personne ne l’a lu, mais tout le monde s’en réclame. La droite l’assure : « comme Gramsci l’a dit », il faut mener la bataille des idées.
Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?
Si le souffle des canons s’estompe parfois, la guerre culturelle, elle, ne s’arrête jamais. Toujours larvée, elle impose sa petite mélodie et cherche à imposer sa vision du monde en se servant des institutions culturelles, éducatives et/ou médiatiques comme cheval de Troie. Livres et films remplaçant la petite mélodie des balles perdues.
Cette notion de guerre culturelle, popularisée en 1991 par le sociologue américain James Davison Hunter avec son ouvrage Culture Wars, puise allégrement dans le terreau des théories marxistes popularisées au début du xxe siècle par Antonio Gramsci. Lui, le premier, a systématisé cette lutte des consciences. Longtemps portée par la gauche révolutionnaire, cette notion fut progressivement reprise par la droite conservatrice dans une tentative de contre-offensive doctrinale qui eut lieu au sein de la convention républicaine de 1992. L’ensemble de la classe politique américaine de droite prend conscience qu’elle est en train de perdre la bataille des idées et ce… depuis une poignée de décennies ! Cela dit, le réveil n’eut véritablement lieu qu’avec le discours de Patrick Buchanan, le fameux Culture War Speech.
Il parvint à galvaniser son audience en dénonçant les visées d’une gauche qui tente de saper les fondements moraux de la société américaine. Ce moment, largement médiatisé, eut le mérite d’ancrer le concept au sein du débat public.
Et Gramsci fut !
Antonio Gramsci théorise ce concept d’hégémonie culturelle à l’intérieur de ses Cahiers de prison. Pour lui, la domination d’une classe repose non seulement sur sa primauté économique et politique, mais aussi (et surtout) par la maîtrise et la diffusion de ses idées. Règne celui qui parvient à théoriser et à publier ! Contrairement à Karl Marx, qui privilégie la seule mainmise sur les structures économiques, Gramsci insiste sur le contrôle des superstructures culturelles (écoles, médias, églises, édition). La lutte ne saurait se situer que du côté du versant économique, elle doit brandir haut la bannière de l’idéal. D’une certaine manière, c’est reconnaître que l’aspirant révolutionnaire ne saurait être qu’un individu frustre mû par la seule faim et l’envie, mais doit devenir un proto-intellectuel capable de reprendre à son compte des théories dûment conceptualisées. L’auteur italien distingue donc deux stratégies qui se complètent l’une l’autre : la « guerre de mouvement » (l’insurrection directe) et la « guerre de position » (la lutte culturelle). Cette dernière, plus lente, vise à transformer en profondeur les mentalités. Et pour longtemps. Le pouvoir politique ne pouvant se maintenir longtemps qu’à la condition que la masse partage, du moins a minima, son idéologie. Cette vision gramscienne influença la politique publique des partis de gauche après la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à ce qu’une certaine droite la reprenne à son compte des décennies plus tard.
Cependant, la gauche n’a pas abandonné les idées de Gramsci même après leur adoption par la droite. Au début des années 1980, des penseurs comme Chantal Mouffe et Ernesto Laclau réinvestirent la pensée gramscienne et prônèrent l’alliance des différents mouvements de la gauche en tenant compte des diversités et des revendications identitaires. Cette réappropriation permit au bloc gauchiste d’entièrement renouveler son approche de la lutte en s’éloignant toujours un peu plus d’un marxisme strictement économique.
The war of the books
La stratégie gramscienne s’illustre au mieux lors de la « bataille du livre » qui fut menée par le Parti communiste français (PCF) entre 1939 et 1950. L’objectif étant de contrer une hégémonie culturelle perçue comme bourgeoise par la diffusion massive d’œuvres qui visent à remodeler la conscience populaire. Les Éditions sociales créées sous l’égide du PCF publient près de 100 titres par an avec un tirage moyen de 15 700 exemplaires par ouvrage. Parmi les auteurs édités, 77 % d’entre eux sont français (incluant des classiques comme Balzac, Hugo et Zola), mais l’on trouve aussi des textes politiques écrits par Lénine ou Staline dans une volonté assumée de créer une « école pour les exclus de l’école » tout en diffusant l’idéologie communiste. Entre 1945 et 1962, les Éditions sociales revendiquent la vente de plus de 1,4 million de livres. Cela dit, des tensions émergent dès 1947 au sein du PCF, bon nombre d’intellectuels critiquant la mise sous tutelle de l’art par le Parti. Dans les années 1960-1980, des éditeurs comme Le Seuil et Gallimard ont amplifié les voix de la French Theory qui s’exporte, plus que jamais, en direction des États-Unis. En 1980, les traductions anglaises de Foucault et Derrida représentent ainsi 20 % des ventes de livres dans la catégorie des sciences humaines dans les villes abritant des universités américaines.
Infiltrer les universités
Parce que si les idées de Gramsci parviennent à pénétrer le milieu universitaire européen, ce sont surtout les départements de sciences humaines qui deviennent, en premier lieu, des foyers de réflexion militante. Certains départements encouragent, sans frémir, les idées marxistes dans un objectif aussi simple qu’ambitieux : faire vaciller l’arrogance et la suprématie capitaliste. Extirpons les racines du mal et abattons l’arbre du grand capital. Mai 68 vient de là. De cette idée que tout est possible et que les structures du savoir sont gangrénées.
Devenues des bastions de la gauche au cours des années 1960 et 1970, les facultés françaises parviennent à exporter leurs idéaux au-delà des frontières. Michel Foucault, Louis Althusser ou encore Jacques Derrida renouvellent en profondeur la sociologie et l’histoire et la French Theory commence à s’exporter aux États-Unis, transformant en profondeur les campus américains. Sans French Theory, pas de récits déconstructivistes ni de champs d’études centrés autour du postcolonialisme, du féminisme et de la branche queer. Une étude publiée par l’American Educational Research Association révèle qu’en 1970, 60 % des professeurs d’université en sciences humaines s’identifiaient comme étant libéraux ou de gauche. En 2016, une étude similaire de la Higher Education Research Institute révèle une polarisation accrue ; 88 % d’entre eux affirment se placer à gauche de l’échiquier. La French Theory a essaimé et a fait des petits, mais pour combien de temps encore ?
« Une bataille des idées pour une droite qui ne pense pas »
La Nouvelle Droite contre-attaque
Cet état des lieux ne pouvait rester indéfiniment ainsi, en tout, il faut de l’alternance. Ainsi, dès les années 1970, la droite européenne commence à faire siennes les théories de Gramsci. En France, le Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE) –fondé en 1968 – revendique l’instauration d’un « gramscisme de droite ». Dans son ouvrage Vu de droite (1977), Alain de Benoist affirme d’ailleurs que la lutte sur le terrain des idées est bien plus efficace que des affrontements directs avec les membres des groupuscules gauchistes. La Nouvelle Droite le sait, si elle souhaite compter, elle doit reconquérir une certaine hégémonie culturelle en investissant massivement dans les médias, l’édition et les universités. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du livre (STL) ainsi que le Club de l’Horloge, tous deux fondés par Jean-Yves Le Gallou en 1974, se mettent ainsi à dénoncer la prédominance marxiste au sein des milieux culturels et la tentative de destruction de toute forme de sentiment national. Ces organisations s’attaquent directement à ce qu’elles perçoivent comme une entreprise de déconstruction des identités nationales orchestrée par la gauche, accusée de promouvoir un universalisme dissolvant les particularismes culturels.
Pour la gauche, la patrie est une notion éminemment suspecte. Elle sent sa bourgeoisie et son amour des canons. L’envie de reprendre la main sur les valeurs qui sont véhiculées à travers la société est promise à un bel avenir. Cette ambition reflète une volonté de redéfinir le contrat social autour de valeurs conservatrices, en mobilisant des récits qui valorisent la tradition, la nation et l’ordre face à un progressisme jugé déracinant. Lors de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy déclare d’ailleurs : « J’ai fait mienne l’analyse de Gramsci : le pouvoir se gagne par les idées. »
Mais au-delà du seul Hexagone, c’est l’ensemble des droites qui investit désormais massivement dans les think tanks et autres médias. Cette internationalisation de la stratégie conservatrice montre une convergence des droites occidentales autour d’un objectif commun : contrer l’influence des idéologies progressistes à l’échelle globale. Aux États-Unis, l’Heritage Foundation dispose même, en 2023, d’un colossal budget annuel qui avoisine les 100 millions de dollars et permet de financer de nombreuses campagnes contre le wokisme tout en soutenant les candidats porteurs d’une politique conservatrice. En France, l’Institut Montaigne se voit attribuer un rôle similaire même s’il est « seulement » doté d’un budget annuel proche des 5 millions d’euros.
Quant aux médias jugés conservateurs (CNews en France, Fox News aux États-Unis), ils servent de caisse de résonance. CNews, propriété de Vincent Bolloré, a vu son audience croître de plus de 30 % entre 2020 et 2023. Cette augmentation spectaculaire reflète bien l’appétit d’une partie du public qui entre en dissonance avec les discours tenus par l’establishment médiatique. Depuis les années 2000, la droite est progressivement sortie de son état semi-léthargique et s’essaye à récupérer les espaces culturels et médiatiques. Plusieurs figures de droite investissent dans l’acquisition de maisons d’édition prestigieuses représentant à elles seules près d’un tiers du marché. Cette nouvelle concentration ne va pas sans susciter de vives inquiétudes à gauche. Nombreux sont les politiques et les écrivains « progressistes » qui déplorent la promotion d’auteurs jugés réactionnaires. Pour faire bref, la mainmise des élites de gauche sur la culture s’estompe chaque jour un peu plus et ceux-ci ont le sentiment de sentir sur leur nuque le souffle d’un spectaculaire retour de bâton. Il est peu plaisant de se retrouver dans le camp des exclus après avoir exclu les autres pendant des décennies. Nous ne sommes pas loin de l’arroseur arrosé.
Cela dit, l’audiovisuel public français reste aux mains d’instances que l’on peut qualifier de tout sauf de droite. Autrement dit, la lutte continue !
1 Antonio Gramsci (1891-1937), né en Sardaigne et mort à Rome. Membre fondateur du Parti communiste italien, son œuvre intellectuelle est surtout contenue dans ses Cahiers de prison.