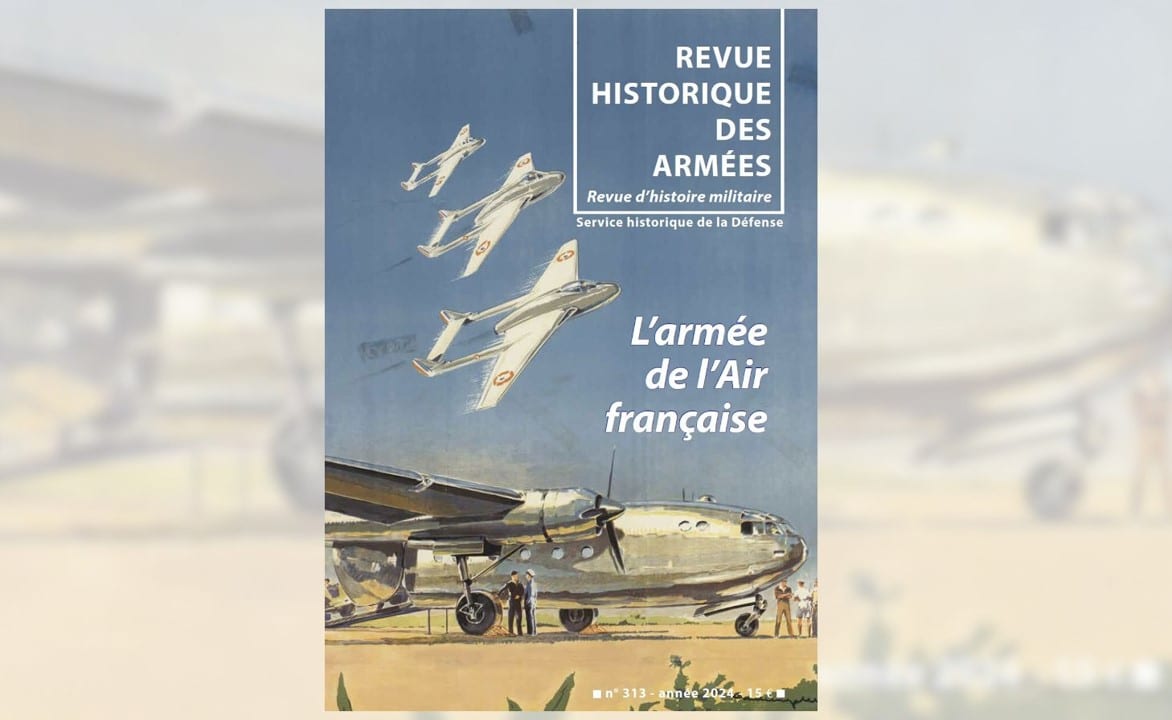Depuis un an, l’armée russe patine en Ukraine. Si elle n’arrive plus à avancer, elle parvient toutefois à se maintenir et à conserver une puissance de feu et de pression, ce que peu d’armées au monde sont capables de faire. Surtout, elle dispose de l’arme nucléaire ; menace qu’elle fait peser depuis les débuts de l’opération en Ukraine.
L’issue de la guerre en Ukraine est toujours inconnue, mais les faiblesses de l’appareil militaire russe sont déjà apparues au grand jour. Des missiles hypersoniques Kinjal, tant vantés par Vladimir Poutine lors de son discours de 2018 sur les armes « invincibles » de la Russie, ont été interceptés dans le ciel ukrainien par des batteries de Patriot américains. Les chars flambants neufs paradant sur la place Rouge ont fait long feu. Désormais, les Russes sortent de leur réserve d’antiques T-54, T-55 et T-62, les deux chiffres se rapportant à l’année d’entrée en service de ces modèles… Tout ce qui est excessif étant insignifiant, il serait réducteur de parler d’une armée Potemkine. La Russie réussit malgré tout à maintenir dans la durée une puissance de feu colossale et a su s’adapter à certains endroits au cours de la guerre, par exemple dans l’usage des drones. Hormis les États-Unis, ou peut-être la Chine, aucun autre pays n’aurait les ressources militaires suffisantes pour tenir depuis plus d’un an un tel conflit, qui consomme plus de 10 000 obus chaque jour.
Tigres en papier aux dents atomiques
Certes, mais il reste malgré tout que, sauf renversement militaire majeur sur le terrain, l’armée russe apparaît durablement dans les esprits (au moins occidentaux) comme « un tigre en papier ». Une expression que l’on emprunte à Nikita Khrouchtchev. Le 13 décembre 1962, à Moscou, le dirigeant soviétique justifie l’issue de la crise de missiles de Cuba en réfutant l’idée qu’il aurait capitulé face à Kennedy. « Si certains [les Chinois, NDLR] affirment que les impérialistes [les Américains] sont des tigres en papier, ils ne devraient pas oublier que ces tigres ont des dents atomiques », met en garde Khrouchtchev. Le parallèle avec la Russie de Vladimir Poutine apparaît aussitôt : si la Russie s’effondrait militairement en Ukraine, que lui resterait-il, sinon son arsenal nucléaire ?
C’est l’argument que met en avant le penseur réaliste John Mearsheimer pour considérer que le risque de guerre nucléaire en Ukraine est sous-estimé par la majorité des analystes. Les Ukrainiens, soutenus par leurs alliés occidentaux, se trouvent en effet face à un lourd dilemme stratégique : ils doivent l’emporter sur le champ de bataille face aux Russes, mais en même temps, s’ils l’emportent, ils risquent de pousser la Russie, acculée, à l’escalade nucléaire. Dans ce schéma, plus l’Ukraine se rapprocherait d’une victoire conventionnelle, plus elle se rapprocherait d’une défaite nucléaire, laquelle pourrait alors prendre deux visages. Les puissances nucléaires occidentales (Washington, Paris et Londres) pourraient ne pas répliquer à une attaque nucléaire russe en Ukraine, qui serait ainsi vaincue par son asymétrie atomique avec la Russie. Inversement, et de façon plus apocalyptique, la guerre en Ukraine pourrait déraper dans un conflit thermonucléaire entre l’OTAN et la Russie, lequel ne laisserait derrière lui, bien sûr, aucun vainqueur. Pour Mearsheimer toujours, ce dilemme pourrait pousser les Occidentaux à chercher la voix d’un conflit gelé à l’issue duquel la Russie perdrait un peu, mais pas trop. Les alliés de l’Ukraine adopteraient ainsi leur soutien militaire pour rester sous le seuil au-dessus duquel Moscou déclencherait le feu nucléaire.
Il est étonnant de mesurer à quel point cet argument de Mearsheimer sur le risque d’escalade nucléaire, tout à fait critiquable, mais en même temps facilement audible, perce peu dans les opinions publiques occidentales. La peur d’une apocalypse nucléaire semble bien loin des esprits, qui se sont révélés beaucoup plus inquiets des conséquences pratico-pratiques de la guerre sur les prix de l’énergie. Pendant la guerre froide, le courant pacifiste donnait pourtant volontiers de la voix et plaçait le risque d’auto-annihilation nucléaire de l’humanité parmi les principales raisons de son inquiétude. Des années 1960 aux années 1980, les manifestations antiguerre ont rassemblé des centaines de milliers de personnes en Europe, par exemple 350 000 à Bonn en 1982 durant la crise des euromissiles pendant laquelle a émergé le slogan : « Plutôt rouges que morts ». Aucun mouvement d’ampleur issu de cette filiation ne s’observe depuis un an en Occident, comme si la bombe ne faisait plus peur, comme si le nucléaire ne conservait qu’un parfum suranné de guerre froide.
Plus peur de la bombe ?
Il y a bien eu quelques emballements médiatiques, pour le coup tout à fait irrationnel, au sujet de certaines armes nucléaires russes, mais dont le traitement sous forme de grand jeu spectacle révèle en creux l’inexistence d’une peur de fond qui agiterait les consciences. Le plus symbolique fut la pléthore d’articles consacrés au nouveau missile intercontinental russe Sarmat (aussi surnommé Satan 2), « capable d’atteindre Paris en 200 secondes » ou « pouvant rayer de la carte un territoire de la taille de la France », a-t-on pu lire ici ou là. Comme si l’on découvrait, trente ans après la fin de la guerre froide, que les ICBM allaient très vite et pouvaient faire très mal. On serait presque à deux doigts d’inventer la dissuasion nucléaire… L’erreur la plus grave consiste en réalité à surinterpréter la signification portée par ce missile et à écraser abusivement la chronologie, comme si tout se jouait depuis le 24 février 2022 seulement. Mais les deux essais d’un Sarmat (l’un officiellement réussi en avril 2022, l’autre raté en mars 2023 selon Washington) n’ont pas de rapport direct avec la guerre en Ukraine : la conception de ce colossal missile intercontinental de 35 mètres de long et de 18 000 km de portée a commencé dès 2009 et, après plusieurs années de retard, des essais ces derniers mois étaient attendus, et ce indépendamment du conflit en Ukraine. Pour la Russie, l’enjeu du Sarmat est à plus long terme : il s’agit de réussir à renouveler la composante terrestre de sa triade nucléaire de sorte à se protéger de percées à venir dans le domaine de la défense antimissile. À ce jour néanmoins, Moscou n’a pas besoin du Satan-2 pour raser Washington, Londres ou Paris de la carte. Ses ICBM Topol et Yars, actuellement en service, pourraient très bien s’en charger. Parmi les emballements médiatiques, l’on pourra encore citer l’avion du jugement dernier – l’Iliouchine Il-80, l’avion de commandement russe prévu notamment en cas de guerre nucléaire, équivalent au Boeing E-4B NOAC américain – et la torpille nucléaire Poséidon capable de déclencher des tsunamis radioactifs le long des côtes américaines.
À lire également
Guerre en Ukraine : étude des opérations non conventionnelles
À l’exception de cette quasi-promotion d’armes apocalyptiques russes et de quelques sentences inquiétantes de Vladimir Poutine ou de Dmitri Medvedev relayées un peu trop vite dans les médias, le nucléaire militaire n’apparaît donc pas réellement comme une grande peur qui agiterait les opinions publiques depuis le début de la guerre en Ukraine. La principale raison de cette insouciance se niche certainement dans l’expérience du franchissement des lignes rouges russes au cours de la guerre, lequel n’a pas, pour l’instant, engendré de réelle escalade de Moscou en représailles. On peut notamment citer l’envoi occidental d’artillerie lourde, en particulier les Himars, les frappes contre la Crimée annexée puis directement contre le territoire russe (même si elles ne sont pas revendiquées côté ukrainien), la livraison de chars de combat de fabrication occidentale (Challenger, Leopard et demain Abrams) et de missiles à plus longue portée (Shtorm Shadow, Harpoon), une attaque de drones contre le Kremlin (s’il s’agit bien des Ukrainiens et non d’une attaque russe sous faux drapeau) et même des incursions terrestres directes et revendiquées dans la région russe de Belgorod. En attendant les fameux chasseurs F-16 américains, qui pourraient venir allonger la longue liste des « lignes rouges » russes d’ores et déjà franchies. À l’endroit du risque d’escalade nucléaire, le raisonnement occidental semble être le suivant : « Jusqu’ici, tout va bien. » Une autre version de ce dicton, souvent racontée par le philosophe Jean-Pierre Dupuy, est l’histoire de l’espérance de vie d’une dinde américaine. Chaque jour qui passe lui donne une raison supplémentaire de croire qu’elle vivra le jour suivant. Le quatrième jeudi de novembre, jour de Thanksgiving, au réveil, nourrie de cette expérience, elle n’a jamais autant cru à sa survie. Et c’est ce jour-là qu’elle est mangée.
Le travers de ce raisonnement inductif consisterait à penser que, parce que les Russes n’ont pas escaladé nucléairement jusqu’ici, ils ne le feront pas demain. Le franchissement sans réponse des lignes rouges russes n’appelle pour l’instant que deux conclusions : d’une part, la question atomique a été jusqu’ici traitée rationnellement par les acteurs engagés dans une guerre se déroulant dans une « ambiance nucléaire » – la formule est de Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique – ; d’autre part, la Russie ne dispose pas à ce jour de moyens conventionnels pour mener une escalade non nucléaire en Ukraine.
Gestion de l’ambiance nucléaire
Concernant la gestion de la question nucléaire par les grandes superpuissances, là aussi, un « business » de la peur a poussé à accorder trop d’importance à certaines déclarations russes. Or, jusqu’à présent, ni le président russe, ni son ministre de la Défense, ni son chef d’état-major des armées – les « kremlinologues » estiment que l’emploi du feu nucléaire est décidé par le premier, en présence des seconds – n’ont formulé de réelles menaces nucléaires dans le cadre de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a en revanche plusieurs fois rappelé de façon plus ou moins détaillée les principaux fondements de la doctrine nucléaire russe. « Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition », a-t-il par exemple expliqué le 21 septembre 2022 dans son discours d’annonce de la « mobilisation partielle » de 300 000 soldats. Ce n’est évidemment ni anodin ni cordial, mais aucun de ces mots, en réalité, n’aura surpris quiconque. Si de réelles menaces nucléaires ont été prononcées, ce fut par des personnes n’ayant aucune autorité en la matière, à l’image du présentateur de télévision ultranationaliste Vladimir Soloviev. Aux États-Unis aussi, malgré la prédisposition de Joe Biden pour les gaffes, les règles de la grammaire nucléaire ont elles aussi été respectées scrupuleusement. En avril 2022, les États-Unis ont par exemple annoncé suspendre l’essai d’un ICBM Minuteman III pour « réduire les tensions nucléaires ». Dans leurs livraisons d’armes à l’Ukraine, les Occidentaux répètent également depuis plus d’un an qu’elles servent à défendre un territoire et non à attaquer la Russie. Dans cette volonté d’éviter une escalade, Emmanuel Macron est même allé trop loin aux yeux de beaucoup en décidant de sortir de toute ambiguïté stratégique quand il a déclaré le 12 octobre dernier que la France ne répliquerait pas à une attaque nucléaire russe en Ukraine.
Concernant l’absence de moyens conventionnels qui permettraient à la Russie d’escalader, la chose est aujourd’hui entendue. La Russie avait pourtant massivement investi le concept de dissuasion conventionnelle, laquelle devait renforcer la principale, nucléaire, en gommant les effets de seuil et le côté « tout ou rien » de l’atome. Concrètement, les missiles de croisière Kalibr tirés depuis la mer, la famille de missiles Iskander, les missiles hypersoniques Zirkon et Kinjal notamment devaient permettre à la Russie de pouvoir frapper rapidement, précisément et sans être interceptés des points névralgiques d’un territoire adverse. Et ce en entretenant en plus une ambiguïté volontaire puisque tous ces vecteurs peuvent emporter des charges conventionnelles ou nucléaires. Mais les campagnes de frappes russes dans la profondeur du territoire ukrainien ont montré leurs limites. À ce jour et malgré de nombreuses tentatives cet hiver, Moscou n’a pas été capable de paralyser les systèmes énergétique, logistique, de commande et de contrôle, et de défense aérienne ukrainiens. La Russie pourrait également chercher à entretenir l’escalade en augmentant les grandes masses sur le champ de bataille, mais, là encore, les capacités russes sont exploitées à un niveau certainement proche de leur maximum. Certes, même si cela aurait un coût politique certain, le Kremlin pourrait annoncer une nouvelle vague de mobilisation, mais l’armée russe dispose-t-elle encore du matériel nécessaire à l’équipement de ces hommes ? Il est permis d’en douter quand on observe l’âge toujours plus élevé des véhicules et des systèmes d’armes envoyés sur le terrain.
Capacité de dissuasion
La capacité de dissuasion conventionnelle des États-Unis, elle, est intacte. Dans la guerre en Ukraine, les Américains n’ont à aucun moment livré leurs armes à long rayon d’action les plus emblématiques comme les missiles de croisière Tomahawk ou les drones MQ-9 Reaper de type MALE (medium altitude long endurance). Et Washington a déjà suggéré assez explicitement qu’en cas d’attaque nucléaire tactique russe en Ukraine, la réponse américaine serait justement conventionnelle. De l’autre côté de l’Atlantique, dans une déclaration étonnamment ferme, le haut représentant de l’UE Josep Borrell a même affirmé le 13 octobre dernier qu’en pareil cas, Moscou devrait s’attendre à « une réponse militaire si puissante que l’armée russe serait anéantie ». Poutine est-il donc ainsi dissuadé d’employer l’arme nucléaire ? Un autre argument, et non des moindres, est le calcul coût-bénéfice dans une telle éventualité : des frappes nucléaires tactiques n’auraient qu’un intérêt militaire faible pour les Russes qui, en revanche, y perdraient lourdement sur le plan politique en risquant de se couper des puissances du Sud global, et notamment la Chine, qui pourraient abandonner leur position de neutralité voire de discret soutien à Moscou en cas de franchissement du seuil nucléaire.
À lire également
La guerre en Ukraine : une revanche de la géographie ?
Il faudrait pourtant se garder de laisser trop vite aux oubliettes de l’histoire la « peur de la bombe ». Car si l’on se décentre justement de la courte période de la guerre en Ukraine, le mouvement historique depuis 1991 dessine une longue et constante dégradation en matière de risque nucléaire, et qui a le travers de ne pas être spectaculaire, donc de ne pas passionner les foules. Les journalistes qui écrivent sur les questions de défense pourront témoigner d’une forme de frustration : le nucléaire peut susciter l’emballement du lecteur lorsque l’on est à « une minute de minuit » pour reprendre le titre d’un livre sur la crise des missiles de Cuba. Ce fut le cas durant la crise nucléaire avec la Corée du Nord en 2017 ou à certains moments d’effervescence depuis le début du conflit en Ukraine. Mais hormis ces moments d’acmé, l’actualité nucléaire, à la fois technique, juridique et abstraite, ennuie le lecteur. En vingt ans, l’architecture russo-américaine de contrôle et de réduction des armements issue de la guerre froide a littéralement implosé dans l’indifférence quasi générale du grand public. Il ne reste plus rien, aujourd’hui, de cette longue construction qui avait émergé depuis les années 1970 sous l’impulsion de dirigeants de puissances nucléaires inquiets d’être dépassés par la puissance des bombes qu’ils avaient entre leurs mains.
Maîtriser la peur
La déconstruction de ce cadre normatif a commencé outre-Atlantique avec le retrait unilatéral américain en 2002 du traité ABM (Anti-Balistic Missile) de 1972 qui limitait drastiquement la possibilité de déployer un bouclier antimissile. Puis, en 2019, sous Trump, les États-Unis sont sortis du traité INF (Intermediate Nuclear Forces) de 1988 qui interdisait le déploiement de tout missile terrestre (nucléaire ou non) d’une portée comprise entre 500 et 5 500 km. Washington estimait, et très certainement à raison, que les missiles russes Iskander-M ne respectaient pas ce bornage. Mais, surtout, les Américains ne souhaitaient plus se lier les mains avec un traité auquel la Chine n’est pas partie prenante, ce qui a permis à Pékin d’investir massivement dans ce créneau des « portées intermédiaires ». En 2020, les États-Unis quittent un nouveau traité, cette fois multilatéral, le traité Ciel ouvert de 1992, qui permettait un survol aérien des territoires des États signataires dans un objectif de renforcement de la transparence. Un an plus tard, les Russes leur embraient le pas. Enfin, les Russes ont annoncé cette année qu’ils suspendaient leur participation au principal traité nucléaire russo-américain, New Start, qui réduisait le nombre et le type d’armements nucléaires stratégiques tout en garantissant un certain nombre de procédures de vérification mutuelle. Ce traité de 2010 qui remplaçait les anciens traités Start I et Sort était déjà en sursis puisqu’il avait expiré en 2021 et ne tenait plus qu’à une extension de cinq ans négociée in extremis.
Cette déconstruction progressive du cadre juridique hérité de la guerre froide, en partie liée à la montée en puissance nucléaire de la Chine qui n’en fait pas partie, devrait susciter une peur rationnelle, ce qui n’est malheureusement pas le cas à une époque où le nucléaire militaire, parmi les grandes préoccupations, a quitté le devant de la scène politique et médiatique. Il y revient parfois, mais sous les atours d’un mauvais film apocalyptique, avec des personnages vendeurs comme Kim Jong-un ou Vladimir Poutine, et bien sûr en décor des armes terrifiantes qui permettent de feindre une panique bien inutile. Sur la route de l’atome, l’« heuristique de la peur » chère à Hans Jonas cherche encore son chemin.
À lire également