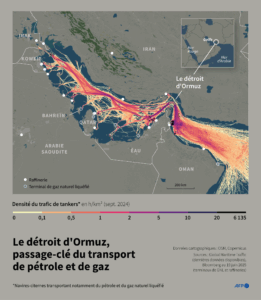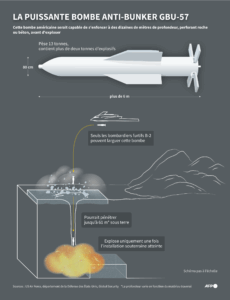L’immigration, une chance pour la France. Le titre de l’ouvrage de Bernard Stasi, paru en 1985, a fait polémique, d’autant plus qu’il récidive en 2007 avec un autre livre au titre encore plus tranché : Tous français ; l’immigration, la chance de la France. On peut toujours mettre la barre plus haut.
Positive, négative ? Le débat sur les effets de l’immigration est l’un des plus disputés et des plus embrouillés qui existent. Car de quoi parle-t-on ? Des effets économiques, sociaux, voire politiques de l’immigration ? De ses conséquences pour les pays de départ, d’accueil, de transit, ou pour le monde en général ? Pour les entreprises, les travailleurs, les consommateurs ? À court ou à long terme ? Ajoutez les principes tels que la liberté de circulation, la cohésion de la société ou la souveraineté des nations et vous vous retrouvez en face d’un bol de nouilles où il paraît impossible de distinguer les spaghettis trop cuits des tagliatelles al dente. Avançons donc prudemment, en séparant chaque bouchée.
Comptes publics…
Pour les pays d’accueil, la première clarification consiste à distinguer les effets de l’immigration sur l’économie en général et sur les comptes des administrations. Beaucoup des analystes confondent les deux, volontairement ou pas.
Pour les administrations, l’immigration est d’abord un coût. Il faut accueillir les migrants, les loger, leur apprendre la langue nationale, leur trouver un emploi, payer des indemnités pour les demandeurs d’asile, mettre leurs enfants à l’école, augmenter les dépenses régaliennes (police, justice) et certaines dépenses sociales (indemnités de chômage, allocations familiales) en proportion de l’afflux de nouveaux résidents. Ces sommes varient beaucoup d’un pays à l’autre : elles sont presque inexistantes dans quelques pays du Sud, mais il est vrai que l’immigration y ressemble à un esclavage moderne, ainsi dans les pays du Golfe volontiers donneurs de leçon. Elles sont contenues dans les pays où l’État-providence est moins développé comme aux États-Unis et elles atteignent un maximum dans les pays de l’Europe continentale.
A lire aussi: Entretien avec Julien Damon : campements de migrants en Europe
Qu’il s’agisse d’un coût net peut difficilement être contesté. En 2014, l’institut allemand ZEW concluait à un gain de 3 300 euros d’impôts par immigré (en incluant les cotisations sociales payées par ceux qui travaillent), mais Hans Werner Sinn président de l’IFO lui reprochait de ne pas inclure les dépenses de la collectivité comme les infrastructures ou la police (1). En les réintroduisant il estimait le coût global à 1 800 euros par immigré.
Au-delà des chiffres, un raisonnement simple suffit. Dans les pays développés existe une politique de redistribution sociale qui fonctionne en faveur des plus pauvres. Or l’immigration consiste justement à faire venir des individus majoritairement pauvres. La redistribution sociale ne peut que les favoriser soit en ponctionnant les revenus des autochtones, soit en augmentant la dette. Selon l’INSEE, les immigrés représentaient, en 2006, 7,5 % des dépenses de l’assurance maladie (un peu moins que leur part dans la population car ils sont plus jeunes), mais 12,6 % de celles de l’assurance chômage et 25 % de celles du RMI. Et en Suisse, selon une étude récente, 84 % des Somaliens et 54 % des Angolais et des Éthiopiens bénéficiaient de l’aide sociale contre 2,3 % des Suisses et, il est vrai, 0,6 % des Japonais. La solution est simple, ne laisser entrer que des migrants venant du Japon !
Les partisans de l’immigration avancent un autre argument : l’immigration serait un coût dans un premier temps, mais un gain à terme. Au fur et à mesure que les migrants s’intégreraient, ils trouveraient un emploi et cotiseraient à la sécurité sociale ; ils resteraient majoritairement de jeunes adultes, ils coûteraient donc moins en retraites et en soins que les autochtones ; plus actifs, ils seraient plus présents sur le marché du travail. Mieux, ils seraient seuls capables de financer les retraites des Français âgés. Après un premier temps où ils coûteraient globalement à la collectivité, ils contribueraient ensuite à équilibrer ses dépenses.
L’argument néglige trois faits. D’abord, il faut que les immigrés travaillent pour que ce vœu se réalise. Mais dans la plupart des pays européens, le taux de chômage des immigrés est supérieur à la moyenne nationale, souvent de 50 à 100 %. Ensuite, leurs femmes sont souvent moins actives (2). Enfin, les immigrés vieillissent, comme tout le monde. Ils seront un jour retraités et il faudra d’autres travailleurs pour payer leur retraite : de nouveaux immigrants en une sorte de fuite en avant perpétuelle ?
Notons qu’aux États-Unis le taux de chômage des migrants est proche de la moyenne nationale, à l’inverse de ce qui se passe en Europe. L’explication est simple : la protection sociale est beaucoup plus faible et les migrants ne peuvent compter sur elle pour survivre. Comme l’expliquait Milton Friedman, il faut choisir entre État-providence et immigration. Cette constatation explique les progrès en Scandinavie des populistes qui craignent le démantèlement de leur sécurité sociale.
…et économie nationale
L’apport de l’immigration à l’économie est un autre sujet. L’immigration fournit une main-d’œuvre doublement bon marché : la nation n’a pas eu à la nourrir et à la former jusqu’à son arrivée dans le pays d’accueil ; et elle réclame généralement des salaires inférieurs à la moyenne, mieux, elle accepte, selon la formule consacrée « les emplois dont les Français ne veulent pas ». Les deux formules ont la même signification car ces emplois sont délaissés justement parce qu’ils sont médiocrement payés.
L’immigration aurait ainsi permis de préserver des secteurs menacés par la concurrence extérieure, le textile autrefois, l’automobile ensuite. Force est cependant de constater que la résilience de ces activités n’a pas duré : il est toujours possible de trouver, sur la planète, un travailleur plus pauvre à exploiter. Les industries de main-d’œuvre ont continué de dépérir dans nos pays, elles ont été de plus en plus délocalisées tandis que se maintenaient (partiellement) les activités de moyenne ou haute technologie qui nécessitent une-main d’œuvre qualifiée que l’immigration ne fournit guère. Dès lors les migrations internationales fournissent de moins en moins de salariés pour l’industrie et de plus en plus pour le tertiaire. Pour maîtriser les salaires dans les usines, la délocalisation et la robotisation ; pour les contenir dans les bureaux ou les services banalisés, l’immigration.
On le comprend, les grands bénéficiaires de ce double mouvement sont les entreprises, grandes ou petites. L’immigration leur fournit des salariés qu’elles ne trouvent pas sur place, du moins avec les rémunérations qu’elles proposent. Elles peuvent donc augmenter leurs profits et maintenir des prix faibles dont profitent aussi les consommateurs.
A lire aussi: Agadez : la réduction des flux migratoires profitera-t-elle aux groupes islamistes ?
Restent les travailleurs. Qualifiés et non qualifiés. Les premiers ne sont guère menacés par l’arrivée d’étrangers ; moins bien formés, les immigrants ne les concurrencent guère sur le marché du travail, sauf dans quelques pays comme les États-Unis ; c’est pour cela que les programmes H1B qui facilitent l’arrivée des diplômés ont été fortement réduits, les syndicats les trouvant excessifs. Le problème existe moins en Europe où les migrants sont moins qualifiés. De même George Borjas a démontré que l’arrivée de nombreux mathématiciens russes aux États-Unis avait contribué à bloquer la carrière des mathématiciens américains. Quant aux travailleurs peu qualifiés, ils sont soumis à une concurrence accrue qui les affecte.
Les économistes progressistes notent cependant que les migrants occupent massivement les emplois peu qualifiés, permettant aux nationaux de se concentrer sur des emplois plus qualifiés. Les nationaux progresseraient ainsi dans l’échelle sociale et leurs rémunérations s’élèveraient… à condition que leur formation leur permette d’effectuer des tâches plus complexes.
Les enquêtes sur ce sujet se croisent et se contredisent. Il semble pourtant qu’un nombre croissant d’analystes se rallie aux thèses de George Borjas : les travailleurs peu qualifiés sont les perdants d’un mécanisme dont profitent les entreprises, les consommateurs, les cadres supérieurs et les migrants.
Restent les effets sociaux de l’immigration. Paul Collier insiste sur ce point. Reprenant les arguments de Robert Putnam, il estime que le multiculturalisme réduit la confiance mutuelle et la tendance à la coopération entre les différentes communautés, faute d’un sentiment identitaire commun. La société se fractionne, la solidarité nationale se délite, les individus refusent de payer plus d’impôts pour des migrants trop différents d’eux. Vision pessimiste et caricaturale, direz-vous ? Mais regardez, ils ne sont même pas prêts à vivre à côté d’eux, à envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles et à se soumettre aux mêmes règles de vie qu’eux. La disparition du lien national se constate au niveau local avec la séparation spatiale entre les communautés.
Et la nation ? Et le monde ?
L’afflux de travailleurs bon marché ne peut être qu’une bonne chose pour l’économie d’un pays, semble-t-il. Elle réduit les coûts de production et rend plus compétitif. Elle permet même tout simplement de maintenir la force de travail dans des pays où la population commence à diminuer et diminuera encore plus demain. Encore faut-il, nous l’avons déjà dit, que ces migrants trouvent un travail. Encore faut-il aussi que l’embauche d’immigrés ne constitue pas une solution de facilité qui dispense les entreprises d’accomplir des efforts en termes de productivité et plus encore de qualité des produits. Appuyer la compétitivité sur les bas salaires est une politique de court terme. À l’inverse, l’Allemagne dès les années 1960, le Japon dans les années 1970-1980 et la Chine aujourd’hui, qui étaient au départ des pays à bas salaires, ont réalisé une montée en gamme qui les a enrichis. Les pays qui ont largement eu recours à l’immigration connaissent des déficits commerciaux structurels – États-Unis, Royaume-Uni ou France (3) – est-ce un hasard ?
Ajoutons que ces migrations pèsent sur l’environnement. Elles supposent des voyages pour venir dans le pays d’accueil, mais aussi des allers-retours lors des vacances. Les mouvements écologistes anglo-saxons s’inspirant des théories de la Zero Growth Population comme Population Connection entendent stabiliser la population d’un pays en prenant en compte le solde naturel et les migrations. Une population qui augmente, pensent-ils, pèse sur les équilibres environnementaux et l’immigration contribue à cette hausse. Bien sûr, comme progressistes, ils ne peuvent la dénoncer, mais leur raisonnement et leur mode de calcul contribuent à la présenter de façon négative.
It is not economy, stupid
Il faudrait tenir compte de bien d’autres impacts. Le fait est que l’immigration a radicalement changé depuis les années 1970 ; les distances entre les sociétés de départ et d’accueil se sont accrues, que l’on parle en kilomètres ou en écarts culturels. L’assimilation ne semble plus possible, on ne peut plus demander aux étrangers d’abandonner leurs traditions et d’adopter celles du pays d’accueil (« A Rome, fais comme les Romains »). On peut tout juste réclamer l’intégration, c’est-à-dire l’acceptation des lois du pays-hôte, et encore, si elles ne sont pas trop sévères… À l’inverse, le modèle communautariste anglo-saxon progresse : quotas pour les minorités techniques, acceptation de leurs règles vestimentaires, refus de toute critique envers elles, adaptation à leurs pratiques alimentaires dans les écoles… « Ils sont chez eux chez nous », déclare François Mitterrand, à Rennes en avril 1988, en parlant des enfants d’immigrés ayant obtenu la nationalité française à leur majorité. Personne n’a jamais relevé l’ambiguïté de la formule car elle sous-entend que ces immigrés de la seconde génération ont un « chez eux » qui n’est pas le « chez nous ».
Jérôme Fourquet parle d’un « archipel français » de plus en plus éclaté. L’immigration n’en est pas la seule cause, mais elle y participe, d’autant plus qu’une grande partie des autochtones a le sentiment d’être délaissée au profit des migrants. Le sort des SDF n’avait pas entraîné des réactions aussi spectaculaires que celles provoquées par l’afflux récent des migrants, qu’il s’agisse d’ouverture de bâtiments publics, de relogement dans des centres spécialisés ou de déplacement en province. Parallèlement, la ségrégation spatiale devient la règle et elle révèle les fractures et même la schizophrénie d’une grande partie de la société française. Les populations aisées des grandes agglomérations proclament leur attachement au « vivre ensemble », mais elles se gardent de le pratiquer – plusieurs films s’en sont amusés.
A lire aussi: Siméon II de Bulgarie : « Ayant été un réfugié, je sais ce que c’est…» Entretien
Dans son même discours du 8 avril, Mitterrand notait : « Il n’y aura pas de cohésion, de grandeur nationale, sans cohésion sociale. » Au vu des clivages de la société auxquels l’immigration a contribué, le pays est sur la mauvaise pente.
Et les pays de départ ?
Les difficultés des pays d’accueil sont-elles compensées par les progrès des pays de départ ? Tout dépend, encore une fois, du point de vue.
L’émigration réduit la pression démographique. Elle apporte des remises ou « remesas » car les émigrés expédient une partie de leurs revenus dans le pays d’origine. Des sociétés envoient une partie de leurs jeunes à l’étranger dans ce but, ainsi la région de Kayes dans l’ouest du Mali. Le montant de ces transferts atteint, en 2017, 466 milliards de dollars, deux à trois fois l’aide internationale, les deux tiers des flux d’investissement direct vers le Sud (4). Il s’agit donc de sommes considérables qui peuvent représenter près de la moitié du PIB du pays (Tadjikistan), mais qui sont beaucoup plus importantes, en chiffres absolus, dans les grands pays comme l’Inde, la Chine, les Philippines, le Mexique ou le Nigeria.
Ces sommes ont l’avantage d’aller directement aux familles restées sur place : elles améliorent leur niveau de vie et leur offrent des opportunités. On a calculé qu’au Salvador une famille bénéficiant de remises voit les chances de ses enfants d’aller à l’école multipliées par 10 ! Le retour des émigrés peut aussi être bénéfique s’ils se sont formés à l’étranger. On comprend que certains planifient leur émigration, la Tunisie autrefois ou les Philippines qui ont mis en place une Labor Export Policy. Quant à l’Érythrée, elle taxe lourdement ses expatriés.
Ces gains sont compensés par un déséquilibre démographique : les villages se vident de leurs jeunes hommes adultes, sauf si la famille suit. Par ailleurs, les familles reçoivent les transferts des migrants sans rien fournir en échange ce qui n’est guère dynamisant ; en fait les remesas fonctionnent comme une rente, elles encouragent l’inflation (5) et nuisent à la compétitivité du pays de départ.
Le pire est la « fuite des cerveaux » et plus généralement la fuite des capacités. Non seulement ce sont des jeunes adultes qui partent prioritairement, mais souvent les plus qualifiés, ceux qui parlent une langue étrangère ou qui bénéficient de talents particuliers qu’ils espèrent monnayer. Beaucoup de pays du Nord encouragent leur venue en instaurant des quotas qui privilégient les diplômés.
Le terme brain drain, qui désigne ce phénomène, est apparu dans les années 1950 pour désigner le départ vers les États-Unis de médecins anglais, mécontents de la mise en place chez eux d’un système de sécurité sociale qui les encadrait. Ses conséquences ont été particulièrement dramatiques dans le cas de la RDA qui perdait toute sa main-d’œuvre qualifiée au profit de la RFA. C’est pour l’enrayer que fut construit le mur de Berlin. Les pays européens restent concernés par le phénomène : la Commission européenne a estimé que 400 000 chercheurs européens travaillent aux États-Unis. Ces départs sont compensés par l’arrivée de chercheurs du Sud ou de l’Est et un circuit de pompage de l’intelligence se met en place à travers la planète. Parmi les pays où les départs sont les plus importants, ceux de l’ancienne URSS, l’Inde, la Chine, les Philippines, mais aussi le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France.
La perte de matière grise prive les économies dites « en développement » de la main-d’œuvre qui permet le développement. Au Ghana, les trois quarts des diplômés en médecine quittent le pays dans les dix ans qui suivent leurs études. En Guyana, les trois quarts des diplômés partent à l’étranger. Un grand nombre des anciens étudiants des Indian Institutes of Technology partent aux États-Unis, beaucoup y créent des entreprises ; dès 1992 est créé à San Jose l’IndUS Entrepreneurs. Le dynamisme de la Silicon Valley est irrigué par les eaux du Gange. Pendant ce temps les firmes indiennes manquent de la main-d’œuvre la plus qualifiée.
La fuite des cerveaux n’est pas toujours négative. Oded Stark parle en retour d’un brain gain. Les expatriés font travailler les entreprises de leur pays de naissance en sous-traitance, l’Inde doit à cette pratique l’essor de ses services informatiques. Certains pays encouragent le retour au pays de ces « tortues de mer », comme disent les Chinois. À Taiwan, le parc scientifique de Hsinchu, fondé en 1980, accueille une moitié d’entrepreneurs formés aux États-Unis. À un niveau plus modeste, le ministère de la Communauté marocaine encourage de tels retours.
Le lecteur constatera cependant que les effets les plus positifs du départ des « cerveaux » se produisent quand, et si, ils reviennent au pays.
Le fond du problème
Le brain drain le démontre : certains migrants sont recherchés dans le Nord. Il s’agit d’abord des travailleurs qualifiés et de nombreux pays, surtout anglo-saxons, ont mis en place des systèmes de quotas qui les favorise. Aux États-Unis, il s’agit entre autres du visa H1B mis en place en 1990 ; il a permis l’entrée de 180 000 salariés en 2017. D’autres programmes favorisent les riches. Ainsi le gouvernement Cameron, qui voulait réduire les flux migratoires drastiquement, a-t-il assoupli les règles en ce qui concerne les investisseurs au Royaume-Uni (février 2011) : le délai pour l’obtention d’un visa est réduit à deux ans pour ceux qui placent dans le pays plus de 10 millions £ (contre 5 auparavant). Le Portugal a créé un « visa d’or » aux caractéristiques proches. Dans un esprit comparable, de nombreux pays européens vendent leurs visas – le premier pays à adopter cette pratique est la Lettonie en 2010.
A lire aussi: God save the Anglo-Saxons
Les autres migrants, non qualifiés et pauvres, ne bénéficient pas de telles attentions. Les pays, qu’ils soient du Nord ou du Sud, s’efforcent généralement de les tenir à l’écart. Certains souhaitent pourtant les accueillir. C’est le cas des ONG et de certaines Églises qui militent pour l’accueil de ces faibles parmi les faibles. Elles entretiennent une vision christique qui a fait du colonisé, puis du prolétaire, enfin du réfugié, une figure de l’humanité souffrante et rédemptrice en même temps. Les militants humanitaires démontrent ainsi leur supériorité morale tout en servant leurs intérêts : une cause si juste mobilise leurs membres et leur apporte dons et subventions.
Mieux, si l’on en croit les accusations du ministre de l’Intérieur français Christophe Castaner, certaines ONG se mettent en relation avec les passeurs au large de la Libye pour recueillir les migrants dès qu’ils ont quitté les eaux internationales au risque de développer une « réelle collusion » avec eux. Il confirme ainsi une enquête parlementaire italienne de mai 2017. Toute une économie de l’immigration se met ainsi en place, alimentée d’un côté par les subventions qui rémunèrent les permanents des ONG, les avocats de l’assistance judiciaire, les entreprises qui bâtissent les logements d’accueil, le personnel qui accueille, encadre et forme les migrants ; et de l’autre, par les migrants et leurs familles qui paient les passeurs.
L’imbrication des sentiments généreux, des intérêts personnels et de la prédation des mafias semble paradoxale. Elle illustre la complexité du problème des migrations internationales.
- En 2010, le ministère des Affaires sociales avait commandé à une équipe de chercheurs de l’Université de Lille une étude sur le coût de l’immigration qui commettait le même « oubli » et concluait aux « très bons comptes de l’immigration » selon le titre repris par la plupart des journaux.
- Rappelons qu’actif signifie qui travaille ou recherche un emploi.
- Reste que l’Allemagne et le Japon se sont ouverts à l’immigration ensuite.
- Pour 2017, la CNUCED les estime à 660 milliards, toutes origines confondues.
- La demande progresse grâce à ces revenus sans que la production, donc l’offre progresse.
- Source : Tendances des migrations internationales, ocde, 2004. Des études plus récentes confirment cette hiérarchie.