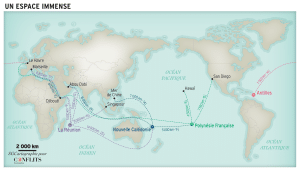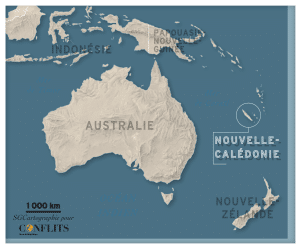L’Inde ne donne jamais à ses opérations militaires des noms au hasard. Lorsque l’état-major annonce l’« opération Revanche de Sindoor », le choix fait immédiatement résonner un imaginaire profondément ancré dans l’histoire culturelle et religieuse du sous-continent.
Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée
Le sindoor, poudre rouge que les femmes hindoues appliquent dans la raie de leurs cheveux, est traditionnellement le signe de leur mariage, un engagement rituel envers l’époux, un pacte de fidélité à vie. En choisissant ce symbole intime pour baptiser une offensive militaire, et en rajoutant le terme de revanche, les autorités indiennes font plus qu’un effet rhétorique : elles activent une mémoire collective, une sensibilité mythico-politique dans laquelle la patrie n’est pas une abstraction territoriale, mais une épouse sacrée, une mère bafouée, une déesse à venger. L’opération se présente donc comme un geste de réparation rituelle. L’honneur violé appelle le feu.
Ce lien entre territoire, corps féminin et sacré est une construction moderne, apparue au xixe siècle, à l’époque où le nationalisme indien cherchait une forme d’incarnation face à un colonialisme britannique croissant.
Le nationalisme et le colonialisme
Dans l’Inde coloniale du xixᵉ siècle, alors que l’autorité britannique s’affirme sur l’ensemble du sous-continent, une forme singulière de résistance se développe au sein des cercles intellectuels, littéraires et religieux : l’émergence de la figure de Bharat Mata, ou « Mère Inde », l’image d’une Inde féminisée, sacralisée, exaltée, mère divine, incarnation de la terre à libérer et à vénérer.
En Inde contemporaine, cette personnification de la nation indienne sous les traits d’une déesse s’inscrit dans une quête identitaire profonde. À une époque où l’Inde n’est pas encore un État, ni même unifié politiquement, ce nouvel objet façonne une représentation symbolique de la patrie, capable de susciter l’adhésion émotionnelle et morale des masses.
Ce phénomène évolue et se cristallise à la croisée de plusieurs influences. D’un côté, la tradition hindoue, dont le panthéon abonde en figures féminines puissantes. De l’autre, le romantisme nationaliste européen, qui inspire aux élites indiennes la nécessité de représenter la nation comme une entité organique et sacrée. La mère-patrie devient ainsi un symbole fédérateur dans une société traversée de divisions religieuses, géographiques, linguistiques et sociales.
Dans l’univers hindou, l’idée d’une divinité liée à la terre est ancienne. Mais c’est véritablement au cours du xixᵉ siècle que cette idée prend une forme politique explicite.
En 1870, Bankim Chandra Chatterjee compose le roman Anandamath, dans lequel il introduit l’hymne Vande Mataram, littéralement « Je te salue, Mère ». Ce chant glorifie la terre indienne sous les traits d’une déesse guerrière, à la fois nourricière et protectrice, inspirée des figures de Durga et Kali. Très vite, Vande Mataram devient un hymne révolutionnaire, repris lors des soulèvements contre les Britanniques. La littérature joue donc un rôle essentiel dans la formation de cette imagerie sacrée et patriotique.
À lire aussi : Cinéma et propagande : le cas de l’Inde
Le symbole de Bharat Mata
La symbolique de Bharat Mata se renforce avec l’essor du mouvement Swadeshi, lancé en réaction à la partition du Bengale en 1905. Dans ce contexte, le nationalisme prend une coloration résolument spirituelle : boycotter les produits britanniques, c’est non seulement un acte politique, mais aussi un geste de dévotion envers la mère-patrie opprimée. L’artiste Abanindranath Tagore (père de Rabindranath), figure du renouveau artistique indien, cristallise cette symbolique en peignant en 1905 une représentation célèbre de Bharat Mata : une femme vêtue de safran, tenant un livre, un chapelet, du tissu et du riz, objets qui renvoient à la sagesse, à la prière, à l’autonomie économique et à la subsistance. Cette image devient un modèle largement diffusé à travers affiches, calendriers, manuels et objets de piété profane.
Mais cette sacralisation n’est pas sans ambiguïté. Si la figure de Bharat Mata parvient à souder certaines couches de la population hindoue autour de l’idéal national, elle cristallise aussi des fractures. Car son ancrage dans l’iconographie religieuse hindoue, ainsi que le recours à des termes et des rites issus du brahmanisme, suscite méfiance ou rejet de la part des musulmans, des chrétiens et des castes qui ne se reconnaissent pas dans cette imagerie. Ce conflit symbolique n’est pas anodin : il annonce les tensions identitaires qui traverseront le nationalisme indien jusqu’à l’indépendance et au-delà. En glorifiant l’Inde sous les traits d’une déesse, le mouvement nationaliste hindouiste réinvente la politique sous le registre du sacré, mais il contribue aussi à reléguer au second plan les conceptions plus laïques, pluralistes ou civiques de la nation.
Ce corps sacré, on cherche bientôt à l’adorer comme on vénère une divinité. En 1936, à Varanasi, haut lieu de l’hindouisme, un temple est inauguré en l’honneur de Bharat Mata. Il ne contient pas d’idole classique, mais une immense carte en relief de l’Inde sculptée dans le marbre, comme si l’on avait voulu transformer la géographie en chair divine. C’est le premier lieu où l’on prie non pour soi, mais pour la nation.
À lire aussi : Vârânasî : le cœur battant de l’Inde
Le drame de la partition
C’est dans ce cadre que la partition de 1947 prend, pour les nationalistes hindous, une signification tragiquement incarnée. La division de l’Inde, vécue comme une mutilation territoriale, voire un viol, devient dans le mythe une amputation du corps sacré de Bharat Mata. Le Pakistan, né de cette séparation, est perçu comme le ravisseur d’une partie du corps de la mère, voire comme son profanateur.
Dans ce contexte, le sindoor joue un rôle inattendu. Rituel intime, geste discret du quotidien féminin, il devient dans les années 1990 et 2000 un marqueur politique. Des campagnes nationalistes montrent des femmes appliquant du sindoor sur des cartes de l’Inde, des portraits de Bharat Mata, ou sur les fronts des soldats. Le geste, réservé à l’époux, est transféré à la nation. L’épouse ne se dévoue plus seulement à son mari, mais à la patrie. Elle devient son époux spirituel, son dieu protecteur. Et inversement, toute agression contre le territoire devient une atteinte à l’ordre conjugal. Dès lors, prendre les armes pour Bharat Mata revient à venger l’honneur d’une épouse bafouée.
L’opération Revanche de Sindoor puise dans ce réservoir symbolique. Elle n’est pas une action isolée, mais la continuité logique d’un récit mythologique construit depuis plus d’un siècle. Dans ce récit, l’Inde est une déesse-mère menacée, dont l’intégrité géographique et morale est sans cesse contestée par des forces extérieures, principalement le Pakistan, mais aussi les minorités perçues comme étrangères au projet hindou. En désignant l’affront comme un viol symbolique du sindoor, l’État sacralise la riposte : il ne s’agit plus seulement de gagner une guerre, mais de laver une honte, de rétablir une pureté, de sceller à nouveau le pacte entre la terre et ses enfants.
La guerre devient un rite
Sous le gouvernement de Narendra Modi, la figure de Bharat Mata devient le cœur symbolique d’une idéologie politique structurée, où l’identité nationale se confond avec une forme sacralisée d’hindouité. Ce culte constitue un levier puissant de mobilisation et de légitimation du pouvoir. Le slogan Bharat Mata ki Jai (« Victoire à la Mère Inde »), autrefois marginal, devient sous Modi un refrain national, scandé dans les écoles, les stades, les meetings politiques.
C’est là que le culte se mue en instrument de gouvernement. En s’identifiant à Bharat Mata, Modi endosse le rôle de fils dévoué, de protecteur prêt au sacrifice. Il ne gouverne pas comme un chef élu au suffrage universel, mais comme un serviteur de la Mère sacrée.
Cette sacralisation du politique ne reste pas cantonnée à la rhétorique. Dans les discours officiels, les minorités sont appelées à prouver leur loyauté non à une constitution pluraliste, mais à une entité transcendante, indéfinie et exigeante : la Mère Inde.
Plus largement, toute opposition à la politique du BJP peut être codée comme une atteinte à la dignité de la mère-patrie. Le dissident devient un traître, le musulman un suspect, le journaliste un blasphémateur. L’espace public s’organise alors comme un temple national, dans lequel le pouvoir définit seul les règles du culte : qui peut parler, qui peut croire, qui peut critiquer.
Ainsi, sous Modi, le culte de Bharat Mata n’est pas un simple ornement du nationalisme. Il est l’un de ses piliers, à la fois langage, justification et horizon. Il permet de réenchanter le pouvoir, d’assigner des rôles symboliques aux citoyens, et de redessiner les frontières de l’appartenance. Il transforme la politique en liturgie, la nation en sanctuaire, et le patriotisme en foi.
À lire aussi : Les forces militaires en Inde et au Pakistan : comparaison et enjeux stratégiques