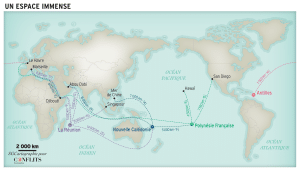En Iran, la crise de l’eau ne résulte pas d’un simple aléa climatique, mais d’une combinaison de choix politiques erronés, de stratégies agricoles idéologiques et d’une gestion opaque des ressources. Derrière les pénuries récentes se cache une impasse structurelle : celle d’un modèle de développement qui a sacrifié la durabilité au nom de l’autosuffisance et de la sécurité.
L’Iran traverse actuellement une crise hydrique sévère. Depuis plusieurs semaines, les coupures d’eau se multiplient dans la capitale, Téhéran, ainsi que dans de nombreuses provinces, à tel point que les autorités ont été contraintes de déclarer un jour férié national afin de freiner la consommation d’eau et d’électricité. Cette décision inédite, prise fin juillet 2025, témoigne de l’ampleur du désastre. Dans certains quartiers, l’eau ne coule plus des robinets pendant plus de douze heures consécutives, forçant les habitants à stocker, rationner ou acheter de l’eau à prix fort. Les barrages approchent de niveaux critiques, certains réservoirs tombant à moins de 10 % de leur capacité.
Une crise de l’eau
Il est légitime de s’interroger sur le rôle que peut jouer la propagande anti-iranienne dans la perception, et peut-être dans l’amplification médiatique, de cette crise. De nombreux médias ont récemment relayé des images spectaculaires de réservoirs à sec, de coupures massives ou de manifestations locales contre les autorités. Ces représentations s’inscrivent dans un climat général de défiance vis-à-vis de la République islamique, où chaque crise intérieure est interprétée comme un signe de faiblesse du régime, voire, pour certains, comme l’annonce de son écroulement.
Cela étant dit, il serait excessif de réduire l’ampleur de la crise à une simple construction médiatique. Les données hydrologiques disponibles, les observations satellitaires, les rapports d’experts iraniens comme Nasser Karami, climatologue et géographe iranien et professeur associé à l’Université de Bergen (Norvège) spécialisé dans les liens entre totalitarisme et environnement, ainsi que les témoignages de la population convergent tous vers le même constat : l’Iran fait face à une raréfaction profonde et durable de ses ressources en eau. La crise est bien réelle, structurelle, et ne date pas de la saison sèche actuelle. Elle s’inscrit dans une trajectoire ancienne, marquée par plusieurs épisodes hydriques majeurs, dont certains présentent des similitudes frappantes avec la situation actuelle.
L’une des crises les plus marquantes a eu lieu entre 2013 et 2015, lorsque de vastes régions du pays, notamment le Khouzistan, le Sistan-Baloutchistan, Ispahan et Kerman, ont été confrontées à une sécheresse prolongée et à des coupures d’eau régulières. Cette période a été marquée par l’effondrement du niveau du lac Ourmia, autrefois l’un des plus grands lacs salés du Moyen-Orient, dont plus de 90 % de la superficie avait disparu à la suite du détournement de ses affluents pour l’agriculture et de leur capture en amont par une série de barrages.
Un autre épisode marquant s’est déroulé à l’été 2021, notamment dans le Khouzistan, région stratégique et riche en pétrole, mais victime de l’assèchement quasi total de ses rivières, comme le Karkheh et le Karoun. Cette crise, aggravée par la défaillance des réseaux d’irrigation, a entraîné la perte de bétail et l’exode de milliers de foyers paysans. Des manifestations massives ont alors éclaté contre les pénuries d’eau, parfois violemment réprimées. Ce fut un tournant dans la politisation de la question hydrique. Certains slogans établissaient un lien direct entre la pénurie et la gouvernance du régime : « L’eau est notre droit », « Ni Gaza ni le Liban, je me bats pour l’Iran ».
Tensions autour de l’eau
En 2022–2023, de nouvelles tensions ont éclaté dans les provinces centrales, notamment à Ispahan. Des agriculteurs ont manifesté sur le lit asséché du Zayandeh Rud, dénonçant les détournements d’eau au profit d’industries proches du pouvoir, avec le soutien d’une partie de la population urbaine. Les secteurs visés sont principalement les industries lourdes, comme la sidérurgie, la pétrochimie, la cimenterie et agro-industrie. Ces installations sont concentrées dans des régions critiques du point de vue hydrique, en particulier autour d’Ispahan.
Un exemple emblématique est celui de l’usine sidérurgique de Mobarakeh, l’un des plus grands complexes de la région. Elle consomme d’importantes quantités d’eau alors que le Zayandeh Rud est fréquemment à sec. Son conseil d’administration a longtemps été dominé par des personnalités liées aux Gardiens de la Révolution (Pasdaran) et au Bonyad-e Mostazafan, une fondation parapublique puissante agissant comme un conglomérat semi-étatique. L’entreprise a fait l’objet d’accusations de corruption, de clientélisme et de favoritisme fiscal de la part de députés et d’organismes de contrôle.
À première vue, la crise pourrait sembler relever de facteurs climatiques. L’Iran est en effet frappé par une sécheresse persistante. Les précipitations annuelles ont chuté d’environ 25 %, passant de 250 à 150–200 mm par an, et les températures dépassent régulièrement les 50 °C dans certaines régions, accentuant l’évaporation et fragilisant les infrastructures hydrauliques. Les cours d’eau s’amenuisent, les nappes phréatiques sont surexploitées, et les réservoirs naturels et artificiels s’assèchent. Plus grave encore : certains réservoirs fossiles, c’est-à-dire des nappes d’eau souterraine formées il y a des millénaires et non renouvelables, sont proches de l’épuisement.
Les aquifères profonds
Ces aquifères profonds, situés dans des formations géologiques anciennes, ne sont pas rechargés par les précipitations actuelles. Leur prélèvement, intensifié depuis les années 1980 pour compenser le déficit de surface, s’est accéléré avec la multiplication de puits profonds, légaux ou non, dans des régions comme le Khorasan, le Yazd, le Sistan-Baloutchistan ou le plateau central. D’abord perçu comme un levier de développement rural, leur usage massif repose sur une illusion : celle d’une ressource abondante et invisible. L’État a soutenu ce modèle en subventionnant les forages, souvent attribués par favoritisme, et en laissant se développer un usage incontrôlé des pompes électriques bon marché.
Ces prélèvements ont été mis au service de cultures particulièrement inadaptées au climat local. Dans le Khorasan, on a planté du blé, de l’orge et du coton, une culture très gourmande en eau. À Rafsanjan, sur le plateau central, l’essor des vergers de pistachiers, produit d’exportation lucratif, est reposé sur un pompage intensif. À Yazd et à Birjand, des cultures de pommes, grenades, raisins ou pastèques ont été maintenues artificiellement. Dans certaines zones du Sistan-Baloutchistan, on a même tenté de cultiver du riz, ce qui relève d’une absurdité agronomique dans une région où la température excède les 50 °C et les précipitations annuelles sont inférieures à 100 mm.
Selon des estimations officielles et les travaux de Nasser Karami, plus de 70 % des réserves souterraines exploitables ont déjà été extraites dans plusieurs régions. La vitesse de pompage dépasse de loin les capacités de renouvellement. L’épuisement de ces nappes entraîne des effets spectaculaires : affaissements de terrain (subsidence), salinisation des sols, assèchement des puits, désertification. À Yazd ou Rafsanjan, des dizaines de villages ont vu leurs puits devenir inutilisables, contraignant les habitants à fuir ou à dépendre de livraisons par camions-citernes.
Ce modèle, pourtant manifestement non viable, s’est maintenu, car il servait des objectifs politiques à court terme : paix sociale, illusion d’autosuffisance, captation de rentes. Il incarne ce que Karami dénonce comme un « gaspillage organisé » de l’avenir. L’Iran, selon lui, n’a pas manqué d’eau : il a dilapidé son capital hydrique par refus de penser la relation entre climat, agriculture et ressource.
Moins d’eau et plus de population
Cette impasse est d’autant plus dangereuse que la croissance démographique et l’urbanisation ont considérablement accru la demande. Le phénomène dépasse la seule question des nappes fossiles. Des centaines de milliers de puits, souvent illégaux, épuisent les nappes phréatiques sans aucun contrôle. La prolifération de ces forages a contribué à la désertification de vastes zones.
Parallèlement, la politique de construction de barrages, engagée dans les années 1980, a aggravé la situation. De nombreux ouvrages ont été mal conçus. Le barrage de Gotvand (situé sur le fleuve Karun dans la province de Khuzestân), par exemple, construit sur des terrains salins a contaminé l’eau en aval. Cette pollution saline a conduit à la mort de centaines de milliers de palmiers dans la région, à la dégradation des terres agricoles (jusqu’à plusieurs milliers d’hectares touchés) et à une désertification progressive. Ce fiasco aurait coûté plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des projets hydrauliques les plus coûteux d’Iran, sans compter les coûts écologiques et sociaux considérables qu’il a engendrés. D’autres projets ont privé des bassins entiers de leur alimentation, provoquant la disparition de rivières et de zones humides.
Le cœur du problème est la stratégie agricole du régime. Depuis la guerre Iran-Irak, la République islamique poursuit une politique d’autosuffisance alimentaire, justifiée par l’indépendance stratégique. Cette orientation a conduit à l’expansion de cultures très consommatrices d’eau (blé, riz, betterave à sucre, maïs) dans des zones inadaptées. L’agriculture consomme aujourd’hui près de 80 % de l’eau extraite, pour un rendement faible et des pertes massives liées à l’évaporation et à l’inefficacité des méthodes d’irrigation. En 2024, ce secteur représentait environ 13 % du PIB iranien, en légère hausse par rapport à 12,8 % en 2023. En 2022, 15,1 % de la population active travaillait encore dans l’agriculture, un chiffre en recul par rapport aux années 1990 (où le taux avoisinait 25 %), mais élevé en comparaison international. Aux États-Unis, seul 1,4 % de la population active est dans l’agriculture, 2,5 à 3 % en France, 1,2 % en Allemagne, 3,2 % au Japon. Seule la Turquie présente un taux comparable, autour de 17,6 %. En Inde (42–45 %) ou en Égypte (20–22 %), l’agriculture reste majoritaire dans l’emploi.
La politisation de la gestion de l’eau en Iran est accentuée par le rôle des Pasdaran. À travers leur conglomérat Khatam al-Anbiya, ils contrôlent des projets hydrauliques, des réseaux d’irrigation et des terres agricoles. Cette emprise leur permet non seulement de drainer des financements, mais aussi d’allouer l’eau selon des critères politiques. Certaines provinces jugées loyales bénéficient d’un approvisionnement prioritaire, tandis que d’autres sont régulièrement marginalisées. L’eau devient ainsi un instrument de contrôle social.
Nasser Karami insiste sur cette dimension structurelle. Pour lui, la crise actuelle est « fabriquée » par des décennies de politiques irrationnelles, de déni environnemental et de logique sécuritaire. Le régime, au lieu de réformer son modèle agricole, a préféré militariser la production alimentaire dans une logique de siège, quitte à sacrifier les ressources vitales du pays. Résultat : les réserves sont à bout, la population est à bout, et la réforme de l’allocation hydrique devient une nécessité vitale que l’État, pour des raisons idéologiques, semble incapable d’engager.
Sans changement profond de l’usage de l’eau, de la structure agricole, et de la gouvernance des ressources, l’Iran risque de basculer d’une pénurie chronique à une crise systémique, économique, sociale et politique aux conséquences difficilement prévisibles.