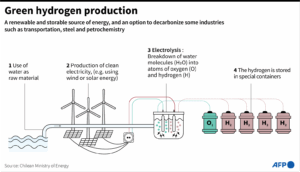Curieuse Italie : bordée par la mer, mais sans réelle puissance maritime. Avec une faible tradition étatique, mais un véritable sentiment national et une industrie manufacturière puissante. Décidément, l’Italie est bien différente de la France. Entretien avec Federico Petroni, rédacteur à la revue Limes, pour tenter d’éclairer la nature de cette puissance méconnue.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé.
Limes est l’une des revues de géopolitique les plus influentes en Europe. On connaît les écoles de géopolitique françaises, anglo-saxonnes et allemandes, mais existe-t-il une école italienne de géopolitique ?
L’Italie est très en retard dans le développement d’une voie nationale vers la géopolitique.
La géopolitique est une pensée étatique, une tradition accumulée au fil des siècles. Ce n’est pas une coïncidence si les peuples avec le plus de profondeur historique sont aussi les plus sophistiqués en matière de réflexion tactique, stratégique et géopolitique. Je pense aux Perses, aux Turcs, aux Britanniques, aux Japonais, aux Français. Les Américains sont une jeune nation, et leur écrasante puissance militaire, financière, culturelle, anthropologique leur a permis de se passer de géopolitique – du moins jusqu’à présent. Et en tout cas, ils ont un État capable. Pour l’Italie, il faut noter que la tradition étatique est beaucoup moins forte, en fait absente pendant de longs siècles jusqu’à l’unification de 1861. La péninsule a longtemps été divisée, soumise à des puissances extérieures et, surtout, dirigée par des classes dirigeantes étrangères. Mais si vous ne contrôlez pas la res publica, vous ne pouvez pas développer et transmettre la pensée stratégique nécessaire pour créer une ou plusieurs écoles de géopolitique. Le cas de l’Allemagne est différent, car dans les États allemands de l’ère pré-Empire, la participation du personnel allemand à la gestion de l’État était beaucoup plus importante.
Un autre aspect à prendre en compte est qu’à partir de l’unification de l’Italie, il n’y a pas eu un seul État, mais au moins deux : le tournant décisif est 1943, lorsque la classe étatique de l’après-Risorgimento s’est également effondrée avec le régime fasciste.
De plus, le retard de l’Italie est dû au stigmate d’être une puissance ennemie vaincue pendant la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui influence encore le rang et les rôles attribués aux acteurs géopolitiques. L’entrée dans la sphère d’influence américaine en tant que puissance vaincue a réduit la marge de manœuvre stratégique de l’Italie : si vous ne vous occupez pas de votre propre sécurité, vous n’avez aucune raison de penser géopolitiquement. De plus, ce terme était devenu tabou après la Seconde Guerre mondiale, coupable de servir le nazi-fascisme. Aujourd’hui encore, certains, dans ce pays, accusent la géopolitique d’être de droite, alors qu’il s’agit d’une simple méthode d’analyse des conflits entre puissances qui ne doit avoir aucune caractérisation politique.
Existe-t-il une « nation » italienne et si oui, sur quoi se fonde-t-elle ?
L’Italie est certainement une nation, et même plus homogène qu’elle n’aime le croire. Elle est fondée sur une langue commune et incontestée, ce n’est pas pour rien que toute autre langue parlée est reléguée au rang de dialecte. Une seule religion est professée : bien que beaucoup moins de personnes soient croyantes, la culture catholique nous imprègne. Tout le monde consomme les mêmes produits culturels, de la télévision à TikTok. Il n’y a pas de séparatisme : les particularismes sont simplement de nature folklorique. Nous n’avons pas de Corse, d’Écosse, de Catalogne, ni même de Bavière, et encore moins de Donbass. Nous n’avons pas d’autres peuples à l’intérieur de nos frontières, à l’exception de très petites minorités bien protégées. Les personnes d’origine étrangère ne sont pas encore si nombreuses et si mal intégrées qu’elles constituent un problème comme en France. Les stéréotypes sur les sudistes sont depuis longtemps passés de mode, ils ne font plus rire personne. Les différences internes (indéniables) concernent le développement économique et civique. Le retard du sud ne génère pas de demandes d’indépendance. Les régions du nord ne veulent pas redistribuer leur excédent économique aux régions du sud, mais cela reste confiné à des affrontements administratifs. On ne parle plus de colonialisme interne, pas comme en Allemagne entre l’ouest et l’ancienne RDA. La preuve la plus frappante de l’homogénéité italienne est que nous restons ensemble malgré le peu d’État.
L’Italie a été l’un des pays les plus pro-européens, notamment avec la démocratie chrétienne. Aujourd’hui, on a l’impression que l’idée d’Europe s’est amoindrie. Que reste-t-il de l’Europe dans la politique italienne actuelle ?
Pour nous, l’Europe a toujours été un acte de foi. Nous l’avons rêvé pour qu’il nous fasse faire les choses que nous étions incapables de faire nous-mêmes. Parce que cela nous aiderait à surmonter le déficit de notre État. Elle a également servi à relégitimer l’Italie après sa défaite dans la guerre (idée de De Gasperi), en donnant de la crédibilité à la République italienne en tant qu’acteur géopolitique responsable et fiable. Le problème est que lorsque la guerre froide a pris fin, l’Italie est devenue moins pertinente et les règles du jeu moins claires. Entre-temps, les partis ont disparu, emportés par la crise de Tangentopoli au début des années 1990. Tout cela a entraîné une grande confusion stratégique. L’Europe était considérée comme une bouée de sauvetage, pour que quelqu’un nous dise quoi faire, puisque les Américains ne nous le disaient plus. La classe dirigeante a appelé ce concept « contrainte externe ».
Dans ce contexte, il est logique que la population ait toujours eu d’énormes attentes vis-à-vis de cette Europe. Pour nous, l’Europe est le dépassement de l’État-nation, nous voulons vraiment nous dissoudre dans une véritable entité supranationale. Le problème est que les autres n’en veulent pas, et qu’il est assez difficile de créer une nation européenne. Nous nous efforçons de concevoir l’Union européenne comme un moyen de mieux réaliser nos intérêts plutôt que comme une fin en soi. Bien sûr, notre enthousiasme naïf a fait ensuite place à d’amères déceptions et à des courants qui vont jusqu’à remettre en question l’UE elle-même. Au moins, une prise de conscience de la nécessité de créer un noyau au sein de l’UE avec les pays les plus proches de nous afin de poursuivre des intérêts communs : France, Allemagne, Espagne.
L’Italie a souvent été un laboratoire politique pour l’Europe : la démocratie chrétienne dans les années 1950, le populisme dans les années 2010. Est-ce que cette notion de populisme est encore d’actualité en Italie, et si oui comment le définiriez-vous ?
Je ne considère pas le terme « populisme » comme une catégorie d’analyse utile. Tous les politiciens d’aujourd’hui sont des populistes, certains plus, d’autres moins. De même que la catégorie « souverainiste » n’est pas utile, car elle fait croire aux électeurs qu’ils peuvent récupérer la souveraineté dans un satellite de la plus grande puissance de la planète et dans un pays qui doit partager des choix et des processus avec ses voisins et alliés. En fait, nous assistons à une nouvelle vague de nationalisme, mais avec un ton différent : il n’est pas agressif, il ne prêche pas l’usage de la force, mais plutôt un repli scabreux, un isolement du reste du monde. C’est un nationalisme lunaire, car il repose sur l’illusion qu’un pays au centre de la Méditerranée, riche, avec des bases américaines, une dette énorme, un pied en Europe et l’autre en Afrique, avec le Vatican au cœur de sa capitale, peut être laissé tranquille par les autres.
À lire également
Après le traité du Quirinal, quelles relations entre la France et l’Italie ?
La France regarde beaucoup vers l’Allemagne et veut bâtir un « couple » franco-allemand. En revanche, elle regarde peu vers l’Italie, alors que nos échanges commerciaux et culturels sont très importants. Qu’en est-il vu de Rome de cette relation entre la France et l’Italie et que représente la France pour les Italiens ?
Dernièrement, nous avons remarqué que l’attention de la France envers l’Italie a augmenté. Il existe à ce stade une convergence objective d’intérêts entre Rome et Paris. Nous avons des priorités similaires dans l’Union européenne, notamment pour réformer son fonctionnement et assouplir l’austérité budgétaire, ainsi que vis-à-vis de la Russie et de l’Allemagne. Nous devons sortir de l’isolement européen, construire des relations privilégiées et opérationnelles avec les nations les plus compatibles d’Europe occidentale, stabiliser les nombreux foyers de crise en Méditerranée. Plus généralement, s’habituer à rendre nos intérêts explicites et à raisonner en conséquence. Vous avez besoin de partenaires méditerranéens pour faire contrepoids à l’Allemagne et vous aider à construire l’Europe que vous souhaitez. N’oublions pas que vous êtes une puissance de rang supérieur à la nôtre et qu’en tant que telle, vous avez tendance à nous considérer comme des subalternes. Nous sommes également bien conscients que nous sommes historiquement en concurrence pour l’influence dans les mêmes zones en Afrique du Nord. Mais ces facteurs, au lieu d’entraver, rendent d’autant plus urgent le rétablissement des relations franco-italiennes. Il s’agit également de construire une coutume entre les bureaucraties qui survivra à l’alternance des gouvernements.
Nous avons une mer en commun, la Méditerranée. Quel est pour vous le principal défi de cette mer : la Libye, les mouvements migratoires, la Turquie… ?
Notre principal défi, c’est nous-mêmes. Malgré ses milliers de kilomètres de côtes, l’Italie n’est pas un pays de culture maritime. Il pense Europe centrale au lieu de Méditerranée. Une récupération de la sensibilité et de la projection vers la mer est en cours, mais cela prendra du temps. Le deuxième défi, plus important, est la déconstruction croissante des territoires bordant la mer. Dans le chaos, les acteurs étatiques et non étatiques prolifèrent, avec lesquels nous ne sommes pas équipés, d’abord et avant tout culturellement, pour rivaliser. Nous devons reconnaître que les Américains ne viendront plus à notre secours ; il est temps de prendre nos responsabilités. Je pense surtout à garantir l’ouverture des routes maritimes. Pas seul, ce serait impossible. La France et l’Italie peuvent assumer cette fonction si essentielle pour nos approvisionnements. La Turquie doit entrer dans l’équation. Il n’est pas dans notre intérêt de la faire progresser davantage en Afrique du Nord, mais il n’est pas non plus dans notre intérêt de la contrarier ouvertement. Ankara doit participer à l’endiguement des foyers méditerranéens, en mer et sur terre. Le séisme produit par la guerre en Ukraine va bientôt générer des retours de flamme entre l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Chaque crise peut être l’occasion de se tailler un rôle d’influence. Mais il faut éviter le tous contre tous des révoltes arabes de 2011, je pense surtout à la Libye.
L’Italie a récemment proposé un projet de paix entre la Russie et l’Ukraine. On s’attend plutôt à ce que soit la France ou l’Allemagne qui propose ce type de projet. Quel rôle veut jouer l’Italie dans l’Union européenne et comment voit-elle sa relation avec la Russie d’une part et avec la Chine ?
Entre les lignes de la proposition diplomatique, on sent que pour l’Italie, la guerre en Ukraine témoigne du dysfonctionnement de l’ordre continental. La Russie veut renverser cet ordre par la force, et c’est inacceptable. Mais il est illusoire de penser que nous pouvons remettre les aiguilles au 23 février. Sinon, notre gouvernement n’aurait pas proposé une sorte d’Helsinki 2. Il est également clair que Rome ne veut pas d’une Russie définitivement évincée du continent, pour ne pas la donner à la Chine. Il ne s’agit pas de quitter la sphère d’influence des États-Unis, toute personne qui s’occupe de géopolitique sait que cela n’est possible qu’avec la guerre ou l’effondrement de l’hégémon. Mais il est évident que Washington ne peut pas et ne veut pas s’engager comme elle le faisait autrefois en Europe, en raison du défi chinois et des troubles internes, et qu’elle cherche donc désespérément à déléguer la responsabilité à ses partenaires européens. Cela ouvre des possibilités pour le noyau dur occidental France-Allemagne-Italie-Espagne de mettre en commun des ressources et des projets prioritaires tels que l’industrie de l’armement, la fourniture de matières premières cruciales et la production de technologies de pointe. Cela constituera un bastion défensif plus efficace contre la Chine. Notre intérêt avec Pékin est de développer des relations économiques plus équilibrées sans lui offrir de technologies sensibles, sans nous associer à ses initiatives stratégiques et sans participer à un quelconque endiguement naval dans l’Indo-Pacifique. Les Européens, Français et Britanniques mis à part, ne sont d’aucune utilité dans les mers orientales. Si l’OTAN veut aussi traiter avec la Chine, qu’elle le fasse dans les domaines de la cybernétique, du renseignement (y compris l’espace) et de la planification des opérations européennes pour couvrir le théâtre occidental en cas de conflit sino-américain à l’est.
Pensez-vous que la politique d’un État est déterminée par sa géographie ? Dans le cas de l’Italie, sa politique est-elle déterminée par sa géographie ou bien est-elle indépendante de celle-ci ?
Si la géographie était le facteur déterminant, l’Italie serait la première puissance méditerranéenne, ce qu’elle n’est manifestement pas. La preuve en est que nous négligeons la mer qui nous entoure. Nous continuons à l’ignorer à nos risques et périls. La géographie fournit des faits et des priorités incontournables qui résistent même au progrès technologique, mais elle ne détermine pas la politique étrangère d’un pays. Un exemple : l’Italie doit se protéger de la mer et doit protéger ses lignes d’approvisionnement maritimes, mais elle ne s’en occupe pas parce qu’aujourd’hui il n’y a pas de menace étatique venant de la Méditerranée, parce que notre défense dans son ensemble est prise en charge par les États-Unis et parce que les routes navales sont ouvertes grâce à la thalassocratie américaine. Comme on peut le voir, c’est plutôt l’histoire et le paysage des menaces qui ont déterminé ces trois conditions ayant permis à l’Italie de considérer la mer comme un lieu de baignade, plutôt que comme un lieu où se décide notre sécurité. En bref, la géographie fournit une base, mais s’arrêter à la géographie est largement insuffisant. Le déterminisme géographique est une pure paresse.
L’Italie dispose d’une industrie de pointe et d’une grande diversité. Comment votre pays a-t-il fait pour maintenir cette puissance industrielle ?
Question curieuse pour un magazine français. Vous vous demandez probablement comment notre secteur a réussi à survivre sans champions nationaux et sans planification centralisée comme vous le faites. Nous avons des traditions très différentes. Notre vocation manufacturière est probablement plus répandue dans la population qu’en France. Nous avons des entreprises beaucoup plus petites que les vôtres souvent familiales. Cela empêche les économies d’échelle nécessaires pour être compétitif au plus haut niveau dans le monde globalisé. Cependant, elle nous permet de survivre aux tempêtes. Il a également été utile d’être inclus dans la chaîne de production de l’industrie allemande : si nos usines ferment, plus aucun approvisionnement n’arrive en Rhénanie et en Bavière. C’est l’un des facteurs déterminants de l’accord de Berlin sur les euro-obligations, que vous, Français, vous vous êtes trompés en imposant à Angela Merkel.
On a coutume de dire que l’Europe est divisée entre les pays du sud « les pays du Club Méditerranée » dépensiers et endettés et les pays du nord, aux comptes bien tenus. Cette perception vous semble-t-elle correspondre à la réalité ?
Cette ligne de fracture existe et le Covid a montré qu’elle n’est pas seulement fiscale, mais aussi sanitaire, car elle prend racine dans des approches différentes de la liberté individuelle. Toutefois, il ne s’agit pas de la ligne de fracture la plus importante du continent, ce rang revenant à la division entre l’Est et l’Ouest. Le rideau de fer continue en quelque sorte de séparer deux Europes, divisées par des perceptions différentes de la menace russe et des moments historiques subjectifs différents. En d’autres termes, les Européens de l’Ouest ont des traditions étatiques plus profondément enracinées que les Européens de l’Est, asservis pendant des siècles aux empires centraux. Ils ont récemment obtenu leur pleine indépendance. Ils ont le sentiment de s’appuyer sur des fondations nationales encore fragiles. Ils se sentent dans la phase du Risorgimento. Pour eux, c’est encore 1848. La guerre en Ukraine rapproche les nations nordiques et scandinaves des nations de l’Europe de l’Est. Plus elle durera, plus la Russie sera considérée comme une menace existentielle et plus ce rapprochement sera durable.
Quels sont aujourd’hui les atouts de la puissance italienne ?
Je pourrais citer des facteurs triviaux : la centralité méditerranéenne, la deuxième manufacture d’Europe, une population nombreuse, mais en déclin, des forces armées non négligeables. Mais ils risquent tous d’être des coquilles vides. Je crois que celui qui peut vraiment être nommé est un aspect normalement considéré comme négatif : notre énorme dette publique non réformable. Nous sommes un pays systémique, trop grand pour être renfloué, mais aussi pour être autorisé à faire faillite. Si nous échouons, c’est tout le système euro-atlantique qui échoue. C’est notre bouée de sauvetage. Ce n’est pas un facteur de puissance, mais cela nous sauve de l’impuissance la plus totale.