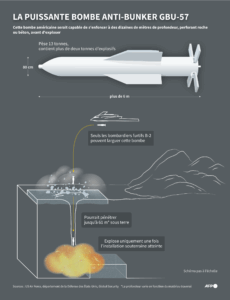L’expression « ennemi héréditaire » a quelque chose d’un peu suranné et n’est plus guère employée en Europe que pour des contrées lointaines ou dans le style hyperbolique de certains commentateurs politiques ou sportifs. La disparition (partielle) de son usage ne nous dispense cependant pas d’examiner sa problématique : de quelle hérédité s’agit-il ?
On a un ennemi héréditaire… jusqu’à ce qu’on en change
L’hérédité suggère naturellement l’histoire : sont ennemis héréditaires les pays qui se sont longtemps battus. L’histoire serait une sorte d’éternel présent où le même schéma se reproduit sans autre modification que l’évolution technologique. Pour séduisante qu’elle soit – Alain l’a retenue dans Mars ou la Guerre jugée –, cette hypothèse pose cependant deux problèmes. Le premier : comment changer d’ennemi héréditaire ? Ce qui arrive plus souvent qu’on ne croit, comme le montre l’histoire européenne : historiquement, la France s’est trouvée confrontée plus souvent à l’Angleterre, à qui elle livra trois guerres séculaires, qu’à l’Allemagne ; pourtant au xixe siècle, le Second Empire et la Troisième République ont construit le modèle d’une rivalité inexpiable avec la seconde, tandis que le Royaume-Uni faisait en 1904 le choix de s’allier avec son ancien « ennemi héréditaire » face à la nouvelle menace incarnée par l’Empire allemand. Le second problème est le corollaire du premier : puisqu’on peut changer d’ennemi héréditaire, c’est que l’histoire ne « condamne » pas à se battre éternellement, donc n’est pas la cause profonde.
Alors quoi d’autre ? La géographie ? Il est vrai que la dispute de territoires ou les conflits de délimitation frontalière peuvent entretenir la conflictualité durant des décennies, voire des siècles. Songeons notamment aux multiples partages de la Pologne. La rivalité s’expliquerait alors par des intérêts contradictoires et inconciliables. Notons cependant que les territoires convoités ne sont pas toujours riches, au sens économique. Il ne faut donc pas tomber dans le déterminisme sans accorder la moindre part aux approches variables des sociétés humaines. Plus importantes souvent sont les représentations que les peuples adoptent : pour les Serbes, le Kosovo n’était pas une question économique, mais une question de symbole. Ce qui nous ramène à l’histoire ou, plus exactement, à la culture.
A lire aussi : Que peut-on encore apprendre de la guerre de 1870 ?
Géographie, histoire… et culture
La culture, c’est finalement ce qui donne un sens à l’histoire ou à la géographie. L’histoire de France peut s’interpréter de bien des façons, mais en faisant remonter, sans crainte de l’anachronisme, l’animosité aux Germains et aux Gaulois, le « roman national » du xixe justifiait le conflit avec l’Allemagne, il l’inscrivait dans la géographie autant que dans l’histoire – la question des « frontières naturelles ». Aussi certains choix culturels semblent-ils dictés par la volonté d’ajouter une dimension « culturelle » à une animosité « naturelle » : ainsi quand la dynastie perse safavide imposa au xvie siècle l’islam chiite à sa population, alors majoritairement sunnite, c’était pour ajouter un critère religieux à l’opposition ethnolinguistique, autant que géopolitique, avec les Ottomans, transformant ainsi le seul facteur commun pouvant permettre une compréhension mutuelle en un facteur aggravant la discorde.
L’ennemi héréditaire n’est pas… héréditaire. Regardant au-delà du détroit de Gibraltar, le Maroc envahit la péninsule ibérique puis subit en retour les attaques du Nord. L’Espagne pouvait être considérée comme son ennemi héréditaire, en une époque où les territoires de l’est, divisés, ne constituaient pas une menace. La France unifia l’Algérie et lui accorda l’indépendance en 1962. Aussitôt des contentieux gelés par la puissance coloniale éclatèrent au Sahara : Alger est-elle en train de devenir l’ennemi héréditaire de Rabat ? C’est le territoire qui dessine les différents horizons d’où peuvent émerger des ennemis, c’est l’histoire qui en un moment donné détermine quel ennemi est le plus menaçant, c’est la culture qui le qualifie d’héréditaire… jusqu’au prochain.