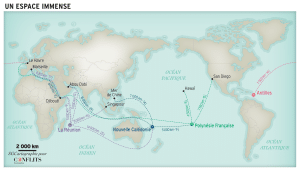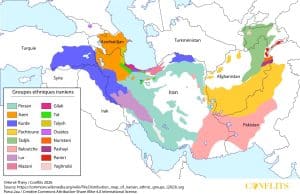La Chine a riposté aux tarifs douaniers imposés par Trump en augmentant les droits sur les importations américaines et en imposant de nouveaux contrôles à l’exportation. Pékin veut montrer qu’elle est prête à s’engager dans une guerre économique. Le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine ne fait que commencer.
Arthur Kroeber, analyste chez Gavekal. Traduction de Conflits.
La contre-attaque de Pékin face au déferlement de tarifs douaniers de Trump le 2 avril a été une bonne politique pour la Chine, mais une mauvaise nouvelle pour l’économie mondiale, comme le montre la vente massive des marchés asiatiques lundi matin. Après avoir passé les cinq dernières années à se fortifier contre la pression américaine, la Chine pense pouvoir durer plus longtemps dans une guerre économique. Il appartient désormais à Trump de décider s’il veut intensifier la guerre commerciale ou négocier avec la Chine, et aux autres grands partenaires commerciaux des États-Unis de décider dans quelle mesure ils veulent imiter la stratégie de résistance de la Chine.
Jusqu’à présent, Trump ne semble pas intéressé par la négociation, et la Chine se concentre étroitement sur la légitime défense, plutôt que de s’efforcer de forger une coalition des nombreux pays lésés par la guerre commerciale de Trump.
Le signal de Pékin
La riposte chinoise a été une réponse forte aux politiques américaines qui, intentionnellement ou non, semblent vouloir dissocier les deux plus grandes économies du monde.
Avant l’entrée en fonction de Trump, les initiés de Washington se demandaient s’il soutiendrait une législation visant à mettre fin au statut de « relations commerciales normales permanentes » de la Chine avec les États-Unis. La fin de ce statut aurait entraîné une augmentation de 42 points de pourcentage du tarif moyen sur les importations chinoises. Beaucoup pensaient que cette option nucléaire serait trop extrême pour Trump. Mais la législation n’est plus nécessaire : les trois séries de droits de douane imposés par Trump à la Chine cette année ont augmenté les droits de 54 points de pourcentage.
La décision de la Chine (un droit de douane de 34 % sur toutes les importations américaines, ainsi qu’une série de nouveaux contrôles à l’exportation sur les minéraux critiques et des sanctions contre les entreprises américaines) est plus importante pour le signal qu’elle envoie que pour son contenu. Sur le fond, la Chine ne peut pas infliger autant de souffrances aux États-Unis qu’elle n’en subit, car elle affiche un important excédent commercial et, mis à part les terres rares, a encore plus à perdre des contrôles à l’exportation.
Mais là n’est pas la question. Le signal envoyé par Pékin est qu’il repoussera les efforts de domination des États-Unis et qu’il est parfaitement heureux de s’engager dans une guerre d’usure économique. Dans le même temps, le fait qu’il se contente essentiellement de répliquer aux actions des États-Unis, plutôt que de les intensifier (son nouveau tarif de 34 % reproduit le tarif « réciproque » de Trump du 2 avril), montre que la Chine est toujours ouverte à la négociation, à condition que les États-Unis puissent proposer un programme cohérent. Comme l’a écrit un commentaire publié dans le Quotidien du Peuple ce week-end, « face aux tactiques de pression imprévisibles et extrêmes des États-Unis, nous ne fermons pas la porte à la négociation, mais nous ne nous accrochons pas non plus à des illusions ».
Le message que j’ai entendu en Chine fin mars était que les responsables chinois étaient déconcertés et frustrés par le refus de l’administration Trump de répondre aux demandes répétées d’expliquer ce qu’elle voulait, ou même d’ouvrir un canal de communication cohérent. Au cours du premier mandat de Trump, Jared Kushner a ouvert une ligne avec l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, et début avril 2017, le haut dirigeant Xi Jinping mangeait un gâteau au chocolat avec Trump à Mar-a-Lago.
Cette fois-ci, Pékin pensait avoir montré sa volonté d’entamer des négociations sur l’augmentation des achats de produits américains, l’amélioration des flux d’investissement bilatéraux, la limitation des capacités excédentaires et éventuellement le plafonnement de la dépréciation du taux de change. Mais ces ouvertures ont été ignorées, et tout ce que la Chine a obtenu, c’est la visite de Steve Daines, allié de Trump, qui a souligné la nécessité pour la Chine de faire davantage pour contrôler les exportations de fentanyl.
La Chine n’a pas trouvé cette demande crédible, à la fois parce qu’elle affirme que les nouvelles réglementations imposées en septembre dernier ont commencé à réduire le flux de précurseurs du fentanyl, et parce que Trump a constamment changé les justifications de ses diverses annonces tarifaires en février et mars. Le consensus à Pékin, à tort ou à raison, est que parler de fentanyl est un écran de fumée et que l’intention des États-Unis est simplement de contenir la croissance de la Chine.
Tout cela souligne que, quelles que soient les justifications avancées par ses malheureux conseillers, Trump lui-même n’a pas d’objectifs politiques spécifiques. Les droits de douane sont un instrument de pouvoir dont l’utilisation principale est d’afficher la domination et d’obtenir des gages de soumission. Ou, comme Derek Thompson l’a écrit avec perspicacité dans The Atlantic, « la fin du jeu ici est qu’il n’y a pas de fin du jeu, seulement le jeu infini du pouvoir et de l’influence ».
La Chine n’a aucun intérêt à jouer à ce jeu et a renforcé son économie de sorte qu’elle pense ne pas en avoir besoin. Comme me l’a dit un universitaire bien connecté à Pékin : « La stratégie de la Chine est de rester ferme, de résister et d’attendre que la stratégie de Trump s’effondre. Qui a le plus de résilience économique ? Il est vrai que la Chine est en déflation, mais les États-Unis sont confrontés à la stagflation, ce qui est pire. »
Les questions ouvertes
Trois questions restent en suspens.
Premièrement, Trump tiendra-t-il sa menace d’imposer des droits de douane encore plus élevés à tout pays qui riposterait contre ses droits de douane du 2 avril ? Cela n’aurait pratiquement aucun sens, car les droits de douane actuels sont déjà suffisamment élevés pour réduire considérablement les exportations directes de la Chine vers les États-Unis. Et une nouvelle escalade contre la Chine ne manquerait pas de faire monter le niveau de panique sur les marchés mondiaux. Mais ne pas augmenter les droits de douane reviendrait à admettre l’échec de son bluff, et pourrait encourager d’autres partenaires commerciaux clés des États-Unis, notamment l’Union européenne et le Canada, à mettre à exécution leurs plans de représailles.
Deuxièmement, Trump définira-t-il des objectifs de négociation réalistes, avec la Chine ou avec qui que ce soit d’autre ? Jusqu’à présent, il a refusé de le faire, et ses représentants ont émis des signaux confus quant à savoir si les droits de douane sont un outil de négociation ou une disposition permanente. Dimanche, Trump a insisté sur le fait que toute négociation avec des partenaires commerciaux dépendrait de leur volonté d’éliminer les déficits bilatéraux. Il est difficile d’imaginer que la Chine accepte cela comme base de négociation.
Enfin, que feront les décideurs politiques chinois pour compenser les dommages économiques d’un bras de fer prolongé, qui semble désormais presque certain ? Malgré les discours courageux sur la résilience supérieure de la Chine, cette guerre commerciale fera beaucoup plus de dégâts que la précédente, et le niveau de croissance et de confiance du secteur privé est bien plus faible. Jusqu’à présent, une dépréciation significative de la monnaie semble exclue, et Pékin ne s’est pas empressé d’annoncer un nouvel assouplissement de la politique budgétaire ou monétaire. Mais le commentaire du week-end dans le Quotidien du Peuple a clairement indiqué que le gouvernement est prêt à en faire plus : il a déclaré que les taux d’intérêt pourraient être réduits ou que le déficit budgétaire pourrait être augmenté si nécessaire, et a fait allusion à des mesures « extraordinaires » pour stimuler la consommation et à d’éventuelles interventions pour stabiliser les marchés financiers. Il devra agir rapidement. Les marchés locaux accordent clairement plus d’importance aux craintes d’une guerre commerciale qu’aux espoirs de relance : l’indice CSI 300 a ouvert en baisse de plus de 4 % lundi matin, tandis que l’indice offshore Hang Seng China Enterprises a ouvert en baisse de plus de 9 %.
La rhétorique chinoise ne fait notamment aucune déclaration claire d’intention de coordonner ses réponses à la guerre commerciale de Trump avec d’autres économies. À part une vague déclaration de coopération avec le Japon et la Corée du Sud, qui a été rapidement rejetée par Tokyo et Séoul, Pékin n’a rien fait pour promouvoir une action commune. En théorie, ce serait le bon moment pour la Chine et l’Europe de travailler ensemble pour stimuler la demande mondiale, comme la Chine et les États-Unis l’ont fait au lendemain de la crise financière de 2008. Mais la Chine se concentre entièrement sur le renforcement de ses propres défenses et ne semble pas très intéressée par l’utilisation de cette crise pour réparer ses relations économiques tendues avec l’UE. Chaque grande région menant ses propres batailles, le risque d’une récession mondiale augmente rapidement.