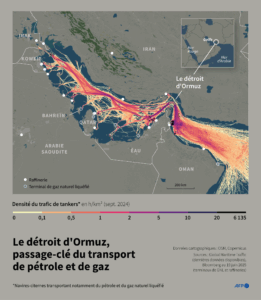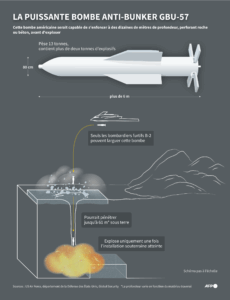La frontière a à voir avec le front. Elle est la ligne de démarcation et de contact qui isole tout en les reliant deux puissances antagonistes. Manifestation spatiale d’un rapport de forces, elle constitue un objet géopolitique par excellence. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été au cœur de nombre des querelles qui ont jalonné l’histoire de la discipline.
Bien que la frontière ait été l’un de leurs sujets de prédilection les plus pérennes, les géographes se sont rarement posé la question de sa légitimité. Ils ont ainsi délaissé à des bataillons d’essayistes et de philosophes le soin de prophétiser l’advenue d’un monde enfin libéré de l’entrave de ces barrières. À rebours de cette tendance d’inspiration rousseauiste qui croit pouvoir déduire de l’artificialité de la frontière son inutilité voire sa nocivité, les géographes ont très tôt souligné qu’on ne pouvait impunément la passer par pertes et profits. Ainsi, les Français Jean Brunhes et Camille Vallaux, pionniers de la géohistoire, concluaient-ils dès 1921 leur Géographie de l’histoire par une dénonciation des « utopistes humanitaires » [à qui il] paraît commode de biffer ces lignes arbitraires de nos cartes » en les stigmatisant comme d’artificielles cloisons « inventées par les hommes d’État et par les militaires pour opprimer les peuples ».
Les désaccords n’en sont pas moins nombreux à propos de la nature, du tracé et des fonctions des frontières.
L’art de repousser les frontières
La question frontalière est au cœur des travaux de l’école allemande de Geopolitik inspirée par les travaux de Friedrich Ratzel (1844-1904) et structurée autour de la Zeitschrift für Geopolitik fondée et dirigée par le général Karl Haushofer (1869-1946).
Cet intérêt marqué pour la frontière, à laquelle Haushofer a consacré un livre en 1927, s’explique aisément. Les Geopolitiker allemands ont en effet pour objectif premier de délégitimer le redécoupage frontalier opéré en Europe par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Dans cette intention, ils font feu de tout bois, ce qui rend pour le moins compliquée toute tentative de dégager de leurs propos une règle générale. Parfois, ils défendent l’idée de frontières « naturelles », c’est-à-dire dont le tracé s’imposerait par décalque sur des éléments de reliefs, souvent ils défendent une conception plus culturelle de la frontière qui devrait englober toutes les populations de langue allemande. Dans tous les cas, il s’agit de fournir une justification au pangermanisme.
La Geopolitik allemande ne fournit donc pas une théorie « clés en main » sur la « bonne frontière ». En revanche, elle a clairement hérité de la géographie politique dynamique et biologisante de Ratzel l’idée que la frontière est une réalité vivante et donc mouvante, et à ce titre tout autant historique que géographique : les frontières ne sont pas éternellement fixées par la nature, mais appelées à évoluer au gré des aléas de l’histoire.
» De la conception de la frontière, comme zone et non comme ligne, découle chez Gottmann une définition originale de la « bonne » frontière »
Une Allemagne affaiblie s’est vu imposer des frontières qui lui sont défavorables. Une Allemagne revigorée se doit de les repousser.
C’est paradoxalement par là que leur pensée entre en contact avec celle du géographe français Jacques Ancel, qui fut pourtant leur plus fervent opposant.
La frontière comme isobare
Jacques Ancel (1882-1943) est en effet l’auteur, en 1938, d’un traité consacré à la Géographie des frontières qui se présente explicitement comme « une réplique » [au] quarteron de savants d’outre-Rhin ». Bien qu’il s’oppose à eux, il partage leur conviction fondamentale que la frontière est une réalité « mouvante ». Il faut dire que tous appartiennent à une époque qui a vu les frontières européennes connaître de fréquents et massifs remodelages.
Si Ancel est convaincu du caractère dynamique de la frontière, c’est qu’il considère que celle-ci « est déterminée non par la nature mais par l’homme ». L’étude des frontières relève donc de la géographie humaine et non physique. En conséquence, la frontière ne doit pas être étudiée « en soi, mais par rapport aux groupes qu’elle sépare » [car] elle vit […] et évolue avec eux ».
C’est ainsi qu’il en arrive, reprenant une expression forgée à propos de l’Irak par son collègue Jacques Weuleresse (1905-1946), à sa célèbre définition de la frontière comme « isobare politique, qui fixe, pour un temps, l’équilibre entre deux pressions ». En d’autres termes, la frontière n’est jamais que la résultante, toujours provisoire, d’un rapport de forces : elle est plastique, dynamique et en aucun cas statique. La viabilité d’une frontière ne dépend donc pas tant de sa concordance avec des obstacles physiques que de la cohésion des populations qu’elle renferme qui sont capables par leur unité d’opposer une force de résistance aux pressions exercées sur elles par d’autres forces venues de l’extérieur. Inversement, le défaut d’unité nationale se traduit par un affaiblissement des frontières. C’est pourquoi Ancel en conclut qu’« il n’y a pas de problèmes de frontières » mais « que des problèmes de Nations ».
Cette définition dynamique de la frontière, finalement pas si éloignée de celle défendue par les Geopolitiker qu’il combat, a valu à Ancel la désapprobation d’un autre grand géopoliticien français, Jean Gottmann (1915-1994) qui, au début des années 1950, reprochait à son aîné d’avoir adopté une conception par trop conflictuelle de la frontière : « Une telle théorie supposerait qu’il y a toujours opposition de part et d’autre d’une frontière, que la politique de tout État digne de ce nom tend toujours à un agrandissement territorial. »
La frontière comme zone
Alors que ses prédécesseurs, par-delà leurs divergences, partageaient une même conception linéaire de la frontière, Gottmann propose d’y voir avant tout une zone.
Si, juridiquement, la frontière prend effectivement la forme d’une ligne, sur le terrain, elle correspond plutôt à une région sur laquelle se répercute concrètement l’existence de cette ligne imaginaire : « Telle était bien en fait la signification du limes romain ; tel était encore le sens de ces « marches » des empires et royaumes du Moyen Âge, ou encore des frontières nord-américaines ». Étudier la frontière, ce n’est donc pas tant étudier la séparation entre deux espaces distincts qu’observer en quoi la rencontre de deux souverainetés aboutit sur le terrain à l’émergence d’un seul et unique espace aux caractéristiques originales. C’est décrire à l’échelle locale l’émergence d’une culture, d’une économie ou encore d’une identité frontalières.
De cette conception de la frontière, comme zone et non comme ligne, découle chez Gottmann une définition originale de la « bonne » frontière : ce qui compte selon lui n’est pas le tracé ni l’adéquation aux éléments du relief de la frontière, pas plus que la cohésion du peuple qu’elle renferme, mais bien plutôt la profondeur stratégique dont elle dispose. Fervent sioniste, il s’inquiète ainsi de la viabilité du jeune État israélien qui, du fait de son exiguïté, est tout entier « une région-frontière, une marche » qui « ne peut connaître de sécurité que par un effort militaire et financier sans rapport avec celui de ses voisins, pays bien plus massifs ». Et de conclure qu’« il est normal qu’une nation vivant entre de telles frontières développe tout entière une psychologie de frontaliers, de peuple de marches ».
Plus proche de nous, Michel Foucher (né en 1946) a consacré en 1988 une étude à la question des frontières en s’inscrivant dans la droite ligne de Jean Gottmann. Plus que la frontière elle-même, ce qui importe selon lui c’est « l’usage que les hommes en font ». La frontière apparaît ainsi comme un symptôme dont l’étude permet de révéler les rapports de forces qui la génèrent : un moyen plus qu’une fin de l’analyse géopolitique.
D’une certaine façon, les idées de Gottmann contribuent à remettre en question la notion de frontière, ou plutôt sa conception comme ligne de séparation. Comme souvent, elles sont filles de leur époque, celle de l’internationalisation et de la mondialisation. Doit-on pour autant les qualifier, comme Brunhes et Vallaux autrefois, d’« utopistes humanitaires » ?