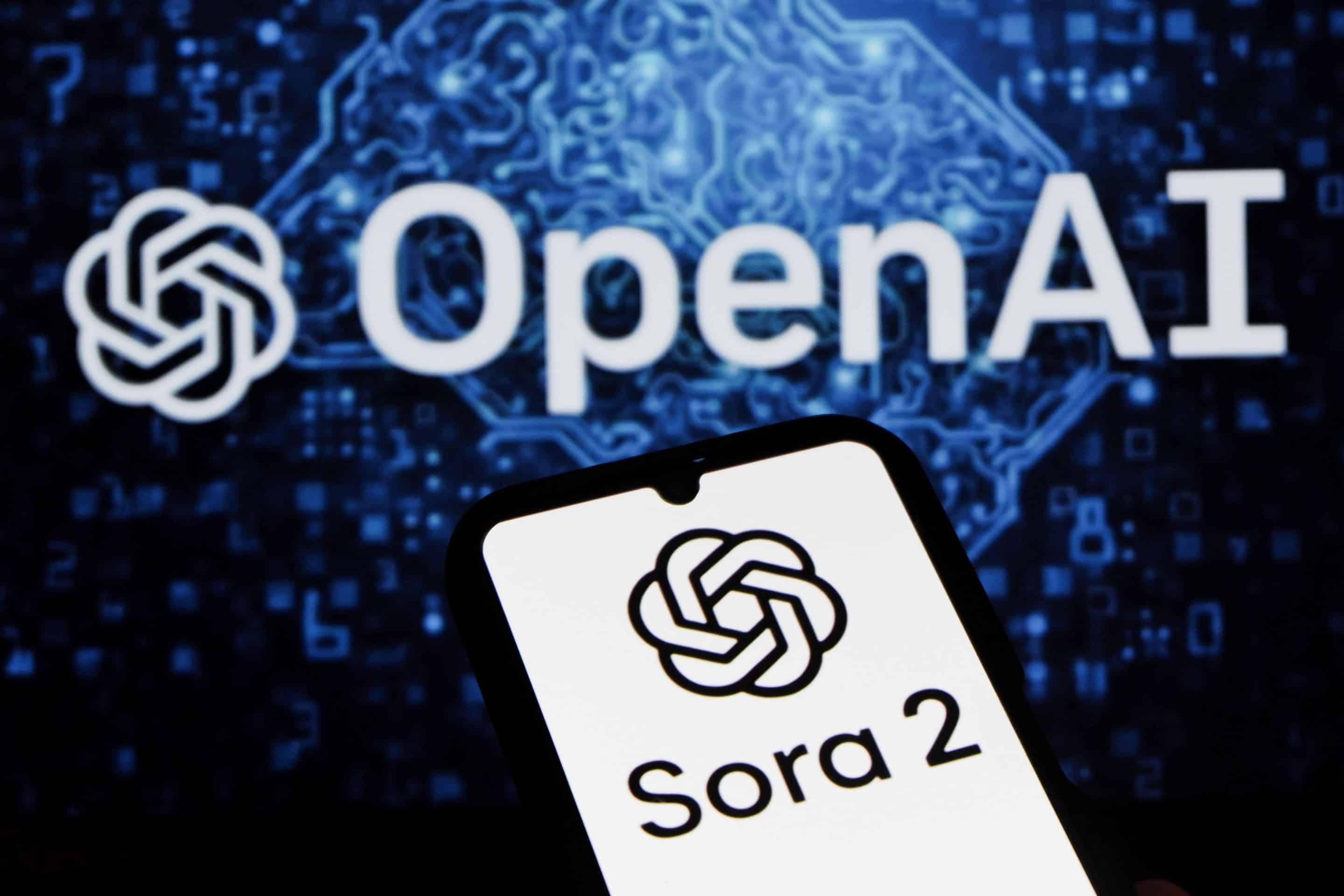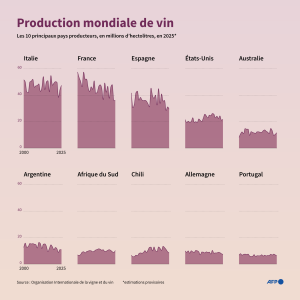Chaque époque connaît sa rupture fondatrice. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a bouleversé les sociétés humaines, transformant les rapports de production, redéfinissant les bilans de puissance et entraînant une urbanisation qui allait remodeler la planète. Après la vapeur, l’électricité et l’énergie nucléaire, un mouvement d’ampleur comparable – la révolution artificielle – s’impose : l’irruption de l’intelligence artificielle (IA), des réseaux sociaux et des technologies numériques dans toutes les strates du quotidien.
Cette révolution ne se limite pas à l’innovation technique. Elle redéfinit les rapports de force internationaux, provoque une recomposition des puissances économiques et militaires, et interroge la capacité des États à maintenir leur souveraineté dans un espace numérique mondialisé et aux frontières poreuses. En toile de fond, les enjeux climatiques et énergétiques imposent des contraintes inédites, tout en révélant la dépendance de cette nouvelle révolution aux métaux critiques, aux data centers et aux câbles sous-marins, comme l’acier, l’usine et le télégraphe au XIXe siècle.
À l’instar de la révolution industrielle, qui avait conduit à l’essor d’un certain impérialisme et le développement des colonies, de nouvelles conflictualités émergentes, parfois diffuses, parfois ouvertes. La révolution artificielle est donc autant une promesse de puissance qu’un risque de déséquilibre systémique.
De la vapeur à l’algorithme : deux ruptures fondatrices
À partir de la fin du XVIIIᵉ siècle, l’industrialisation transforme radicalement l’Europe puis le monde. La machine à vapeur, le textile mécanisé, le chemin de fer et l’électricité créent une croissance sans précédent. L’usine devient le centre névralgique de la société, organisant le travail ouvrier et structurant les classes sociales. Si l’industrialisation produit des inégalités, elle ouvre aussi la voie à des réformes sociales, comme les lois sur le travail, la naissance du syndicalisme et la création de l’État-providence.
Depuis la fin du XXᵉ siècle, les sociétés basculent vers une économie où la ressource principale n’est plus le charbon ou le pétrole, mais les données. L’IA, les réseaux numériques, la puissance de calcul et la circulation instantanée de l’information bouleversent l’organisation économique. Les géants du numérique (GAFA, BATX) deviennent les nouveaux maîtres des flux de données, équivalents contemporains des compagnies minières ou sidérurgiques d’hier. Comme le soulignait T. Breton en 2018, « les données sont la matière première de l’IA ».
Les deux révolutions créent un décalage entre l’innovation technologique et l’adaptation des structures sociales et politiques. De même que le XIXᵉ siècle a vu émerger une « question sociale » face à la misère ouvrière, le XXIᵉ siècle connaît une « question numérique » face aux bulles cognitives, à la désinformation et à la dépendance aux écrans.
Les réseaux sociaux : usines de l’attention
L’usine industrielle produisait des biens matériels ; les plateformes numériques produisent et exploitent l’attention humaine. Facebook, Instagram, TikTok, X fonctionnent comme des « usines attentionnelles » où chaque clic est valorisé. Les algorithmes sont ainsi conçus pour maximiser le temps passé à l’écran, souvent au détriment de l’esprit critique, de la lecture et de la mémoire.
L’une des conséquences majeures de cette économie de l’attention est la constitution de bulles cognitives : les algorithmes personnalisent l’information, enfermant l’utilisateur dans un univers idéologique clos. Cela fragmente l’espace public, hier dominé par quelques journaux de masse, en une multitude de micro-communautés incapables de dialoguer entre elles. Cela se traduit notamment par une fragmentation de la société sur les questions scientifiques et sociales ainsi que la systématisation des théories du complot.
Comme la presse au XIXᵉ siècle a alimenté les révolutions et les mouvements sociaux, les réseaux sociaux alimentent aujourd’hui les mobilisations, mais aussi la désinformation. Les printemps arabes ont montré leur potentiel émancipateur, tandis que la prolifération de « fake news » ou d’ingérences étrangères souligne leur potentiel déstabilisateur.
À lire également : PODCAST — L’intelligence artificielle dans l’Armée de Terre. École de Guerre — Terre
Cryptomonnaies et blockchain : nouvelle révolution monétaire
La première révolution industrielle a vu l’émergence des grandes banques et du capitalisme financier. La révolution artificielle voit l’apparition de nouvelles monnaies décentralisées, comme le Bitcoin (2009), reposant sur la technologie blockchain, échappant ainsi aux contrôles des États et organismes de régulation bancaire. Alors que la banque traditionnelle centralise et garantit les échanges, la blockchain promet un système sans intermédiaire. Cela peut menacer la souveraineté monétaire des États, de la même façon que l’or puis le capitalisme financier avaient reconfiguré les équilibres géopolitiques du XIXᵉ siècle.
Comme les chemins de fer ont suscité une bulle spéculative dans les années 1840, les cryptomonnaies génèrent aujourd’hui des emballements financiers. Leur volatilité traduit une recherche d’actifs refuges, mais illustre aussi les risques de déséquilibre dans l’économie mondiale par son utilisation dans les trafics illicites et son adoption comme monnaie officielle par le Salvador et la République centrafricaine.
Médias et politiques : nouvelles règles du jeu
Au XIXᵉ siècle, la presse industrielle est devenue un acteur central de la vie politique. Elle a nourri les débats publics, renforcé la démocratie, mais aussi alimenté des campagnes de propagande.
Aujourd’hui, les médias traditionnels cohabitent avec les réseaux sociaux, qui diffusent l’information de manière instantanée et horizontale. L’autorité éditoriale des journaux est concurrencée par la viralité des contenus. Les figures politiques doivent adapter leur communication à ces nouvelles règles, souvent en privilégiant l’émotion sur la raison.
La révolution artificielle favorise une ère de « post-vérité » où les faits importent moins que les narratifs. Cette polarisation fragilise la cohésion sociale et les démocraties représentatives. Elle rappelle, par analogie, la période où les masses ouvrières, mal intégrées, déstabilisaient l’ordre politique établi.
À lire également : Les grands acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle
Intelligence artificielle : la machine à vapeur de l’esprit
La machine à vapeur a démultiplié la force musculaire ; l’IA démultiplie la force cognitive. Les algorithmes sont dorénavant capables de traduire, diagnostiquer, créer du texte ou de l’image, voire de prendre des décisions autonomes. Si cette dernière capacité emporte son lot de craintes et d’incertitudes, c’est celle qui peut échapper au contrôle humain en prenant une décision par raisonnement informatique. De même que l’industrialisation a remplacé l’artisanat par le travail ouvrier, l’IA remplace certaines tâches intellectuelles par l’automatisation. La comptabilité, la traduction, l’analyse de données, voire la rédaction sont affectées. Le défi n’est plus seulement le chômage ouvrier, mais la redéfinition des métiers de l’esprit.
La maîtrise de l’IA est devenue un enjeu de puissance mondiale. Les États-Unis et la Chine s’affrontent dans une course à l’IA, comparable à la rivalité industrielle du XIXᵉ siècle. Mais l’IA pose aussi des dilemmes éthiques : biais algorithmiques, surveillance de masse, responsabilité juridique.
Vers une nouvelle question sociale et mondiale
La révolution industrielle a créé une classe ouvrière exploitée. La révolution artificielle crée une fracture entre les « connectés » et les « exclus du numérique », mais aussi entre ceux dont les compétences sont automatisables et ceux qui savent maîtriser l’IA. Les puissances qui maîtrisent les technologies de l’information dominent. Si les États-Unis, la Chine et quelques acteurs européens se disputent le leadership, les pays en développement risquent de rester dépendants, comme jadis colonisés dans l’ordre industriel.
Au XIXᵉ siècle, les États ont fini par réguler l’économie industrielle (lois sociales, régulation financière). Aujourd’hui, la gouvernance numérique est embryonnaire : l’Union européenne avance avec le RGPD et l’AI Act, mais une régulation mondiale reste à inventer. Encore faut-il pouvoir trouver une instance toujours reconnue internationalement pour signer un accord qui pourra survivre aux coups de barre des gouvernements qui se succèdent.
Conclusion
La révolution industrielle a ouvert l’ère moderne en transformant les sociétés, mais elle a aussi entraîné des désastres sociaux et environnementaux avant d’être régulée. La révolution artificielle suit la même trajectoire : innovation fulgurante, désajustements sociaux, risques politiques et concentration du pouvoir économique.
Les réseaux sociaux, les bulles cognitives, la cryptomonnaie et l’IA redessinent un monde où la maîtrise de l’information devient la clé de la puissance. Cette révolution est peut-être encore plus radicale que la révolution industrielle : elle ne transforme pas seulement la matière, mais l’esprit et la perception même du réel. L’avènement de la technologie quantique et sa puissance de calcul sera probablement aussi structurant que l’exploitation de l’atome, pour la paix comme pour la guerre.
La tâche politique du XXIᵉ siècle est donc de construire une gouvernance adaptée à ce nouvel âge, capable de concilier innovation et responsabilité, puissance et éthique, liberté et régulation. Faute de quoi, la révolution artificielle pourrait créer un maître dangereux plutôt qu’un serviteur utile.
À lire également : L’ONU veut réguler l’intelligence artificielle militaire mais se heurte au principe de réalité concurrentielle