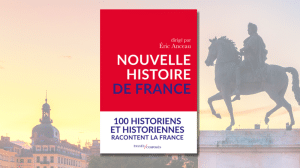Eric Descheemaeker, observateur de longue date du dossier calédonien, livre ici ses réactions à chaud après l’annonce de la conclusion d’un accord sur la Nouvelle-Calédonie à Bougival (Yvelines), samedi 12 juillet. Selon lui, cet accord ne se peut se défendre d’un point de vue pro-français que comme manière de gagner du temps pour « refranciser » l’archipel du Pacifique.
Comme l’accord de Nouméa, mais de manière bien pire encore, l’accord de Bougival repose sur une ambiguïté fondamentale destinée à satisfaire tout le monde, en fonction de la manière dont on le lit.
Il crée en effet, selon ses propres termes, un « État de la Nouvelle-Calédonie » qui « pourra être reconnu par la communauté internationale » (une version antérieure disait « aura vocation à »). Cet État sera doté de sa propre « nationalité », calédonienne. Mais il est censé rester « au sein de l’ensemble national » et son statut, toujours selon l’accord, être « inscrit dans la Constitution » française.
Globalement, les compétences régaliennes restent exercées par la France, mais la Nouvelle-Calédonie pourrait exiger leur rapatriement si une large majorité s’exprimait en ce sens.
Deux lectures
On voit immédiatement la double lecture possible de l’accord (c’est évidemment le but) :
– Les indépendantistes repartent avec leur « État » calédonien avec (logiquement, mais ce n’est pas acquis[1]) un passeport calédonien, et possiblement un statut d’observateur à l’ONU. Comme en plus c’est la Nouvelle-Calédonie qui – en théorie du moins – décide elle-même de ce qu’elle fait ou ne fait pas, elle peut se dire « pleinement souveraine ».
Selon cette lecture, il y a deux États égaux en dignité, France et Nouvelle-Calédonie, liés entre eux par des conventions acceptées de part et d’autre. La Nouvelle-Calédonie est une sorte d’État associé, mais inhabituel : davantage séparé de la puissance « partenaire » par certains aspects (nationalité, reconnaissance internationale notamment), mais moins par d’autres (tant que les compétences régaliennes restent exercées par la France, il est difficile de dire que c’est par délégation de la Nouvelle-Calédonie, rien dans l’accord n’appuyant pareille interprétation).
– La lecture loyaliste va être de dire que ces mots n’engagent pas à grand-chose, que l’État calédonien n’est pas un « vrai » État ni sa nationalité une « vraie » nationalité ; et que les compétences régaliennes ne seront jamais transférées, puisque les indépendantistes n’auront jamais de majorité qualifiée (36 sièges sur 56) – et ce d’autant moins que la répartition des sièges est rééquilibrée au profit de la province Sud (le bastion des loyalistes) et le corps électoral dégelé.
D’un côté, donc, une victoire symbolique écrasante (un nouvel « Etat » va voir le jour) ; de l’autre des considérations pragmatiques : le petit État calédonien reste français sans perspective d’indépendance (exeunt les référendums d’autodétermination) ; on va pouvoir relancer la machine économique pendant que ceux d’en face savourent des hochets qui ne sont, au fond, que des mots sur le papier.
Chacun va donc considérer avoir gagné : c’est le principe même d’un accord, pour qu’il puisse aboutir en l’absence de défaite militaire d’un des camps.
Qui, alors, a réellement gagné ?
Ce n’est pas facile à dire. Sur le papier, les indépendantistes à qui on a concédé un État distinct de la France et (potentiellement) « à eux ». Dans la réalité, c’est beaucoup plus dur à savoir, car tout va dépendre de la suite des événements. Il nous semble que les loyalistes ont fait un pari qui pourrait réussir, mais qui est extraordinairement risqué.
Le pari, c’est que ces mots flatteurs pour l’égo kanakyen resteront effectivement des mots : des petits hochets qui feront plaisir aux grands chefs kanaks – pendant ce temps, au moins, eux et leurs troupes ne brûleront pas Nouméa. Il est vrai que tout, avec les mots, est question d’interprétation. La Polynésie française avait ainsi été déclarée « pays d’outre-mer »[2], et le Conseil constitutionnel avait rapidement clarifié que cela n’emportait aucune conséquence juridique.
Que veut dire « État de la Nouvelle-Calédonie » ?
« État », évidemment, n’est pas la même chose que « pays ». C’est, dans la tradition française, un terme tellement puissant et évocateur qu’il va nécessairement falloir clarifier son sens dans le contexte calédonien. Soit, en effet, l’État de Nouvelle-Calédonie est un vrai État, et alors ce n’est plus la France. Soit c’est une collectivité territoriale sur laquelle on a apposé une étiquette ronflante, mais vide d’implications concrètes, et alors il faudra le dire et en tirer les conséquences. L’ambiguïté peut durer un certain temps, mais, comme avec l’accord de Nouméa, il faudra bien à un moment en sortir.
Cela est d’autant plus vrai qu’appeler « État » à la fois l’échelon national et un échelon – supposément – infranational, c’est, semble-t-il, sans équivalent dans le monde (ici en Australie, on appelle bien « State » l’État – non souverain – du Victoria dans lequel nous vivons, mais l’Australie tout entière, elle, n’est pas un « State », c’est un « Commonwealth »).
Il n’est pas impossible que le Conseil constitutionnel juge, plus ou moins rapidement, que cette « organisation institutionnelle sui generis », comme l’appelle l’accord, n’a d’État que le nom, puisque l’État français est par sa nature même exclusive de rivaux au sein de la République (ce qui neutraliserait du même coup les effets les plus délétères de la reconnaissance d’une « nationalité » distincte). C’est possible, mais ce n’est absolument pas certain. Tout va donc être question de ce qui sera mis derrière ce mot (juridiquement, mais aussi politiquement et, peut-être plus fondamentalement encore, dans les esprits). Quelle sera l’interprétation retenue, à la fois par les tribunaux et par l’opinion commune ?
Il nous semble pour notre part que cela dépendra avant tout, non pas des mots de l’accord, mais surtout de la réforme constitutionnelle du Titre XIII (qui le contextualisera du point de vue de l’ordre juridique français) et, encore plus fondamentalement, du rapport de force sur le terrain.
Expliquons-nous, car la chose ne va pas de soi. Si on en reste à ce « 50-50 » dans la population calédonienne – moitié pour l’indépendance, moitié contre – , avec des indépendantistes qui grignotent tous les 10 ou 20 ans une partie de ce qu’ils ont encore à prendre (provoquant à chaque fois un nouveau cycle de violence pour forcer l’autre partie à partager ce qui était encore français), alors leur victoire est inéluctable. L’« État » calédonien en gestation dans l’accord prendra forme dans l’ordre international et quittera le giron de la Constitution française. Grâce aux violences insurrectionnelles de 2024, ils viennent de grignoter à Bougival la moitié du chemin qu’il leur restait à parcourir vers l’indépendance pure et simple, alors même qu’ils avaient perdu trois fois dans les urnes. Il ne leur restera plus qu’à recommencer l’opération une ultime fois, et ce sera plié. L’habillage juridique suivra, c’est inéluctable, la réalité du terrain.
Mais comment, alors, le pari loyaliste pourrait-il réussir ?
À notre sens, d’une et une seule manière : en peuplant la Calédonie.
Leur pari, tel du moins que nous nous le représentons, peut se résumer ainsi. Grâce à l’accord, la paix revient pour au moins 10 ou 15 ans. La reconstruction de l’île offre des opportunités économiques considérables. Portés par cet élan (comme après l’accord de Nouméa), 150 000 Français viennent s’installer sur l’île, qui est pour tous ceux qui sont déclassés en métropole et ne parlent d’autre langue que le français (ils sont des millions, tant la situation est dramatique) la seule alternative au Québec. La Province Sud, grâce aux prérogatives que la loi organique devrait lui donner, leur fait un excellent accueil, notamment sur le plan fiscal. Au bout de 10 ans, ils votent, et évidemment pas en faveur du transfert des compétences régaliennes. Dans une Nouvelle-Calédonie de 400 000 habitants, ce qui serait toujours très peu pour un archipel grand comme deux fois la Corse, les Kanaks ne seraient plus qu’un tiers de la population. Les deux autres tiers, qui pourraient devenir les trois quarts, etc., se sentiraient pleinement français et n’auraient aucune envie que leur « État de Nouvelle-Calédonie » soit davantage qu’une réalité honorifique. Là encore, cahin-caha, l’ordonnancement juridique suivrait inéluctablement.
C’est donc le pari : une revendication indépendantiste marginalisée, pas de référendums, un transfert des compétences régaliennes qui reste une pure virtualité que personne ne réclame. Les universitaires décolonialistes pourront dire ce qu’ils veulent, en l’absence d’une force indépendantiste majoritaire ou proche de l’être, leurs mots à eux aussi resteront des mots. Dans ce scénario, le petit État calédonien peut demeurer pleinement dans le grand État français, et à un moment on pourrait même oublier qu’on utilise (utilisait ?) ce même mot d’« État » pour désigner une province française.
La démographie contrôle tout
Inutile de dire, cependant, que ce pari est immensément risqué. Sur le papier, les indépendantistes ont tout pour expliquer, dès que cela sera transcrit dans l’ordre juridique interne (sans qu’on puisse d’ailleurs exclure que ce processus déraille, vu la situation politique nationale), que la Nouvelle-Calédonie est un État séparé avec sa constitution (« loi fondamentale »), sa nationalité, son peuple, etc., et qu’elle n’est liée à la France que de manière contractuelle et pour le temps qu’elle souhaitera.
Mais il peut réussir. En dernière analyse, la démographie contrôle tout. Accord de Bougival, accord différent ou pas d’accord du tout, si les indépendantistes restent aussi nombreux et aussi prêts à recourir à la violence qu’aujourd’hui, l’indépendance est inévitable à terme. Les résultats du recensement à venir vont, hélas, être d’ores et déjà une douche froide pour les non-Kanaks. Si on ne repeuple pas la Nouvelle-Calédonie avec des populations non-indépendantistes, sa sortie de la France est inéluctable. Dans ces conditions, le pari des loyalistes peut se comprendre comme étant la seule solution possible (ou plus précisément la condition préalable à cette solution).
La réussite du pari fait toutefois face à deux obstacles considérables. D’une part, la logique de l’accord de Bougival, qui pourrait mener à une sortie de la Nouvelle-Calédonie du giron de la République : c’est possible, mais ce n’est pas inévitable. D’autre part, le fait que la paix et la stabilité tant désirées reposent sur la parole de gens dont nous savons qu’on ne peut pas leur faire confiance. C’est un problème considérable ; toutefois, étant donné cet accord, mais aussi les conséquences désastreuses de l’insurrection de 2024 pour les Kanaks, il semble peu probable qu’ils reprennent les armes avant cinq ou dix ans.
Telle que nous la voyons, la situation est donc très simple : c’est une course contre la montre. Si, dans 10 ans les Kanaks ne sont plus qu’un tiers de la population, voire moins, la potentialité d’indépendance (ou quasi-indépendance) contenue dans l’accord restera une simple potentialité, et les loyalistes auront gagné leur pari : concéder des symboles, puissants, mais dépourvus d’effets juridiques directs, en échange de la capacité à agir pour faire prospérer une Nouvelle-Calédonie qui pourrait ainsi, malgré tout, rester française. Sinon ? Eh bien, sinon, la prochaine étape sera la déclaration d’indépendance de l’État de Kanaky, suivie de sa reconnaissance effective par la communauté internationale et son entrée à l’ONU comme membre de plein droit. Tout reste donc à écrire ; cet accord est immensément risqué, mais l’espoir nous est permis.
[1] Selon nos informations, ce point n’a pas été discuté du tout à Bougival.
[2] Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, art. 1.