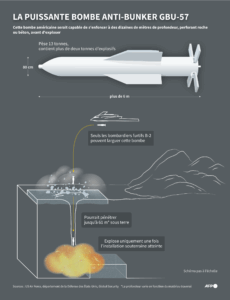Le droit naturel est l’un des concepts les plus obscurs de la science juridique, car son sens n’a cessé d’évoluer. Cherchant à établir des normes universelles indépendantes du temps et de l’espace, il a toutefois reçu des significations variées, voire contraires, bien qu’il ait été constamment distingué du droit positif, c’est-à-dire du droit particulier, conventionnellement posé en un temps et en un lieu par une institution. Restituer les étapes de sa permanente transformation constitue l’intention du présent article.
Article paru dans le no56 – Trump renverse la table
Pour comprendre les enjeux de l’évolution du droit naturel, il convient de partir d’une très brève indication d’Aristote dans l’Éthique à Nicomaque (V, 1134b18-21). Réfléchissant au concept de justice entendue comme moyen de donner à chacun ce qu’il mérite, le Stagirite remarque qu’il est deux manières de fonder le caractère juste (dikaion) d’une relation : la première peut rechercher un fondement naturel (physikon), tandis que la seconde peut prendre appui sur ce qui est conventionnellement admis comme légitime (nomikon), si bien qu’apparaît l’idée que tout un pan de ce qui est juste repose sur ce que la nature présente comme normal. Il n’y a guère lieu d’être surpris, car la Physis grecque – la nature – ne renvoie pas à un simple ensemble de choses, mais bien plutôt à une force productrice qui, entre autres, produit des normes. À cet égard se comprend le fait qu’Aristote recherche un critère universel de ce qui est juste, critère qui ne peut évidemment se trouver dans les conventions locales et temporaires, mais qui ne peut avoir de sens que si la nature, en son universelle productivité, produit des normes elles-mêmes universelles.
Il faut aussitôt préciser qu’Aristote n’emploie pas le syntagme de « droit naturel », bien que se trouve évoquée – très succinctement – la nécessité que ce qui est universellement juste reçoive une assise naturelle. De ce fait se comprend l’évidence suivante, à savoir que ce que l’on appelle le droit naturel antique ne désigne aucunement un corpus juridique, mais bien plutôt une réflexion sur l’universalité du juste inscrite dans une nature elle-même conçue comme normative.
Une confirmation de cette approche peut se trouver chez Cicéron qui, lui, emploie expressément l’expression de « droit naturel », de jus naturale, en particulier dans la République (III, xi, 18) afin de désigner explicitement une forme universelle du juste. La langue latine favorise volontiers ce lien en raison de la très grande proximité de jus (droit) et justum (juste), proximité que nous avons hélas perdue en français. Comme Aristote, Cicéron considère que la natura, là encore conçue comme force native de production, est pourvoyeuse de normes justes, pouvant être découvertes à l’échelle universelle, et ce en dépit du constat empirique d’une divergence des lois et des règles en vigueur dans les différentes cités.
Une vision antique poursuivie au Moyen Âge
Bien sûr, il serait tentant de considérer que le monde médiéval christianisé aurait dû rompre avec cette approche puisque l’une des conséquences majeures du christianisme fut de changer la signification de la nature. De dynamique productive et normative, elle est devenue ensemble des choses créées par Dieu, et a perdu sa spontanéité productrice. Néanmoins, la traduction en latin des œuvres d’Aristote ouvrant l’ère scolastique a contrebalancé cette révolution et a comme restitué la portée normative de la nature, fût-elle créée par Dieu. C’est ainsi que, seize siècles après Aristote, dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin, en particulier dans la IIa IIae, question 57, article 2, se retrouve une réflexion aux résonances antiques. L’Aquinate y distingue en effet le droit naturel – jus naturale – du droit positif – jus positivum – et conserve l’optique générale du Stagirite qui était celle de la justice. Par celle-ci, il convient d’entendre une relation envers autrui par laquelle on cherche à établir une certaine égalité de proportion. Or, une telle égalité peut soit s’enraciner dans la nature des choses, ex ipsa natura rei, soit procéder d’une convention que les hommes considèrent comme juste. Contrairement à Aristote, Thomas propose plusieurs exemples dont celui de l’échange : un échange n’est conforme à sa propre nature, c’est-à-dire n’est véritablement un échange, que s’il établit une égalité entre les agents, que si donc chaque agent reçoit autant que ce qu’il donne. C’est là un rapport juste en vertu du droit naturel, car fondé dans la nature même de la chose.
À lire aussi : Podcast. Platon / Aristote : la République et la cité. Damien Theillier
Par ce biais se comprennent deux points décisifs : d’une part, bien que Thomas utilise le terme de jus, il maintient son lien avec la justice et n’en fait pas un corpus juridique. D’autre part, si le droit naturel renvoie à la nature des choses, ce n’est plus parce que la nature est spontanément productrice, mais parce que Dieu a assigné une fin à toute chose qu’il s’agit d’accomplir. Dans tous les cas, même avec la révolution chrétienne, demeure l’idée que la nature ne se réduit pas à ce qui est, mais contient une sorte d’exigence normative que recueille le droit naturel indiquant la voie du juste.
Le rôle de l’École de Salamanque
Étrangement, c’est dans un cadre toujours scolastique, mais tardif, que va advenir le premier grand bouleversement du droit naturel. En effet, dans l’École de Salamanque dont les grandes figures sont Francisco de Vitoria (1483-1546) et Francisco Suarez (1548-1617), deux faits majeurs vont être observés. Le premier va consister à partiellement affranchir le droit du juste, et à le rediriger vers la notion de loi. En d’autres termes, l’espèce d’équivalence entre jus et justum va se trouver occultée au profit d’une réflexion sur la légalité et la loi. La seconde innovation réside dans l’émergence d’une réflexion sur ce que l’on peut appeler aujourd’hui le « droit subjectif », c’est-à-dire sur la puissance dont dispose chaque individu et, partant, sur les prérogatives qui reviennent à chacun. Il est d’ailleurs probant, comme l’a montré Michel Villey dans La formation de la pensée juridique moderne, qu’une telle innovation ait trouvé sa genèse dans la pensée franciscaine, le fondement nominaliste de cette dernière ne reconnaissant d’existence réelle qu’à l’individu et ne pouvant donc conduire qu’à transformer le droit naturel en prérogative individuelle.
De cette lente gestation, c’est De Legibus de Suarez (1612) qui en donne le résultat le plus abouti : non seulement, écrit ce dernier, jus legem significare (De Legibus, I, 2, 6), le droit signifie la loi, c’est-à-dire n’est plus indexé au juste, mais entre au contraire dans le domaine strictement juridique de la légalité positive, mais en plus s’ouvre une seconde signification morale par laquelle il devient une faculté donnant à chaque individu une prérogative propre. Il en découle évidemment que si droit naturel il y a, ce ne peut plus être l’indication naturelle du juste, mais bien plutôt une qualité morale propre à chaque homme découlant de la loi, et se laissant formuler en préceptes.
À lire aussi : Le droit doit être au service des libertés. Entretien avec Thibault Mercier
L’apport capital de Grotius
Cette qualité morale, c’est-à-dire immanente à l’individu, va être reprise par Grotius (1583-1649) dans son maître ouvrage de 1625, Du Droit de la guerre et de la paix. Bien que celui-ci ne cite pas Suarez, il élabore une doctrine du droit naturel très proche de celle de ce dernier, témoignant de ce que charriait l’air du temps. Le droit naturel n’est plus celui provenant de la nature des choses, mais penche de plus en plus vers la seule nature humaine, devenue réservoir de principes, dont deux se détachent : la nécessité de se conserver soi-même, et la nécessité d’établir des relations sociales. Autrement dit, ce à quoi nous assistons en ce début de xviie siècle, c’est à la progressive neutralisation de la nature qui devient muette, qui n’est plus conçue comme normative, de telle sorte que les hommes recherchent en eux-mêmes – dans leur nature propre – les règles à suivre. Grotius écrit ainsi que le droit naturel est « un droit propre à l’humanité » (I, 1, xii), et « une règle que nous suggère la droite raison » (I, 1, x), affranchissant ainsi un tel droit de la nature des choses ou de la nature en général, voire l’affranchissant de Dieu, car « le droit naturel, écrit notre juriste, est tellement immuable qu’il ne peut pas même être changé par Dieu ». (Ibid.)
À lire aussi : L’Art devant la justice. L’affaire Druet- Cattelan
Quoi qu’il en soit du rôle de Dieu dans le droit naturel, un point mérite d’être souligné : l’approche moderne de celui-ci ne cesse d’affaiblir, voire de détruire, l’intime connexion du jus et du justum. Le droit n’est plus l’objet précis et exclusif de la justice, mais devient progressivement une dépendance de la loi (Suarez). De surcroît, lorsque ce droit est naturel, il ne procède plus de ce qu’indiquent les choses, mais au contraire de ce que la nature humaine, en tant que rationnelle, considère comme essentiel ; il demeure certes universel, en vertu de l’universalité de la raison, mais ne consiste plus à chercher des normes universelles de justice puisqu’il devient au contraire la détermination de ce que la nature humaine indique comme convenant à l’homme, comme conforme à son intérêt.
Hobbes et le Léviathan
La radicalisation de cette évolution est particulièrement sensible dans le Léviathan de Hobbes (1651). Affranchi de toute idée de justice, le droit naturel tel qu’il s’exprime chez le philosophe anglais peut être conçu comme ce que la raison découvre dans la nature humaine, à savoir une série de prérogatives permettant de satisfaire une obligation naturelle. En effet, il y a au fondement de la réflexion hobbesienne une exigence, celle de se conserver en vie, c’est-à-dire de conserver la vie de l’individu. À cette obligation que découvre la raison répond la liberté d’utiliser tous les moyens permettant de parvenir à cette fin : une telle liberté inscrite en chacun d’entre nous est ce que Hobbes appelle le droit naturel. En d’autres termes, le droit naturel bascule tout entier du côté subjectif, en tant qu’il devient la liberté subjective d’utiliser tous les moyens possibles pour préserver sa vie. Bien sûr, l’usage généralisé de ce droit naturel génère des interactions telles qu’elles finissent par menacer ma survie, si bien que ma raison m’amène à comprendre que j’ai intérêt à transférer une grande partie de mon droit naturel au souverain (à condition qu’autrui en fasse de même), afin d’éviter que la situation ne devienne trop périlleuse, car trop belliqueuse.
À lire aussi : Hegel et la philosophie du droit
Avec Hobbes, une sorte d’explicitation de ce qui était en gestation depuis plus d’un siècle se trouve accomplie. Le jus ne renvoie plus au justum, n’est plus l’objet de la justice, mais devient une série de prérogatives individuelles, par lesquelles les individus sont autorisés à agir de telle ou telle manière. Le droit n’est donc plus ce qui est droit, mais devient ce à quoi l’individu a droit pour préserver sa vie. Quant à la nature, elle n’est plus cette force dynamique et féconde d’où procède une certaine normativité, mais elle se restreint à la seule nature humaine qui, universelle, s’exprime en chaque individu. Le droit naturel devient donc tout entier ce que la raison de l’individu lui indique comme étant ce à quoi il a droit en vertu de son humanité. C’est en ce sens précis que Locke, dans le Second Traité du gouvernement (1689) fonde sa célèbre doctrine de l’appropriation privative. La raison naturelle nous enseignant « que, sitôt nés, les hommes possèdent un droit à leur propre préservation, et par conséquent à la nourriture, à la boisson, et à toutes les autres choses que la nature offre pour leur subsistance » (V, 25), elle nous amène à déduire de l’exigence de préservation de soi le droit de s’approprier ce qui se révèle utile à la survie, faisant donc de la propriété privée un élément décisif du droit naturel.
Il ne faudrait toutefois pas s’imaginer que l’évolution du droit naturel fût parfaitement linéaire et se fût dirigée sans accrocs vers l’érection de la nature humaine comme sens exclusif de ce qui, dans un tel droit, fût naturel. C’est ainsi que Pufendorf (1632-1694) put nuancer les fondements de la naturalité du droit et réintroduire en partie l’exigence d’une nature des choses, contrebalançant l’idée qu’il n’y eût de droit naturel qu’à partir des principes inscrits dans la seule nature humaine. Son De jure naturæ et genitum de 1672 rétablit en partie une normativité de l’ordre du monde et fit pendant à la tendance dominante de son temps bien que, comme Suarez, l’essentiel de sa réflexion finît par faire de la loi l’élément essentiel du propos.
Le droit naturel et les droits de l’homme
Au fond, cette rupture introduite par l’École de Salamanque – consistant à affranchir le droit naturel d’une réflexion sur le juste au profit d’une détermination des prérogatives universelles de l’individu déterminables par la raison –, reçoit sans aucun doute son accomplissement dans les grandes déclarations de droits du xviiie siècle. Pour nous, Français, l’un des textes les plus connus de notre tradition politique est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (désormais notée DDHC) qui, dès son préambule, déclare exposer « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». Rédigé par Mirabeau et Mounier, ce préambule affirme ainsi que, quel que soit le régime politique dans lequel vivent les hommes, ces derniers sont universellement porteurs de droits inscrits dans leur nature et indépendants de tout contexte historico-géographique. C’est là l’aboutissement de deux siècles de mutation du droit naturel.
À cet égard, la Déclaration de 1789 ne prétend aucunement créer les droits qu’elle énonce et ne prétend pas même les découvrir, car ceux-ci sont consubstantiels à l’humanité et caractérisent chaque individu depuis que l’homme est homme. De même, la Déclaration d’indépendance de 1776 rappelle-t-elle que les hommes « sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables », déclinés ensuite par le texte. Là s’exprime le fait qu’au xviiie siècle, le sens du droit naturel ne fait même plus débat : il est la formulation des droits subjectifs que détient chaque individu en vertu de son humanité, et n’est plus du tout la détermination des critères naturels du juste.
Si ces Déclarations ne prétendent pas découvrir de tels droits, mais simplement rappeler leur présence, c’est parce qu’ils n’ont pas toujours été perçus ni respectés. Ainsi, ce que prétend faire le texte de 1789, c’est combler une « ignorance » en la matière ou réparer un « oubli », car il se peut que ces droits – qui ont toujours et partout été détenus par l’homme – n’aient pas pour autant été connus ou reconnus par ce dernier. De même, la Couronne anglaise, en 1776, est présentée comme ayant succombé à une « longue suite d’abus et d’usurpations » contraires à ce qu’exige la dignité de la nature humaine. Cette manière de présenter les choses ouvre un nouveau champ, celui des politiques jugées inhumaines, car agissant contre la nature profonde des hommes par le mépris de leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi, il est impératif d’ajouter à la formulation des droits celle des conditions institutionnelles garantissant dans les faits la protection de ces derniers. Telle est la raison pour laquelle, en 1789, les droits de l’homme sont aussitôt accompagnés par ceux du citoyen, car seules les garanties civiques dessinent une politique authentiquement humaine.
À lire aussi : Champion de Cicé, artisan méconnu des «droits de l’homme et du citoyen »
Deux remarques pour conclure. La première invite à relativiser l’importance des mutations repérées depuis Aristote. Bien sûr, aussi bien le droit que la nature ont adopté différentes significations, et le sens du droit naturel a incontestablement connu de profonds changements. Mais ces derniers ne doivent pas être surestimés pour deux raisons. D’une part, il est à noter que la fonction du droit naturel n’a pas réellement connu de bouleversements, puisqu’il s’est toujours agi de déterminer une norme universelle, indépendante du temps et de l’espace. D’autre part, même si l’on prend les grandes Déclarations de droits du xviiie siècle, il n’est pas certain qu’elles aient rompu avec l’idée de justice. Si, en effet, on entend par juste ce qui convient à autrui, ce qui lui est ajusté, alors en formulant les droits contenus dans la nature humaine, aussi bien la Déclaration de 1776 que celle de 1789 nous disent ce que signifie traiter avec justice son prochain, à savoir la nécessité de traiter chaque individu comme un homme, c’est-à-dire comme un titulaire de droits fondamentaux ; respecter ces derniers définit exactement la juste conduite.
La seconde procède d’un étonnement ; rien ne prouve que le droit naturel existe ou ne soit autre chose qu’une spéculation. Que de si grands efforts aient été déployés pour déterminer la nature et le contenu d’un tel droit pourtant douteux en son existence montre à quel point l’homme se trouve guidé par l’exigence d’universalité. Mais il ne faut pas exclure qu’il s’agisse là d’une peine perdue, ce que Stendhal faisait dire au mélancolique Julien Sorel à la fin du Rouge et le Noir :
« Il n’y a point de droit naturel : ce mot n’est qu’une antique niaiserie bien digne de l’avocat général qui m’a donné chasse l’autre jour, et dont l’aïeul fut enrichi par une confiscation de Louis XIV. Il n’y a de droit que lorsqu’il y a une loi pour défendre de faire telle chose, sous peine de punition. Avant la loi, il n’y a de naturel que la force du lion, ou le besoin de l’être qui a faim, qui a froid, le besoin en un mot[1]. »
[1] Stendhal, Le Rouge et le Noir, II, XLIV, in Stendhal, Œuvres romanesques complètes, tome I, Gallimard, coll. « Pléiade », 2005, p. 796.