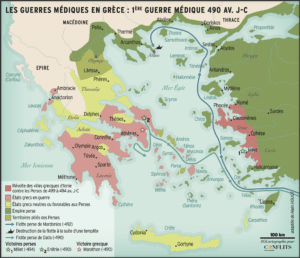Armand-Emmanuel du Plessis est mieux connu des Slaves que des Français, alors qu’à l’instar de son ancêtre, le cardinal de Richelieu, il s’inscrit indiscutablement dans la lignée des hommes d’État qui se sont illustrés à la tête du gouvernement français par leurs soucis du bien commun. Injustement oublié en France, le duc de Richelieu mériterait pourtant d’être redécouvert.
Marie-Astrid Azam est directeur du Comité Richelieu de l’ARCS. Elle est diplômée d’un M2 de Philosophie politique et éthique et d’une double licence Philosophie et Russe de Sorbonne Université.
Dans ses Anecdotes sur le czar Pierre le Grand, Voltaire rapporte la réaction de Pierre Ier face au tombeau du cardinal de Richelieu lorsque le tsar visita la chapelle de la Sorbonne en 1718. Il monta sur le tombeau, embrassa la statue, et s’exclama : « Grand ministre, que n’es-tu né de mon temps ! Je te donnerais la moitié de mon empire pour m’apprendre à gouverner l’autre ». Un homme témoin de la scène, à qui l’on traduisit les propos du tsar, aurait alors déclaré : « S’il avait donné cette moitié, il n’aurait pas longtemps gardé l’autre ».[1] Si la chapelle est à l’origine le mausolée du Cardinal, elle sert aussi de sépulture à un autre membre illustre de la famille des Richelieu, Armand-Emmanuel du Plessis. Comme son ancêtre, Armand-Emmanuel suscita l’admiration d’un tsar de Russie, à ceci près que ce fut de son vivant, contrairement au Cardinal. Le jeune Armand-Emmanuel ne tarda pas à se faire remarquer par la cour de Russie. Avant d’être au service d’Alexandre Ier, il avait déjà suscité l’émerveillement de Catherine II. Alors âgé de vingt-deux ans, Armand-Emmanuel offrit ses services à la Russie en tant que volontaire et réalisa son premier fait d’armes en prenant d’assaut l’une des forteresses turques de la frontière du Danube. Catherine II, impressionnée par cet exploit militaire, déclara : « Il n’y a qu’une voix sur le duc de Richelieu d’aujourd’hui. Puisse-t-il jouer le rôle du Cardinal un jour en France, sans en avoir les défauts. En dépit de l’Assemblée nationale, je veux qu’il reste duc de Richelieu et qu’il aide à rétablir la monarchie »[2]. En récompense de sa bravoure, Catherine II le décora de la croix de Saint-Georges et lui fit don d’une épée en or.[3]
À lire aussi : Patrimoine : le rôle de la chapelle de la Sorbonne
Une éducation par le voyage
Armand-Emmanuel reçut une éducation qui accordait une importance centrale aux voyages. En 1787, il quitta la France pour partir en Italie et en Allemagne, accompagné de son précepteur l’abbé Labdan. À chaque étape de son voyage, le jeune Armand-Emmanuel perfectionna ses connaissances. Il fut initié à des disciplines variées, telles que l’art du commerce, des fortifications et de la guerre[4]. L’abbé Labdan décrit les journées d’Armand-Emmanuel comme étant bien remplies. Il arriva une fois à son élève de passer une journée entière avec des négociants étrangers durant laquelle il se fit expliquer les rouages du commerce, leçon dont il se souviendra plus tard en Russie. Un autre jour, le jeune homme s’entretint de l’art de la guerre avec des officiers qui se trouvaient chez M. de Fumel, gouverneur de Château-Trompette.[5] Maîtrisant déjà parfaitement l’allemand, Armand-Emmanuel continua son apprentissage des langues en prenant des leçons d’italien à Gênes, où il fut reçu par le sénat de la ville qui, trente-cinq ans auparavant, avait décerné à son grand-père le maréchal le titre de noble génois transmissible à toute sa descendance pour avoir défendu la ville contre les Autrichiens[6]. À Florence, Richelieu rencontra le dernier des Stuarts, « le bonie prince Charles » [7]. En 1784, à Munich, Armand-Emmanuel fut présenté à l’Électeur de Bavière Charles-Théodore, qui l’avait déjà rencontré en Italie peu de temps auparavant et qui avait trouvé le comte de Chinon[8] « si bien élevé ». À Berlin, il fut introduit auprès de Frédéric II. À peine âgé de dix-huit ans, le jeune Armand-Emmanuel avait donc déjà rencontré la plupart des princes d’Europe[9]. La bonne réputation d’Armand-Emmanuel a certes été favorisée par la notoriété de son grand-père et par son appartenance à la famille de Richelieu, mais elle ne s’est pas forgée indépendamment de ses mérites personnels. Le marquis de Bombelles, qui le rencontra à la Cour en janvier 1785, le trouva « bien moins nul que son père et beaucoup plus honnête que son grand-père ». D’après le comte de Langeron, il affichait « une sévérité de mœurs, une espèce de raideur, un esprit plus solide que brillant, peu fait pour la société frivole de son temps […]. Sa vertu en imposait aux jeunes gens de son âge qui l’estimaient en s’éloignant de lui […]. Son style était sévère, concis, fort d’idées, plus profond qu’élégant, et sa conversation ressemblait à son style. ».[10]
À lire aussi : Richelieu, l’éminente diplomatie française
Sens de l’observation, prudence, vivacité d’esprit, pragmatisme : toutes ces qualités qui caractériseront plus tard Armand-Emmanuel dans l’exercice de ses fonctions se sont développées à l’occasion de son voyage d’instruction. Durant ce périple, le comte de Chinon fit aussi un long séjour à Vienne où il rencontra Joseph II. La pertinence et la subtilité du portrait qu’il dresse quelques années plus tard de ce prince controversé témoigne de ses qualités précoces d’observateur des grands de ce monde : « Jamais prince ne souhaita plus ardemment le bien, et jamais peut-être aucun ne fit en si peu de temps autant de mal à son pays ; imbu des principes des philosophes et des économistes, il les alliait avec son goût pour le despotisme, et il en résulta qu’en augmentant son autorité il nivela pour ainsi dire tous les états […]. Joseph avait certainement beaucoup d’esprit, mais de cet esprit faux, plus nuisible qu’utile, et qui chez un prince est un véritable fléau. Son grand défaut fut de vouloir ramener tout au même principe d’uniformité. »[11]
Le gouverneur d’Odessa et la peste de 1812
En 1803, Armand-Emmanuel est nommé par le tsar Alexandre Ier gouverneur d’Odessa, dont il est considéré comme l’un des pères fondateurs. En 1805, il est également fait gouverneur-général de toute la région de Nouvelle-Russie. Grâce à ses talents d’administrateur, Odessa connut un véritable essor et devint une ville prospère. Les Odessistes étaient si attachés à leur gouverneur que l’annonce de sa mort en juin 1822 fut pour eux un véritable choc. La ville se plongea immédiatement dans le deuil : les théâtres furent fermés et tous les divertissements annulés[12]. En 1828, une statue fut érigée en l’honneur du Duc. Il est représenté en toge romaine, tenant dans sa main un parchemin et portant à sa taille une épée, car comme l’explique le créateur du monument, Ivan Martos : « le duc ne fut pas seulement l’administrateur de nombreux territoires et un sage gouvernant, mais également un vaillant guerrier »[13]. De nombreux Marseillais contribuèrent au développement de la cité portuaire de Nouvelle-Russie. Parmi eux on trouve le négociant Charles Sicard, qui fit fortune en créant avec ses deux frères une grande société commerciale à Odessa[14]. Le port de la mer Noire reçut le surnom de « Marseille slave ». Odessa et Marseille entretinrent des liens institutionnels jusqu’à l’époque contemporaine, les deux cités portuaires étant officiellement jumelées depuis 1972. Dès sa création Odessa est une ville cosmopolite où se côtoient Russes, Juifs, Grecs, Bulgares, Allemands, Italiens ou encore Français. [15]
En août 1812, une épidémie de peste venant de Constantinople frappa de plein fouet la ville au moment même où Napoléon envahissait la Russie. Durant cette période, la population d’Odessa fut confinée sur l’ordre de Richelieu. Cinq cents Cosaques venus du Boug furent chargés de bloquer la ville et de patrouiller dans les rues afin de veiller au respect de la quarantaine.[16] L’épidémie fit plus de 2600 victimes dans la ville (soit 1/8 de la population).[17] Mais la gestion efficace de la crise par le duc de Richelieu permit que la peste s’éloignât de la ville au bout de six mois : « La peste est, Dieu merci, absolument terminée partout, et depuis près de deux mois, écrit le duc de Richelieu. Toutes les maisons sont désinfectées ainsi que les effets, les gens guéris de la peste, lavés au vinaigre et habillés de neuf, leurs habits brûlés, les effets cachés et enterrés […]. De cette manière l’on peut espérer que la peste ne reparaîtra pas »[18]. À l’occasion de cette épidémie, le duc de Richelieu s’illustra tout particulièrement par son dévouement envers ses Odessistes. Pour l’en remercier, le tsar lui aurait offert quarante mille roubles reversés intégralement par le duc pendant l’hiver pour les victimes de l’épidémie[19]. Cet épisode tragique, particulièrement éprouvant à la fois pour Richelieu et pour ses administrés scella la popularité du gouverneur auprès de la population. Joseph de Maistre salua également le comportement exemplaire du duc : « Monsieur le duc de Richelieu […] a trouvé dans ce fléau une occasion nouvelle de se montrer, non pas meilleur que les autres, mais, s’il est possible, meilleur que lui-même »[20]. Richelieu fut profondément affecté par le fléau qui venait de frapper sa « chère Odessa », et il lui arrivait de succomber à des moments d’abattement : « Mon cœur se fend de devoir employer toute mon autorité à rendre désertes ces rues, quand j’ai travaillé pendant dix ans à les peupler et à les animer »[21].
À lire aussi : La peste d’Athènes. Épidémie et conséquences politiques
Après avoir traversé une telle crise, il n’eut qu’une envie, celle de distraire son esprit en rejoignant en Allemagne les troupes d’Alexandre, vainqueur de Napoléon : « Je voudrais sortir de cet enfer et renaître un peu à la vie. Mon corps et mon âme sont usés par le chagrin et, quoique je n’aie pas été un moment malade, je sens que sans une distraction vive je succomberai et je ne serai plus du tout bon à rien ». Ses supplications demeurèrent malheureusement sans réponse, et Richelieu déduisit de ce silence que ses relations avec Alexandre s’étaient visiblement dégradées. Mais Alexandre avait-il seulement reçu les lettres de Richelieu ? Dans cette affaire, celui que certains historiens surnomment le « mauvais génie » d’Alexandre[22], le comte Alexis Araktcheïev, ce favori aussi zélé que grossier et cruel, ministre de la guerre depuis 1808, n’aurait-il pas fait barrage entre le duc et le tsar ? Ancien proche de Paul Ier, Araktcheïev devint extrêmement influent durant la dernière partie du règne d’Alexandre. Il était connu pour surveiller de près l’entourage du souverain, n’hésitant pas, parfois, à écarter ses anciens proches. Quoi qu’il en soit, l’impression d’une détérioration des relations entre Alexandre et Richelieu semble se confirmer lorsque Alexandre envoie en Nouvelle-Russie son ex-ministre de l’Intérieur, le prince Kourakine, auquel il confie la mission de coordonner les mesures nécessaires pour mettre définitivement un terme aux derniers soubresauts de l’épidémie de peste[23]. Or Kourakine souhaite durcir les mesures sanitaires, ce que conteste vivement Richelieu. Le duc de Richelieu, soucieux de relancer le commerce, demande la levée du cordon sanitaire qui ferme Odessa, mais propose une réforme des quarantaines qui augmenterait la surveillance des ports de la mer Noire. Kourakine choisit au contraire de renforcer le cordon sanitaire. Pour Richelieu, ces mesures ne font que troubler la paix qu’il s’était efforcé, tant bien que mal, de ramener : « La célébration de Pâques, qui suppose les contacts les plus étroits […] n’a pas été marqué par un seul incident malheureux dans toute la région. À Pâques j’ai embrassé plus de 200 personnes de différentes classes sociales […] Pourquoi tourmenter en vain les paysans et les cosaques ? Pourquoi entraver le commerce maritime ? Ayez pitié de cette terre malheureuse ! »[24]. Richelieu ne s’entend décidément pas avec Kourakine. De fait, la rigueur des mesures prises par ce dernier s’avèrent contre-productive. Les Odessistes accablés par la pauvreté finissent par enfreindre les mesures de sécurité : les effets contaminés enfouis et qui devaient être brûlés sont déterrés, provoquant la résurgence de foyers infectieux. Alors que Richelieu est qualifié « d’ange sauveur »[25], Kourakine quant à lui, est désigné par le sobriquet de « prince de la peste » par les Odessistes[26].
Le retour en France
C’est durant cette période difficile pour Richelieu qu’en France Louis XVIII remonte sur le trône. Après la première abdication de Napoléon le 6 avril 1814, Armand-Emmanuel quitte Odessa le 28 septembre pour regagner sa patrie[27]. Richelieu s’en va le cœur serré, tandis que les Odessistes pleurent le départ de leur gouverneur tant apprécié : « Le sentiment de douleur avait prévalu et l’on s’élança pour ainsi dire sur le duc qui allait monter en voiture […]. Il était entouré, pressé par la foule et lui-même fondait en larmes »[28].
À lire aussi : Podcas – Richelieu, par Arnaud Teyssier
Ses relations avec le tsar semblent enfin s’améliorer. Alors qu’il se trouve à Paris en 1814, Alexandre rend visite à la duchesse de Richelieu et lui parle de son mari en termes élogieux[29]. Richelieu revoit enfin le tsar à Vienne au mois d’octobre. Mais l’audience ne se passe pas aussi bien qu’il aurait pu l’espérer. Le tsar se montre froid et la discussion porte essentiellement sur le sujet des colonies militaires, projet à la tête duquel le tsar a placé Araktcheïev. L’objectif de ces colonies était de faire appliquer aux paysans une discipline toute martiale. Malheureusement, l’expérience des colonies militaires se termina en drame : la violence qu’y faisait régner Araktcheïev conduisit à des révoltes[30]. Dès 1814, Richelieu avait mis en garde le tsar contre les dangers d’un tel projet. L’avenir lui avait donné raison.
Le traité de paix de 1815
En septembre 1815, le roi Louis XVIII appela Richelieu à la tête du gouvernement : Richelieu succéda à Talleyrand à la fois comme président du Conseil des ministres et comme ministre des Affaires étrangères. Le Roi confia à Richelieu le dossier extrêmement délicat des négociations du traité de paix avec les Alliés. L’appui du tsar joua en faveur de Richelieu et de la France dans les négociations, mais cette proximité de Richelieu avec le souverain russe lui porta également préjudice dans l’opinion. Quel que fût son respect pour le tsar, Richelieu ne se souciait que du bonheur des Français et des intérêts de la France, comme en témoigne le cardinal de Bausset. Ce dernier confesse avoir été frappé chez Richelieu par son « abnégation de lui-même qui ne lui laisse qu’un seul sentiment, celui de voir la France tranquille et heureuse, sans aucun retour sur sa gloire personnelle »[31]. Mais, malgré sa droiture et son patriotisme sincère, Richelieu fut attaqué pour ses liens avec la Russie. Le 11 septembre 1814, Alexandre décida de faire défiler pendant cinq heures quarante-cinq mille hommes et cinq cents canons devant tout l’état-major allié pour faire comprendre à la Prusse, fort mal disposée à l’égard de la France et décidé à l’humilier, qui était réellement à la tête des alliés. Lors de cette démonstration de force si utile aux intérêts de la France, Richelieu se tint aux côtés du tsar, en grand uniforme de lieutenant-général au service de la Russie. Or cette cérémonie eut lieu dix jours avant sa nomination comme président du Conseil[32]. Il ne faudrait cependant pas croire pour autant que l’aide du tsar eût été mal vue de tous les Français. Le comte de Molé écrivit dans ses Mémoires qu’« en 1815, la Russie défendait, contre tous, je ne dirai pas les intérêts, mais l’existence même de notre infortunée patrie. Si la France est encore la France, elle le doit à trois hommes dont il ne faut jamais qu’elle oublie les noms : Alexandre, ses deux ministres, Cappo d’Istria et Pozzo di Borgo. L’Angleterre, la Prusse et l’Autriche ne songeaient qu’à nous affaiblir. La Russie, au contraire, avait tout intérêt à ce que nous restions une puissance de premier ordre ».[33] Le choix par Louis XVIII de l’ancien gouverneur de Nouvelle-Russie comme chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères contribua sans aucun doute à conforter le tsar dans ses bonnes dispositions à l’égard de la France à ce moment tragique de son histoire.
À lire aussi : Nicolas II, le dernier tsar
Le 20 novembre 1815, Richelieu signa le traité de paix, non sans amertume : « J’ai apposé plus mort que vif mon nom à ce fatal traité […] j’ai la confiance de croire que personne n’aurait obtenu autant. »[34]. Le surnom de « noble négociateur »[35] que Chateaubriand lui donne dans ses Mémoires est justifié. Armand-Emmanuel est en effet parvenu à limiter les dégâts. Comme le souligne Molé, il est désormais indiscutable que « de tous les jargons qu’on parle dans les affaires, c’est celui de la diplomatie que Monsieur de Richelieu entend et parle le mieux ». Ainsi, la diplomatie et les relations qu’Armand-Emanuel avait conservées avec le tsar lui permirent de parachever l’œuvre du Diable boiteux en assurant le retour de la France parmi les grandes puissances du concert des nations.
Tensions avec les ultras-royalistes
La signature du traité intervint dans le contexte troublé de l’affrontement entre le gouvernement et la majorité ultra-royaliste de la Chambre des députés.[36]. Richelieu était désespéré de voir le peuple se préoccuper davantage de ces débats que des négociations de paix : « Quelle existence d’être ainsi sous la tutelle des étrangers d’une manière si humiliante… et vous croyez que les Français ressentent uniquement l’horreur de cette situation ; point du tout, ils sont occupés de leurs querelles de partis ; ils me rappellent les Grecs du Bas-Empire qui s’égorgeaient dans leurs cirques pour les couleurs verte ou bleue des habits de leurs cochers, pendant que les musulmans étaient à leur porte »[37]. Par prudence politique, Richelieu refuse de choisir un parti. Pour décrire la posture qu’il décide d’adopter, Armand-Emmanuel détourne avec humour l’expression nec cintra nec ultra[38] en « ni ultras ni citras ». La Révolution était indiscutablement un mal pour Richelieu, mais c’était « un malheur… auquel il fallait bien se résigner pour en éviter un plus grand »[39]. Cependant, il considère comme totalement dépourvu de raison le projet des ultra-royalistes qui n’ont rien appris et rien oublié et pensent pouvoir revenir à l’état antérieur à 1789 : « Les insensés s’imaginent qu’ils rétabliront sans peine toutes les institutions que la Révolution a détruites et ils ne voient pas que la suite immédiate d’une pareille entreprise serait de faire couler en France des torrents de sang et de la livrer ensuite à l’étranger ».[40]
Armand-Emmanuel de Richelieu n’est pas de ces politiques que l’on pourrait réduire à son appartenance à un parti. Le duc était un pragmatique, mais c’était aussi un idéaliste. Il n’agissait pas par intérêt personnel, mais toujours par devoir et par affection pour ceux qui lui étaient confiés. Pour qualifier la période pendant laquelle il a gouverné Odessa, on parle d’ailleurs de « dictature de l’honnêteté »[41]. Armand-Emmanuel prouve par son exemple que non seulement politique et honnêteté ne sont pas incompatibles, mais que cette honnêteté peut et doit être exigée de ceux qui se mettent au service de l’État. Richelieu n’était pas un pacifiste béat, mais un véritable artisan de paix, armé de toute la patience et la prudence, du réalisme et de l’abnégation qu’exige une telle ligne de conduite. Alors qu’il venait d’apporter la prospérité à Odessa, la peste de 1812 avait menacé de ravager son œuvre. Richelieu sut en endiguer les effets et soulager les Odessistes. En 1815, il mit toute son énergie à la construction de la paix avec les Alliés. Enfin, il fit également tout son possible pour préserver la paix intérieure dans une France encore profondément divisée en refusant d’entrer dans la mêlée lorsque les ultra-royalistes et le gouvernement se lancèrent dans la confrontation. Mais sa modération et son sens du devoir s’accompagnaient d’une profonde sensibilité, comme en témoigne cet épisode : alors qu’il se trouvait sur le champ de bataille et se battait contre les Turcs, le duc sauva la vie d’une fillette : « J’aperçus un groupe de quatre femmes égorgées, entre lesquelles un enfant d’une figure charmante (une jeune fille de dix ans) cherchait un asile contre la fureur de deux Cosaques qui étaient sur le point de la massacrer… Je n’hésitai pas à prendre entre mes bras cette infortunée, que ces barbares voulurent y poursuivre encore […] souvent, je fus obligé de franchir plusieurs cadavres en tenant dans mes bras ma petite, à qui je voulais épargner l’horreur de fouler aux pieds les corps de ses compatriotes »[42]. Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu ne faisait pas de distinction entre ceux qui avaient besoin de son aide, qu’ils fussent français, russes ou turcs. Homme imprégné de la philosophie des Lumières et tout entier dédié au bien commun, Richelieu œuvra aussi bien au bonheur de ses chers Odessistes, qu’à la gloire de la France, en digne héritier de l’illustre cardinal.
À lire aussi : Testament politique de Richelieu : en toutes choses raison garder
La présence d’Armand-Emmanuel du Plessis est signalée dans la chapelle de la Sorbonne par une plaque sur laquelle figurent d’autres noms de la famille des Richelieu. Le Duc possède un cénotaphe en contrebas de la nef. L’Association pour le Rayonnement de la Chapelle de la Sorbonne (ARCS) organise le 6 février 2025 à 18h30 dans l’amphithéâtre 1 du Centre Panthéon (12, Place du Panthéon, 75005 Paris) une conférence sur le Duc. Cette conférence, donnée par Emmanuel de Waresquiel, s’intitule « Armand-Emmanuel, duc de Richelieu 1766-1812 : de l’Empire au Royaume ».
[1]Œuvres complètes de Voltaire, Garnier, tome 23 (p. 281-293), « Anecdotes sur le Czar Pierre le Grand »
[2] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 14
[3] Rambaud A., « Le duc de Richelieu en Russie et en France », Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 84, 1887 p. 628
[4] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p 38
[5] Sorbonne F.R., Correspondance, 68 : l’abbé Labdan à Godin, 16 novembre 1782
[6] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009 p. 39
[7] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009 p. 40
[8] Armand-Emmanuel porta successivement trois titres : d’abord comte de Chinon, puis duc de Fronsac à partir de 1788 au moment du décès du maréchal, et enfin duc de Richelieu depuis le décès de son père en 1791.
[9] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009 p. 42
[10]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 43
[11] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 41
[12] Глаголева Е., Дюк де Ришельё, ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2016, р. 7
[13] Глаголева Е., Дюк де Ришельё, ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2016, р. 8
[14] Глаголева Е., Дюк де Ришельё, ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2016, р. 98
[15]Polevchtchikova E. et Triaire D., Lettres d’Odessa du duc de Richelieu 1803-1814, Centre international d’étude du xviiie siècle Ferney-Voltaire, 2014, p. 19
[16]Глаголева Е., Дюк де Ришельё, ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2016, р. 175
[17] Polevchtchikova E. et Triaire D., Lettres d’Odessa du duc de Richelieu 1803-1814, Centre international d’étude du xviiie siècle Ferney-Voltaire, 2014, p. 52
[18] Polevchtchikova E. et Triaire D., Lettres d’Odessa du duc de Richelieu 1803-1814, Centre international d’étude du xviiie siècle Ferney-Voltaire, 2014, p. 149, Lettre 77
[19]N.S., Notice sur les travaux administratifs de Monsieur le duc de Richelieu dans la Russie méridionale », Journal asiatique, août 1822, pp. 88-89
[20]Joseph de Maistre à l’abbé Nicolle, 7 avril 1813 in Frappaz, Vie de l’abbé Nicolle, Paris, 1857, p. 97
[21] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 196
[22] Heller M., Histoire de la Russie et de son empire, Perrin, 2015, pp. 995-996
[23]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 196
[24]Глаголева Е., Дюк де Ришельё, ЖЗЛ, Молодая гвардия, 2016, р. 8
[25] Ce surnom lui fut donné par un habitant d’Odessa nommé Skalkovskii
[26] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 198.
[27]Langeron lui succède comme gouverneur d’Odessa en octobre 1815
[28]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 201
[29]Rambaud A, « Le Duc de Richelieu en Russie et en France », Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 84, 1887, p. 650
[30]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 207
[31] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 248
[32] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 247
[33]Mémoires du comte Molé, publiés et préfacés par la marquise de Noailles, Genève, 1944, cité par Constantin de Grunwald, Trois Siècles de diplomatie russe, op. cit., p. 165
[34]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 257
[35]Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 201
[36] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 261
[37] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 262
[38] « Ni d’un côté ni de l’autre »
[39] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 276
[40] Waresquiel, E. de, Le duc de Richelieu 1766-1822, Perrin, 2009, p. 276
[41] Polevchtchikova E. et Triaire D., Lettres d’Odessa du duc de Richelieu 1803-1814, Centre international d’étude du XVIIIe siècle Ferney-Voltaire, 2014, p. 54 (Haumant p. 250)
[42]Rambaud A, « Le Duc de Richelieu en Russie et en France », Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 84, 1887 , p. 627.