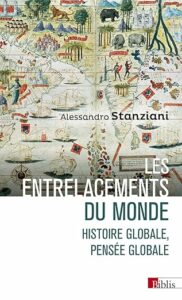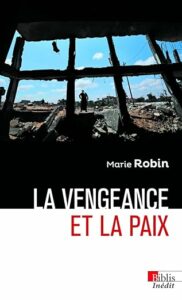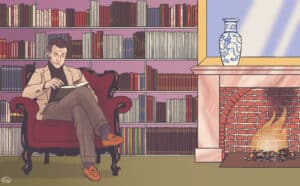Retour des recensions des parutions récentes. La rentrée littéraire sera dense dans le domaine de la géopolitique, de l’histoire et des idées politiques. Des recensions réalisées par Tigrane Yegavian
Hamit Bozarslan, L’anti-démocratie au XXIe siècle, CNRS éditions, 11 euros
Hamit Bozarslan, historien et politiste, occupe depuis des années une place importante dans l’analyse des violences politiques. Dans L’anti‑démocratie au XXIᵉ siècle, il forge un concept opératoire pour appréhender un phénomène inquiétant qui traverse notre époque : l’émergence de régimes « anti‑démocratiques ». À partir des cas de la Turquie d’Erdogan, de la Russie de Poutine et de l’Iran post‑révolutionnaire, Bozarslan explique que ces systèmes se donnent pour mission de répondre « nationalement » à une démocratie libérale accusée d’avoir affaibli la nation. Ils se réclament d’une tradition prestigieuse et se rêvent héritiers d’empires défaits, ce qui nourrit un discours de revanche et de pureté nationale.

Le portrait du leader anti‑démocratique que dresse Bozarslan est saisissant : figure quasi fictionnelle, omniprésente et énigmatique, il incarne la nation et prétend opérer une synthèse entre passé et avenir. Inspiré par Hannah Arendt, l’auteur souligne que ces chefs se perçoivent comme des « ponts » historiques et exigent une allégeance totale. La religion sert de ciment civilisationnel et permet d’inscrire la lutte dans une opposition manichéenne entre bien et mal. La guerre, enfin, est présentée comme la force motrice de ces régimes : elle fusionne la politique interne et externe en un « unique champ de guerre » et légitime la brutalisation de la société.
Bozarslan a le mérite de replacer ces analyses dans la longue durée, en comparant les anti‑démocraties actuelles avec des régimes totalitaires du XXᵉ siècle et en explorant les continuités idéologiques, institutionnelles et sécuritaires. Il montre aussi que ces systèmes se situent à mi‑chemin entre des concepts concurrents, comme la « démocratie illibérale » ou la « démocrature », sans s’y réduire. Le livre, dense et accessible, se lit comme une enquête sur les mécanismes de radicalisation et sur la brutalisation du politique. Il constitue un avertissement adressé aux démocraties fragilisées : derrière des urnes et des drapeaux, des régimes se construisent qui transforment la nostalgie de la grandeur en logique de guerre et sapent les fondements de l’état de droit.
Historien et directeur de recherche au CNRS, Alessandro Stanziani livre avec Les entrelacements du monde une synthèse ambitieuse sur ce que l’on appelle aujourd’hui « histoire globale » ou « histoire connectée ». Dans un contexte où l’histoire se décline encore largement à l’échelle nationale, l’ouvrage rappelle que le débat sur le rôle de l’histoire en France oscille entre défense de l’histoire nationale, difficulté à critiquer l’histoire coloniale et timide ouverture vers les « autres mondes ». Stanziani propose de sortir de ces clivages en s’appuyant sur une approche qui élargit les horizons géographiques, dépasse les cadres nationaux et étudie le monde à travers les connexions entre entités politiques et économiques hétérogènes.
L’ouvrage commence par un panorama historiographique : les premiers chapitres reviennent sur l’essor de l’histoire globale dans le sillage de la mondialisation et sur ses différentes déclinaisons – world history, histoire connectée, histoire croisée. Stanziani souligne que cette histoire décentrée remet en cause les récits téléologiques et insiste sur l’influence mutuelle entre plusieurs mondes. Il rappelle aussi que de nombreuses synthèses occidentales, de Christopher Bayly à Jürgen Osterhammel, restent marquées par l’européocentrisme et une certaine superficialité. En réaction à ces écueils, l’histoire connectée a montré l’interdépendance entre sociétés, mais en se concentrant trop sur les élites, elle a parfois négligé les non‑circulations et les hiérarchies. Stanziani plaide donc pour une articulation équilibrée entre histoire comparée et histoire connectée, ces deux approches étant complémentaires.
L’une des grandes originalités du livre tient à sa réflexion sur les relations entre histoire et autres disciplines. Stanziani analyse la filiation entre philosophie de l’histoire, sociologie et économie : il montre comment les Lumières, souvent accusées d’européocentrisme, ont été plus ouvertes qu’on ne l’imagine. Il revient sur l’influence de Max Weber, dont l’usage d’« idéaux‑types » a longtemps favorisé des comparaisons normatives fondées sur des catégories européennes et des schémas de rattrapage. L’auteur met en regard ces approches avec les critiques des subaltern studies, qui tentent de décentrer le regard tout en reproduisant parfois une essentialisation des cultures. Au fil des chapitres, il analyse aussi la manière dont le droit et l’économie importent des biais eurocentriques dans leurs tentatives de globaliser les phénomènes.
Le projet de Stanziani est moins de proposer une théorie abstraite de l’histoire globale que d’en esquisser une épistémologie critique et historique. Face au retour des nationalismes, il invite l’historien à souligner les interrelations et le métissage fondamental des sociétés tout en mettant en lumière les processus d’exclusion. Ce plaidoyer pour l’interdisciplinarité et l’apprentissage des langues vise à faire émerger une histoire véritablement mondiale qui prenne en compte circulations et ruptures, influences réciproques et asymétries.
Stanziani rappelle enfin que l’histoire globale ne fournit pas de réponses toutes faites : elle remet en question la prétendue supériorité de telle ou telle civilisation et montre l’origine contingente et métissée des valeurs. Son ouvrage, dense, mais accessible, constitue à la fois une introduction aux enjeux de l’histoire globale et une étude approfondie des circulations des savoirs historiques et de leurs interactions avec d’autres disciplines. Par certains aspects, il évoque le Nous et les autres de Tzvetan Todorov, mais s’en distingue par une perspective plus historienne que philosophique. Les entrelacements du monde est donc un livre de référence pour qui veut comprendre les ambitions, les limites et les promesses de l’histoire globale à l’ère de la mondialisation et des replis identitaires.
Marie Robin, La vengeance et la paix, CNRS éditions, 11 euros.
Politiste, spécialiste des conflits et des relations internationales, Marie Robin explore dans cet ouvrage un sujet aussi tabou qu’essentiel : la place de la vengeance dans l’ordre international. Face aux récits qui la relèguent au rang de passion archaïque, l’auteure montre que la vengeance agit en réalité comme une force structurante des relations entre États, groupes armés et sociétés. À travers des exemples qui vont de Gaza à l’Ukraine, de Paris à Khartoum ou Téhéran, elle analyse comment chefs d’État, organisations et citoyens invoquent la vengeance pour justifier des violences extrêmes, réparer des humiliations ou préserver un statut. Loin d’être un simple outil de communication, cette rhétorique dit beaucoup de ce que chacun considère comme juste.
La vengeance et la paix s’inscrit dans le sillage des recherches sur les émotions en relations internationales, en montrant que la gestion des ressentiments et des humiliations est un facteur décisif pour comprendre l’enchaînement des conflits et envisager une paix durable. En mobilisant une perspective historique, Robin montre que la vengeance n’est pas seulement un tropisme contemporain : elle traverse les époques et façonne la mémoire collective. L’ouvrage propose également des études de cas contemporaines qui interrogent la possibilité de « faire la paix » lorsque les désirs de revanche restent vifs. L’auteure souligne que, si l’on veut comprendre les ressorts des crises et penser la reconstruction, il faut entendre – sans les légitimer – les demandes de vengeance, car elles révèlent les valeurs et les aspirations des acteurs.
Au‑delà de l’analyse, Marie Robin invite à repenser les processus de paix. Comment concilier justice et réconciliation ? Que faire des revendications de vengeance pour éviter l’escalade et construire un ordre international plus stable ? En abordant ces questions, l’ouvrage interroge le droit international, la diplomatie et les politiques de mémoire, et démontre que l’apaisement ne peut être obtenu sans une écoute des griefs et un travail sur la reconnaissance. Accessible et synthétique, La vengeance et la paix offre des clés pour réfléchir autrement à la violence et à la pacification, à l’heure où les émotions collectives et les ressentiments prennent une place croissante dans les discours politiques.