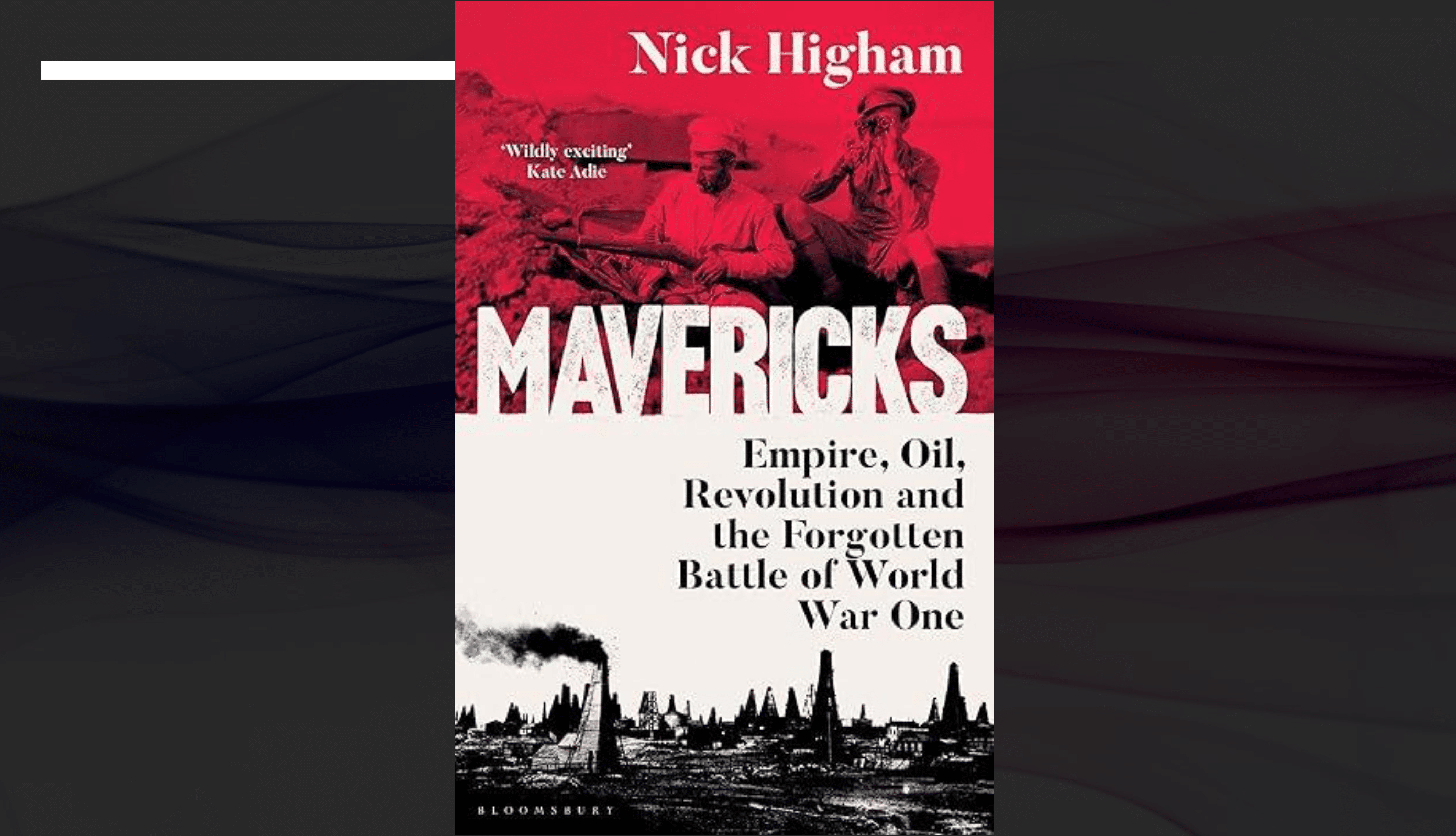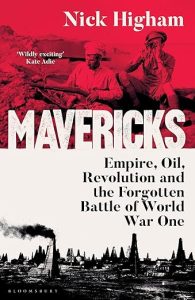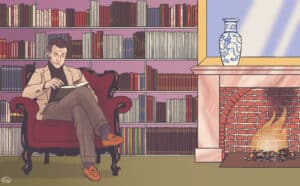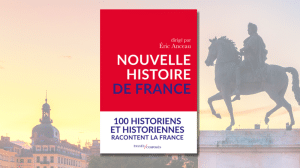Les Anglais aiment les romans d’espionnage. Autant pour se souvenir de leur souvenir que pour mythifier leur roman national. Recension de Mavericks, Empire, Oil, Revolution and the Forgotten Battle of World War One
Outre-Manche, les ouvrages d’histoire sur l’espionnage et le Grand Jeu sont conçus pour s’adresser au grand public[1]. À l’heure post-impériale, l’espion anglais reste un objet de fierté nationale au même titre que le pudding ou la chasse à la goose. Expert jamais dilettante, sportif dans l’âme, aventurier et voyageur, l’espion anglais à l’apogée de l’Empire britannique habite le monde. Sous son casque colonial, il jette un regard impassible, ses knickers laissent voir un mollet ferme et musclé et il profère avec son humour légendaire quelque parole lapidaire sans craindre l’arrogance. Cette image bousculée par la sortie récente de Slow Horses, une série réalisée par Will Smith tirée du roman de Mick Herron, donnant du célèbre MI5 une vision plutôt désenchantée, fait partie du « nation branding » à l’anglaise et se révèle résistante à la perte du statut de puissance mondiale de la Grande-Bretagne.
Nouvelles d’espions
Dans Mavericks, Empire, Oil, Revolution and the Forgotten Battle of World War One (Bloomsbury, 2025) Nick Higham s’intéresse à un épisode oublié et notoirement peu glorieux de l’engagement britannique pendant la Première Guerre mondiale. L’auteur, ancien correspondant de la BBC et auteur d’un livre précédent consacré à la question de l’eau à Londres, The Mercenary River (Headline, 2022), s’intéresse à cinq agents anglais impliqués à des titres divers dans le théâtre d’opérations complexe qu’est Bakou en 1918.
Écrire cette histoire est sans doute opportun à l’heure où les relations entre le Royaume-Uni et l’Azerbaïdjan ne cessent de se développer : le 5 novembre 2025, la rencontre entre Hikmat Hajiyev, conseiller du président Aliev avec le ministre britannique, Stephen Doughty a abouti à l’approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays, annoncé le 25 août dernier[2]. Le livre de Nick Higham rappelle à point nommé que les Britanniques se sont intéressés de longue date à l’Azerbaïdjan lorsqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, les autorités britanniques décidèrent d’envoyer un « groupe » disparate d’espions et de militaires dans la région de la Caspienne alors en plein chaos. Leur mission ? Impossible, bien entendu, car il s’agissait à la fois de bloquer l’avance des Turcs ottomans, d’empêcher la contagion d’un jihad anti-anglais parmi les musulmans de l’Inde, de contenir le développement du bolchevisme et enfin d’assurer, dans la mêlée générale, l’accès vital au pétrole de Bakou.
Bakou, enjeu géostratégique
Bien que Bakou ait constitué dès novembre 1914 un but de guerre symbolique correspondant aux idéaux du pan-turquisme caressés par les jeunes-turcs, la ville n’est réellement devenue un objectif stratégique qu’à partir de la révolution d’Octobre et de l’effondrement du front caucasien désormais abandonné par les soldats russes. Dans la brèche laissée par la disparition de l’armée russe, le ministre de la Guerre Enver Pacha a lancé dès février 1918, l’armée ottomane en ayant pour but la libération des terres irrédentes (Kars, Ardahan, Batoum), le soulèvement des populations musulmanes et la marche sur Bakou et l’Asie centrale.
Dans la situation confuse qui est celle de la Transcaucasie en 1918, en pleine dérive, entre guerre civile, intervention étrangère et victoire provisoire des mouvements nationaux, Bakou devient un véritable enjeu stratégique pour les Turcs, les Allemands, les Anglais et les Bolcheviks. Afin de contenir l’avance des Turcs, les Anglais tentent une opération de revers par le territoire de la Perse commandée par le général Dunsterville.
D’autre part, les Allemands signataires du traité de Brest-Litovsk se sont entendus avec le gouvernement bolchevik pour prendre le contrôle de Bakou et des exploitations de pétrole avant que les Turcs ne prennent la ville, une perspective qui explique sans doute que les Britanniques aient envisagé au début du mois d’août 1918 de procéder à la destruction des installations pétrolières par bombardement aérien.
À la veille de l’entrée de Dunsterville dans Bakou, ces plans ne survécurent pas à l’argument simplement pragmatique selon lequel une telle opération aurait définitivement éloigné les ouvriers tatars, déjà réputés pro-turcs, de la puissance anglaise. L’accord conclu à Mechhed entre les Anglais et un éphémère « gouvernement transcaspien » afin de parer « au danger des bolcheviks et des Turcs-Germains » témoigne une fois encore de l’importance accordée à la défense de Bakou, « porte de l’Asie centrale russe d’où dépend une grande partie de la vie économique et la puissance militaire du Turkestan russe et de la Transcaspie ».
En échange de facilités stratégiques accordées aux Anglais dans la Caspienne –contrôle du port de Krasnovodsk et du chemin de fer transcaspien- les Anglais s’engageaient à apporter une aide militaire au gouvernement transcaspien, à défendre Bakou jusqu’au dernier moment et à évacuer dans la mesure du possible des stocks de mazout et de naphte sur l’autre rive de la Caspienne, à Krasnovodsk. Quelques semaines plus tard, la prise de Bakou par l’Armée de l’Islam dirigée par Nouri Pacha (15 septembre 1918) s’accompagne de massacres d’Arméniens et marque, à quelques semaines de la victoire des Alliés, l’apogée de l’offensive germano-turque au Caucase.
Cinq Mavericks
Nick Higham met son talent d’écriture journalistique au service d’un ouvrage destiné au grand public : frayer son chemin dans un matériau historique riche et complexe, en racontant l’histoire distincte de cinq agents de la puissance britannique qui, pour autant, n’ont jamais formé un « groupe », est en soi un pari audacieux, largement tenu par l’auteur. Car « l’épisode transcaspien » ainsi nommé par Charles Howard « Dick » Ellis[3], autre agent du MI6 sur lequel, curieusement d’ailleurs, Nick Higham choisit de ne pas porter la focale, relève d’une authentique tragi-comédie.
Qui sont-ils ? Apparaît tout d’abord le général Dunsterville, fictionnalisé de son vivant par Rudyard Kipling, qui raconte ses frasques de collégien dans Stalky &C° (1899). Le facétieux Stalky est directement inspiré de Lionel Dunsterville, placé à la tête de la folle expédition terrestre (et maritime !) baptisée Dunsterforce qui devait rallier Bagdad à Bakou en 1918. Dunsterville avait résumé avec beaucoup d’humour sa traversée épique de la Caspienne en août 1918 en ces termes : « un général anglais sur la Caspienne, seule mer jamais fendue auparavant par la quille d’un navire britannique, à bord d’un vaisseau baptisé du nom d’un président sud-africain alors ennemi, naviguant depuis un port persan, battant pavillon serbe, afin de délivrer des Turcs, la population arménienne d’une ville russe révolutionnaire »[4].
D’ascendance écossaise comme bien d’autres agents du Grand Jeu en Inde et en Afghanistan, Ranald MacDonell, 21e chef héréditaire du Clan Glengarry est le second Maverick de Nick Higham. Nommé vice-consul à Bakou en 1905 au moment où la première révolution de l’Empire russe se traduit localement par les féroces guerres « arméno-tatares », MacDonell s’intéresse au pétrole et s’installe pendant un an dans une station de pompage au beau milieu des derricks.
Il y fera la rencontre, entre autres, d’un certain Stepan Chaoumian, bras droit de Lénine, plus tard représentant du gouvernement des Soviets à Bakou. Puis, un certain Edward Noel fait son apparition : c’est le troisième Maverick, issu d’une famille de militaires dotée d’une ascendance aristocratique, c’est un personnage calciné de l’intérieur, doté de grandes capacités de politique et d’intrigue, ce qui, dans une ville comme Bakou, était en soi une sorte de laissez-passer. En 1918, il est capturé en Iran du Nord par les Jangalis (les combattants de la forêt) du chef Mirza Kuchik Khan : séparatiste, c’est aussi un sympathisant de Lénine qui voit dans sa république du Gilan, la première étape de l’expansion de la révolution en Orient. Noel survivra à ses longs mois de captivité, réussira à s’échapper, mais finira opiomane. Second fils du célèbre diplomate et assyriologue Henry Rawlinson qui fut l’un des acteurs du Grand Jeu au XIXe siècle[5], Toby Rawlinson, avec sa moustache de morse, marche à l’adrénaline. Son goût invétéré pour le sport et pour le risque l’a mené sur tous les théâtres de la guerre. De Bakou, il passera en Turquie pour devenir, à ses risques et périls, un ambassadeur informel des Anglais auprès de Moustafa Kemal. Last but not least, le dernier Maverick est un garçon de Liverpool. Dénué d’ascendance sociale remarquable, ni baronnet, ni écossais, Reginald Teague-Jones est l’espion qui disparut pour devenir Ronald Sinclair à la suite de la retentissante affaire de l’exécution des 26 Commissaires de Bakou (20 septembre 1918) « par les impérialistes britanniques » selon la légende soviétique.
Nick Higham s’accorde à considérer que, parmi les cinq Mavericks, il est certainement le personnage le plus extraordinaire. Électron libre, il a grandi en Russie auprès d’une famille anglaise, a été éduqué dans la prestigieuse Annenschule de Saint-Pétersbourg, maîtrise déjà quatre langues lorsqu’adolescent, il assiste au Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. Mais le personnage de Teague-Jones est visiblement celui qui dérange le plus Nick Higham qui refuse de croire tout à fait à son histoire. L’incrédulité de l’auteur n’est pas exactement l’esprit critique qu’applique l’historien à ses sources. Elle se porte sur des détails et des discordances mineures dont l’auteur s’applique à démontrer qu’elles sont « majeures ». Sous la plume de Nick Higham, Reginald Teague-Jones devient un « narrateur peu fiable » et dont il s’applique à dévoiler les « mensonges » comme s’il ne s’agissait pas là du talent nécessaire à tout espion anglais qui se respecte ! S’il est simplement discret sur les circonstances de sa rencontre amoureuse avec la jeune Russe qui deviendra sa première épouse, cela discrédite-t-il pour autant sa compréhension, et sa surtout sa restitution des événements du chaos transcaspien ? Ailleurs, Nick Higham ne croit pas possible que Teague-Jones déguisé en marchand ait pu faire passer une carte estampillée secrète au nez et à la barbe des « autorités » chargées de l’embarquement à bord d’un vapeur transcaspien bondé de réfugiés au moment de la chute de Bakou. Et l’auteur déduit de cet épisode pourtant crédible -car en Russie, a fortiori en temps de guerre, n’importe quelle carte est par définition « secrète »- que le personnage est un menteur auto-fabulateur.
C’est ici le principal défaut de l’ouvrage : Nick Higham parsème son récit de jugements moralisants, stigmatise l’impérialisme invétéré de ses Mavericks et charge l’antisémitisme de Teague-Jones sans interroger le fait objectif de la participation des Juifs à la révolution bolchevique[6]. L’auteur commet peut-être à dessein ce délit d’anachronisme. Ou bien cède-t-il aux facilités de la cancel culture ? En tout cas, c’est ce qui est retenu dans les recensions de l’ouvrage de Nick Higham parues dans les grands titres de la presse britannique. De plus, ce jugement expéditif, et osons le dire, déplacé sur Reginald Teague-Jones n’apporte strictement rien à l’épisode central de son existence d’espion anglais : l’affaire des 26 Commissaires de Bakou. Ici Nick Higham se fie prudemment aux documents et aux travaux de l’historien Brian Pearce (1915-2008) et à mon propre livre. Pourtant l’autre versant de cette ténébreuse affaire, se trouve à Moscou, dans des archives pour le moment inaccessible. Des archives sans doute, pleines de précieux mensonges.
[1] Most Secret Agent of Empire, Reginald Teague-Jones Master Spy of the Great Game, London, Hurst, 2014.
https://aze.media/uk-and-azerbaijan-upgrade-ties-to-strategic-partnership/
[3] Ellis, Charles Howard « Dick », The Transcaspian Episode, 1918-1919, London, Hutchinson, 1963. Voir l’ouvrage que lui a consacré l’auteur australien Jesse Fink, The Eagle in the Mirror : in Search of War Hero, Master Spy and Alleged Traitor Charles Howard « Dick » Ellis, Black and White, 2023.
[4] Cité dans Taline Ter Minassian, Reginald Teague-Jones, Au service secret de l’Empire britannique, Paris, Grasset, 2012, p.191.
[5] Voir Taline Ter Minassian, Sur l’échiquier du Grand Jeu, Agents secrets et aventuriers, XIXe-XXIe siècles, Paris, Nouveau Monde, 2023.
[6] Voir Yuri Slezkine, The Jewish Century, Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2004.