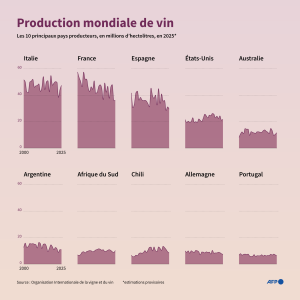Le 27 mai, sur proposions de la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne a décidé la création d’un fonds de défense de 150 milliards d’euros. Cet instrument, appelé SAFE (Security Action for Europe), permettra à l’UE de lever des capitaux sur les marchés financiers et d’accorder des prêts aux États membres pour financer des équipements stratégiques.
Il s’inscrit dans le cadre du plan ReArm Europe de 800 milliards d’euros annoncé en mars, dont l’ambition est de doter l’Europe d’une véritable base industrielle de défense.
Financer la guerre
Ce basculement intervient dans un contexte d’explosion des budgets militaires à l’échelle mondiale. En 2024, les dépenses de défense ont progressé de 9,4 % pour atteindre plus de 2 700 milliards de dollars, la hausse annuelle la plus forte depuis la fin de la Guerre froide. L’Europe a été le principal moteur de cette croissance, avec une augmentation de 17 % à 639 milliards de dollars, soit 83 % de plus qu’en 2015. D’ici 2030, les budgets européens devraient représenter 3 % du PIB, tandis que l’OTAN envisage de fixer un objectif encore plus ambitieux de 5 % du PIB pour ses membres. Ces chiffres traduisent une réorientation stratégique majeure, mais si ces mesures traduisent la volonté politique de mobiliser des ressources, ils révèlent en même temps la dépendance croissante de l’Europe à des financements publics précisément parce que les canaux traditionnels de la finance privée se détournent du secteur. C’est ce désengagement qui contraint la Commission à se substituer aux acteurs privés, au risque de faire peser sur les finances publiques l’essentiel de l’effort de réarmement.
Depuis une décennie, les grandes banques et les investisseurs institutionnels se retirent progressivement de secteurs jugés « sensibles », sous l’effet combiné des réglementations prudentielles et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Après le charbon et les hydrocarbures non conventionnels, c’est désormais l’industrie de la défense qui se heurte à cette réticence. Les établissements financiers redoutent autant les critiques publiques que les tensions internes car de nombreux jeunes salariés refusent de travailler sur des dossiers liés à la production d’armes ou dans des entreprises dont la stratégie ne correspond pas à leurs valeurs personnelles. Cette attitude crée une situation paradoxale dans laquelle d’un côté l’Europe appelle à bâtir une base industrielle et technologique de la défense tandis que son propre système financier restreint l’accès des industriels du secteur aux capitaux.
Accéder à l’énergie
Le secteur de l’énergie illustre avec clarté ce mouvement. Selon l’ONG Rainforest Action Network, les 60 plus grandes banques mondiales ont encore financé à hauteur de 4 600 milliards de dollars les entreprises pétrolières, gazières et charbonnières entre 2016 et 2022. Mais depuis 2019, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC ou encore Deutsche Bank ont adopté des politiques dont la conséquence de facto est une exclusion progressive, en particulier pour le charbon thermique et certains projets pétroliers. Les investisseurs institutionnels suivent la même logique. Le fonds souverain norvégien, avec 1 400 milliards de dollars d’actifs, a exclu plus de 200 entreprises liées au charbon, au tabac ou à l’armement controversé, tandis qu’Allianz et AXA refusent désormais d’assurer ou de refinancer certains projets fossiles.
Cette frilosité financière touche directement l’industrie de défense européenne. Le paradoxe est manifeste : sur le plan stratégique, les États demandent un effort de production immédiat, mais sur le plan financier, les règles de durabilité entravent l’accès au crédit.
Dans ce vide laissé par les banques et les institutionnels, de nouveaux acteurs s’imposent : les fonds de dette privée et de private equity. Moins contraints par la régulation et moins exposés aux pressions réputationnelles, ils ont connu une expansion spectaculaire. En 2010, le marché mondial du crédit privé représentait 250 milliards de dollars d’actifs sous gestion ; en 2023, il dépasse 1 600 milliards. Ces fonds interviennent précisément là où les banques reculent, qu’il s’agisse des énergies fossiles résiduelles, d’infrastructures carbonées ou d’entreprises de taille intermédiaire jugées trop risquées. Leur logique diffère. Ils exigent des taux plus élevés, allant de 8 à 12 % contre 3 à 5 % pour les prêts bancaires, mais offrent une rapidité d’exécution et une flexibilité contractuelle plus grandes. Ainsi, selon PitchBook, 30 % des prêts en dette privée en Europe ont été amendés dans les deux ans suivant leur émission, contre seulement 12 % pour les prêts bancaires syndiqués. Preqin souligne également que, lors de près de 40 % des restructurations observées entre 2021 et 2023, les fonds de dette privée ont préféré convertir une partie de la dette en actions plutôt que d’imposer une liquidation. Cette capacité d’innovation s’accompagne toutefois d’une brutalité plus marquée car ces fonds n’hésitent pas à prendre le contrôle complet de sociétés en difficulté, assumant leur rôle principal d’investisseurs de retournement.
La défense attire de nouveau les capitaux
Le mouvement touche désormais aussi le secteur de la défense. Autrefois évité, il attire à nouveau des capitaux, encouragés par la dynamique des budgets publics et par les perspectives de croissance. Selon PitchBook, les opérations de capital-investissement dans l’aérospatial et la défense en Europe ont atteint 620 millions d’euros répartis sur 12 transactions au premier trimestre 2025, soit déjà plus de la moitié des 1,2 milliard investis en 2023. Dans le domaine des fusions-acquisitions, la valeur des transactions de défense a atteint 2,3 milliards de dollars au premier semestre 2025, en hausse de 35 % par rapport à la même période de 2024. Les fonds privilégient des niches technologiques comme la cybersécurité, les drones, le spatial, l’intelligence artificielle où la frontière entre civil et militaire est floue et où le risque réputationnel est moindre. Les montants restent modestes par rapport aux dizaines de milliards nécessaires chaque année pour soutenir l’effort de réarmement, mais ils signalent une réouverture partielle de l’investissement privé.
La frilosité des institutions financières européennes face aux secteurs jugés « sensibles » risque de se traduire par une perte d’opportunités stratégiques majeures pour le continent. Alors que les besoins de réarmement et de stabilité énergétique ouvrent des marchés considérables, ce sont souvent les fonds américains et asiatiques, moins contraints par les impératifs de réputation ou par la rigidité des critères ESG, qui saisissent les meilleures occasions d’investissement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Amérique du Nord concentre environ 60 à 65 % des actifs mondiaux sous gestion en private equity, l’Europe seulement 20 à 25 %, l’Asie-Pacifique 10 à 15 % et le Moyen-Orient moins de 5 %. Dans un tel contexte, l’Europe, prisonnière de ses propres contradictions, court le risque de voir ses entreprises de défense et d’énergie dépendre de capitaux extérieurs pour financer leur montée en puissance, au moment même où elle revendique une souveraineté industrielle et stratégique retrouvée.