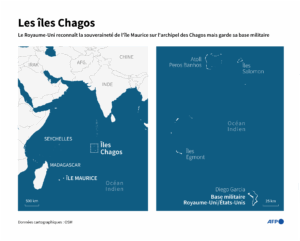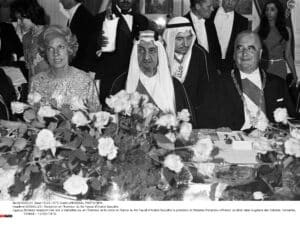Née en Sicile, du code de l’honneur et du respect des familles, la mafia s’est étendue aux États-Unis à cause de l’immigration. Évolutive, adaptable, elle a su devenir une entreprise mondialisée.
« Alors qu’auparavant on hésitait à prononcer le mot mafia […], maintenant on en fait un usage abusif. » Ces mots sont ceux du célèbre juge Giovanni Falcone qui mettait en évidence l’importance des termes. Apparu officiellement en 1865 sous la plume du préfet de Palerme, le mot « mafia » désigne communément toute criminalité un tant soit peu organisée dans le monde. Or, il s’agit avant tout d’un terme désignant une organisation secrète sicilienne, hiérarchisée, aux pratiques illicites, et reliée aux secteurs politiques et économiques par d’importants réseaux. Par la suite, la géographie du terme s’est élargie. Il faudra attendre 1963 avec le repenti américain Joe Valachi pour apprendre que la mafia s’appelait Cosa Nostra, « notre affaire ».
Le contre-pouvoir des hommes d’honneur
À l’origine, le mot mafioso, dans le dialecte sicilien, désignait un homme intrépide, un uomo d’onore. C’est ainsi qu’il se dévoile dans I mafisi di la Vicaria di Palermo, une pièce de 1863 qui popularisera le terme. Le cadre qui nous intéresse est donc résolument sicilien, voire palermitain au commencement. Pour autant, dater la « fondation » de la mafia paraît difficile. Nous pouvons avancer que la criminalité organisée apparaît sur l’île aux alentours du Risorgimento. Ces deux informations sont capitales pour comprendre l’émergence du phénomène mafieux et sa permanence. Si nous tournons nos regards vers le célèbre roman Il Gattopardo, on constate une scène où le Piémontais Chevalley tente de convaincre le prince sicilien Don Fabrizio de participer au gouvernement de l’Italie nouvellement unie. Ce dernier refuse. Son explication reflète un état d’esprit partagé par ses compatriotes : « Nous sommes vieux, très vieux […] voilà deux mille cinq cents ans que nous sommes une colonie. » L’aspect historique et géographique (un pays îlien) explique donc un sentiment de méfiance vis-à-vis de l’étranger et de l’État, plutôt issue du nord (et de surcroît en délicatesse avec le Vatican à cette époque). Si l’aspect économique – la pauvreté – a une part considérable, il n’est cependant pas l’unique cause de l’émergence de la mafia, qui peut apparaître ainsi comme un contre-pouvoir local.
Si l’activité à caractère mafieux existe dès 1860, l’assassinat d’Emanuele Notarbartolo, ancien maire de Palerme et directeur général de la banque de Sicile, en 1893, marque un « saut qualitatif » pour Salvatore Lupo. Postérieurement, l’émergence de Vito Cascio Ferro, l’un des premiers grands parrains, participa à donner à la mafia sa forme actuelle. Ce dernier révolutionnera les pratiques avec, notamment, il pizzo, « le bec », en référence à un oiseau qui picore. Au lieu d’extorquer de grosses sommes, il prenait, en échange de sa protection, de petites sommes, mais de manière régulière afin de créer une rente. Parallèlement, la mafia s’implante et se structure également aux États-Unis, où, entre 1901 et 1914, ce sont près de 800 000 Siciliens qui émigrent. Les deux rives n’ont jamais été aussi proches. L’assassinat en 1909 du policier américain Joe Petrosino, envoyé à Palerme pour enquêter, en est une preuve.
La répression de Mussolini
Omnipotente et omnisciente, la prise du pouvoir par Mussolini en 1922 constitue un tournant pour l’organisation. Il visite la Sicile en 1924 et, à Piano dei Greci, est reçu par le maire, patron de la mafia. À la vue de son importante escorte, il lui chuchota : « Vous êtes avec moi, vous êtes sous ma protection. Pourquoi avez-vous besoin de tous ces flics ? » Remarque qui participa à faire comprendre à Mussolini l’ampleur du phénomène. La réaction est immédiate : l’inflexible Cesare Mori est nommé par Mussolini préfet de Palerme avec de larges pouvoirs. Sa feuille de route tient en une ligne d’un télégramme qui lui est envoyé par le Duce : « Votre Excellence a carte blanche, l’autorité de l’État doit être absolument, je répète, absolument rétablie en Sicile. Si les lois actuellement en vigueur la bloquent, cela ne constituera pas un problème, nous ferons de nouvelles lois. » Message pleinement reçu. Mori méritera son surnom de « préfet de fer ». Sa stratégie est radicale : traiter le mal par le mal, à savoir utiliser les méthodes de la mafia. Il fait arrêter Cascio Ferro qui avait été systématiquement acquitté à 69 reprises. Cette fois-ci, il est condamné à la prison à perpétuité. Son filleul demande à un notable influent d’intercéder en sa faveur. Ce dernier refuse et répond : « Les temps ont changé. » Il mourra en prison, en 1943. En 1928, plus de 11 000 suspects avaient été arrêtés, 1 200 furent emprisonnés et d’autres exilés sans procès. Cependant Mori ne s’occupait pas seulement de la base, mais aussi des connexions dans le milieu politique. Le parti fasciste est alors touché par la purge. Il fait tomber Alfredo Cucco, pourtant membre du Grand Conseil fasciste et chef du parti en Sicile dont la fédération est dissoute, tout comme l’ex-ministre de la Guerre, l’influent général Antonino Di Giorgio. Si la mafia est fortement amoindrie, elle n’a pas disparu.
A lire aussi : Les mafias sont-elles vraiment en dehors du droit ?
Certains mafieux, les plus fidèles au régime, sont épargnés. Mais cela va surtout provoquer une vague d’émigration vers les États-Unis – 500 mafiosi –, qui aura des conséquences. Parmi eux, des noms comme Coppola, Gambino, Bonanno, qui deviendront les grands capomafia de la Cosa Nostra américaine. Des heures sombres italiennes au rêve américain. Cela sera rendu possible notamment grâce à Lucky Luciano qui va profondément transformer la physionomie de la mafia. Son objectif est de combiner les valeurs importées de Sicile, le sens du clan et de l’omerta, qui est bien plus qu’une simple loi du silence, mais un code d’honneur à la dimension virile (comme le suggère l’étymologie), avec le sens des affaires américain. Toutefois, pour cela, les armes doivent se taire. Il le répète souvent : « On ne peut pas gagner d’argent les armes à la main. » Il crée donc, avec Al Capone, Bonanno et d’autres, la Commission. Un conseil d’administration de la Cosa Nostra regroupant les parrains des cinq familles de New York et de Chicago. Pour résoudre les différends et assurer une gouvernance collégiale. À l’heure de la prohibition et alors que les États-Unis nient officiellement l’existence de la mafia, la Commission assure l’âge d’or de Cosa Nostra qui acquiert un poids économique énorme et donc une influence politique considérable.
De l’infiltration à l’opération « mains propres »
En 1943, la chute de Mussolini signe le grand retour de la branche sicilienne, vu par les Alliés comme une garantie antifasciste et anticommuniste dans un pays où l’appareil d’État s’est effondré. Il en est de même aux États-Unis où Luciano, en prison, est sollicité pour assurer la sécurité des ports contre le sabotage, ce qui lui vaudra sa libération. La mafia sort de la guerre en grand vainqueur. Et l’après-guerre lui fut fort prospère, le « péril rouge » s’imposant comme la priorité et concentrant tous les efforts. Les gouvernements italien et américain, avec notamment John Edgar Hoover, directeur du FBI, continuent à nier l’existence d’une telle organisation criminelle. Pendant ce temps, Cosa Nostra d’Amérique et de Sicile resserrent leurs liens. En 1957, à Palerme, se tient au Grand Hôtel des Palmes une importante réunion entre les grands parrains d’Amérique et de Sicile, avec pour objet le trafic de stupéfiants, jusqu’alors interdit par la mafia, et l’organisation de la branche sicilienne. Mais c’est la réunion avortée d’Apalachin, la même année, qui attire brutalement les projecteurs des médias et apporte la preuve de l’existence de Cosa Nostra à l’opinion publique et aux gouvernants. Une prise de conscience et une offensive de l’État américain notamment via Bob Kennedy, procureur général. Du côté italien, la pression de l’État est également croissante. Les juges Falcone et Borsellino, figures de proue du pôle judiciaire antimafia, et assassinés en 1992, restent les symboles de la lutte étatique contre le crime organisé. Avec l’arrestation de Tommaso Buscetta, ils permettent le vaste procès de 1986-1987, avec 475 inculpations. Leurs théories influencent aujourd’hui encore la législation antimafia. L’opération « mains propres », à partir de 1990, enterre la première République italienne, quand la démocratie chrétienne, qui gouverne presque sans interruption le pays depuis la guerre, et le Parti socialiste italien sont obligés de se dissoudre en raison d’affaires qui les lient avec la mafia. Organisation tournée vers l’efficacité économique, adoptant des stratégies évolutives à grande échelle, la mafia fut certainement l’une des premières entreprises mondialisées.