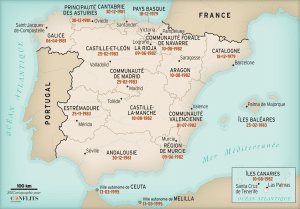Passé radieux, présent vacillant, avenir incertain. Le Vieux Monde semble voué à l’anéantissement. C’est sans compter l’efficacité de sa marque de fabrique : se relever, toujours.
Article paru dans le numéro 47 de septembre 2023 – Occident. La puissance et le doute
L’étymologie et la géographie ont distribué les rôles : a l’Orient, le soleil levant, a l’Occident, le soleil couchant. Porter le nom de la mort et de la guerre, « occident » venant de « occidere », « tomber contre », « occire », n’annonçait pas un avenir radieux. Pourtant, le soleil s’est bien levé à de multiples reprises sur l’Occident et lui-même a brillé sur le monde.
De tous ses feux. Alliage de la Grèce antique et de la Jérusalem hébraïque fusionnées dans Rome, l’Occident s’est longtemps confondu avec l’Europe et la chrétienté. Son blanc manteau d’églises et de monastères a fourni l’architecture intellectuelle et morale d’une civilisation qui a développé le sens de la raison et qui a cultivé le goût de l’autre, de sa connaissance et de sa compréhension. C’est grâce à son savoir technologique qu’il a pu s’étendre, découvrir de nouveaux continents, exporter ses scientifiques, ses missionnaires, ses militaires. Les non Occidentaux envient la modernité occidentale, sa richesse, son développement, mais, de plus en plus, ils rejettent ses valeurs et sa philosophie. S’ils veulent bien avoir l’Occident, ils ne veulent plus être des Occidentaux. Si l’Occident ne brille plus pour personne, doit-il encore alimenter ses feux ?
Un David en larmes. David est la figure pérenne de l’Occident, ce frêle berger qui affronte les Goliaths : les grands empires, les puissances militaires robustes, les systèmes intellectuels attrayants. Jérusalem l’a emporté sur les Philistins et sur Nabuchodonosor ; la Grèce a gagné contre les Perses ; Alexandre a renversé le Roi des Rois ; Rome a vaincu Carthage ; Octave a chassé Marc-Antoine ; le christianisme l’a emporté sur les Ariens et sur l’islam ; les Européens ont conquis Pékin, planté le drapeau dans les sources du Nil, édifié des châteaux dans les Andes ; terrassé l’idéologie communiste, marché sur la Lune et exploré les abysses. Tout au long de l’histoire, David a gagné contre Goliath et ce n’est pas un hasard si le « bien aimé », choisi par Dieu et oint par Samuel, a inspiré tant d’artistes, dont Le Bernin et Michel-Ange. La tradition lui attribue la rédaction des Psaumes et du Cantique des cantiques qui ont, eux aussi, inspiré bon nombre de poètes et d’artistes. Le parallèle de David et d’Octave est saisissant : les deux ont fondé une dynastie, redressé des royaumes et se sont inscrits dans une mission divine. David et Octave forment les deux bouts d’un Occident qui a toujours compris qu’il était certes petit, en masse et en démographie, mais conscient de son rôle et de sa mission dans le monde. Or ce David-là est désormais parcouru de doutes et de craintes. Ses ennemis extérieurs lui opposent une résistance de plus en plus forte, menaçant non seulement son hégémonie, mais surtout sa raison d’être. Et, à l’intérieur de lui-même, il est traversé de courants idéologiques qui dissolvent son ethos et qui remettent en cause sa conception anthropologique. L’Occident sans cesse jeune se perçoit désormais comme l’ancien monde. Sa population vieillit, ses jeunes ne veulent plus d’enfant, l’inconnu lui fait peur, le risque, autrefois une vertu, est devenu un danger ; oubliant son histoire et ce qu’il est, il se met à trembler de tout et se perd dans une politique de la prostration qui le tétanise et le stérilise.
Le déclin de l’Occident n’est pas encore advenu.
Une croix de cendre. L’Occident est concurrencé, la Chine et l’Inde s’organisent, l’Asie court et veut rattraper le temps perdu. Ailleurs dans le monde fusent les innovations, les constructions de gratte-ciel, les aménagements de ports. Les armées se réarment, les jeunesses concilient modernité et amour de leur nation, les chefs d’État et les intellectuels veulent retrouver le renouveau de leurs racines. Pourquoi ce mouvement mondial devrait-il avoir lieu partout, sauf en Occident ? On pourra toujours mettre en avant les échecs et les revers, ils sont indéniables. Mais l’école française de géopolitique est convaincue que le déterminisme n’existe pas, que l’imprévu fait partie de l’histoire et que les civilisations sont conduites par les hommes, non par les systèmes. Tout au long de son histoire, l’Occident avait mille raisons de disparaitre et d’être vaincu. Il a sans cesse gagné et triomphé. Comme Ulysse, comme Cortès, comme les explorateurs et les soldats, c’est par l’inventivité et la ruse que David l’a emporté sur Goliath. La cendre est le signe de la mort ; elle est aussi un puissant fertilisant.