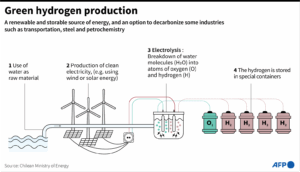Les ONG ont réussi à imposer l’idée qu’elles œuvraient pour le bien. Lutte contre la pauvreté, action contre la guerre, elles se présentent en gardien de la morale au niveau international. Un discours qui n’est pas exempt d’ambiguïté, construit par 150 ans d’expérience et qui s’est progressivement politisé.
Article paru dans la Revue Conflits n°54, dont le dossier est consacré aux ONG.
Les ONG sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, créées par des acteurs privés et relevant du droit interne, en vue d’un service rendu à l’humanité. Elles doivent aussi exercer leur activité dans au moins deux pays différents. L’action de ces acteurs privés est donc techniquement indépendante des États. Si le terme « organisation non gouvernementale » n’est apparu qu’en 1945, l’existence de telles associations n’est historiquement pas nouvelle. Le devoir chrétien de charité a encouragé le développement des ordres hospitaliers et leur implantation en Occident et en Orient. La Compagnie de Jésus par ses missions et ses relais politiques auprès des cours royales n’a-t-elle pas été une sorte de très puissante ONG ?
Les sources considèrent que l’une des premières organisations non gouvernementales modernes est la Bristish and Foreign Anti-Slavery Society, fondée en 1839 par des militants anglais qui appelaient à abolir l’esclavage dans les colonies britanniques. La Croix-Rouge, aujourd’hui organisation de référence, naît en 1864 sous l’impulsion de l’homme d’affaires franco-suisse Henry Dunant après un voyage en Italie. Choqué par les dégâts causés par la bataille de Solférino (1859) et constatant le terrible manque de médecins, il organise la prise en charge des blessés pour aider la population locale. C’est donc d’abord la réponse aux souffrances humaines qui motive la création de ces organisations.
L’environnement, une conception artistique puis scientifique
La question environnementale apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que l’industrialisation, l’extension du tissu urbain et les nouvelles pratiques agricoles modifient les espaces ruraux. L’art apporte une évolution significative, en transformant le regard sur la campagne qui devient un paysage. La nation se reconnaît dans le paysage et il devient un patrimoine. Cette approche est forte en Allemagne, pays du romantisme, après la publication de l’Histoire naturelle du peuple allemand de Wilhelm Heinrich Riehl entre 1851 et 1869. L’historien allemand y défend l’idée que le paysage, né de l’interaction entre l’homme et son environnement, constitue le fondement de l’identité germanique. L’idée sera plus tard reprise par le nazisme, et reste toujours le terreau de l’écologisme allemand. Les associations environnementales se développent à cette période sur un fondement culturel. La grande organisation britannique Common Preservation Society (aujourd’hui l’Open Spaces Society) est fondée en 1865 pour protéger la beauté du paysage et le droit de passage en Grande-Bretagne. En France, la Société pour la protection des paysages de France naît en 1901, la Bund Deutscher Heimatschutz en Allemagne en 1904.
À l’approche du XXe siècle, l’écologie devient scientifique. Deux visions vont alors rapidement s’affronter : la nature doit-elle être préservée ou conservée ? Doit-on la laisser sauvage ou la cultiver en prenant garde à ne pas l’épuiser ? Le débat se concrétise en 1906 aux États-Unis, lors du désaccord entre le naturaliste John Muir (partisan de la préservation) et le forestier Gifford Pinchot à propos d’un projet de construction d’un réservoir pour une vallée de la zone protégée de Yosemite, dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. Ce débat a également eu un écho en Grande-Bretagne au sujet de la zone protégée d’Epping. Certains contestaient l’entretien de la forêt au motif qu’elle deviendrait artificielle. Plus de cent ans plus tard, les différends autour des mégabassines ou de l’entretien des zones forestières reposent toujours sur ces deux visions.
Les réflexions environnementales se divisent ainsi entre deux camps : les réformistes, qui veulent encadrer l’industrie et l’urbanisation, et les utopistes, pour qui la cohabitation entre humanité industrielle et environnement est impossible. Ces derniers sont les piliers fondateurs de l’écologie profonde. Dès le XIXe, les artistes sont les porte-étendards des idées environnementalistes. Ainsi les utopistes sont-ils relayés par William Morris ou l’écrivain socialiste Edward Carpenter. En France, Sully Prudhomme, Jean Lahor et Frédéric Mistral sont à l’origine de la Société pour la protection des paysages de France (1901).
C’est à partir du début du XXe siècle que les associations commencent à mettre en place des stratégies militantes. Pétitions, articles de presse, colloques, relais politique : leur objectif est d’impliquer l’État dans leurs idées. De l’action locale au lobbying auprès des hautes instances, les associations comprennent la force du jeu d’échelles. Elles comprennent aussi l’importance du combat judiciaire. En 1902, la Cour d’appel de Besançon donne raison à la commune de Nans-sous-Sainte-Anne qui conteste les projets d’exploitation de la source du Lizon par l’industriel Prost au motif qu’ils portent atteinte à la beauté du lieu. Au Royaume-Uni, l’organisation environnementale Common Preservation Society attaque juridiquement les enclosures abusives (pour soutenir les progrès des rendements agricoles, les Enclosure Acts transforment les terres communales héritées du Moyen-Âge en propriétés privées clôturées, souvent au détriment des petits propriétaires). La CPS appuie ses recours par des opérations d’action directe très bien menées. Par exemple, au nord-ouest de Londres, à Berkhamsted, lord Brownlow décide de clôturer les terres communes pour les incorporer à son domaine privé. En réponse, la nuit du 6 mars 1866, un commando de 120 partisans de la CPS parvient à détruire toute l’installation avec des haches et des outils. Cet épisode fait date dans l’histoire de l’association. En parallèle de ses actions, la CPS s’assure de relais politiques sur lesquels elle peut compter : un tiers des membres du conseil d’administration sont des députés.
À lire également
WWF, Greenpeace, TNC… Jusqu’où iront les défenseurs de l’environnement ?
1919 : montée en puissance et internationalisation
Désormais bien implantées dans le paysage politique, les organisations ont l’opportunité de s’internationaliser en 1919. Lors de la conférence pour la paix de Paris, plusieurs associations pacifistes et des groupes dits « opprimés » envoient des représentants. Depuis la Chine, l’Association internationale contre l’opium envoie un télégramme pour l’interdiction de l’opium. Les gouvernements américains et britanniques y sont favorables et introduisent dans le traité de Versailles une disposition prévoyant que sa ratification vaudrait adhésion à la convention de La Haye sur l’opium.
Les associations participent surtout aux discussions portant sur le travail et une commission spéciale est créée. Elle consacre une session entière aux revendications des groupes féministes et s’en inspire. L’un des principes généraux de l’Organisation internationale du Travail (OIT), créée en marge de la SDN, est que « les hommes et les femmes doivent recevoir un salaire égal à travail égal ».
Jusqu’aux années 1930, les associations jouent un rôle de plus en plus influent dans la SDN et à l’OIT, en participant fréquemment aux auditions ou aux commissions. Intervenantes extérieures dans un premier temps, elles sont ensuite impliquées directement dans les travaux.
Si la Croix-Rouge est déjà implantée dans plus de cinquante pays, les années 1920 sont aussi le moment de l’internationalisation des nombreuses organisations. Ainsi la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté s’installe à Genève et influence la SDN par sa présence aux conférences politiques. La Chambre de commerce internationale, basée à Paris, agit à l’intérieur même de la SDN en apportant son expertise grâce à ses soutiens dans la haute finance.
Années 1930 : la contraction
La montée des nationalismes dans les années 1930 et les perspectives d’une nouvelle guerre mondiale limitent l’implication des associations non gouvernementales. Les idées qu’elles véhiculent vont en revanche être reprises dans les discours politiques, comme le nazisme, qui détourne les conceptions environnementales pour soumettre la nature à la race.
1946 : réaffirmation et institutionnalisation
Après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, les organisations tentent de se réaffirmer avec l’Organisation des Nations unies. Elles sont présentes à San Francisco et contribuent à rédiger l’article 71 de la charte qui définit clairement leur existence et leur permet de participer à certaines activités de l’ONU : « Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. » À cette occasion, le Conseil économique et social de l’ONU (Ecosoc) est créé. Son rôle est d’assurer les relations avec les ONG. L’agence de l’ONU Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance) est créée en 1946.
Les ONG se multiplient dans les années 1950, mais leur action reste peu efficace à cause de la guerre froide. Elles sont également redoutées, au point qu’un commentateur explique : « les Nations unies considéraient plus la capacité de nuire des ONG que leur côté positif[1] ».
Le tournant 1960 : politisation
Les années 1960-1970 sont un tournant dans l’histoire des ONG. D’abord, les paradigmes changent, avec l’émergence du structuralisme en France et d’autres théories comme celle de James Lovelock. Ce chimiste britannique tente de démontrer que la planète est une entité autorégulatrice qui est vivante : Gaïa. Bien que démontée dans les années 1990, la théorie de Lovelock exerce une influence importante sur les mouvements environnementaux où se recycle une partie des marxistes déçus après la chute du mur de Berlin[2].
La gauche réactionnaire qui monte en puissance s’insère petit à petit dans l’ADN des organisations humanitaires et environnementales. Après avoir cherché à collaborer avec les États pendant plus de cent ans, les ONG optent pour une stratégie plus contestataire et politique. Les plus politisées sont créées à cette période : Amnesty International en 1961, Médecins sans Frontières et Greenpeace en 1971. Le changement est assez clair si on s’intéresse au profil des fondateurs. Jusqu’à ce tournant, les principales organisations étaient créées par des hommes d’affaires, des poètes, des écrivains ou des musiciens. Or, les profils sont radicalement plus politiques à partir des années 1960 : Peter Benenson (Amnesty International) est avocat et militant, Bernard Kouchner (Médecins sans Frontière) est médecin et engagé auprès du journal communiste Clarté, Dorothy et Irving Stowe (Greenpeace) sont militants écologistes et Irving est avocat. Action contre la Faim fondée en 1971, n’est pas spécialement contestataire, mais l’un de ses fondateurs, Bernard-Henry Lévy, est philosophe et surtout conseiller de François Mitterrand.
Ces organisations prennent clairement position contre la mondialisation tout en se développant à travers elle. Les connexions économiques qui se font partout dans le monde aident pourtant à la prise de conscience globale de la souffrance de nombreux peuples et servent de plateforme à l’internationalisation des ONG. Sans mondialisation, le monde ne saurait être un village. Tout en multipliant les actions directes, ces ONG introduisent l’effet de culpabilisation dans leurs campagnes : l’inactif ou celui qui n’adhère pas aux idées est complice du mal dénoncé. Cette rhétorique puissante est le produit de ces années 1960-1970.
En même temps, l’humanitaire devient le symbole d’un grand partage entre les peuples. Le double concert Live Aid organisé à Wembley et Philadelphie en 1985 avec les plus grandes stars musicales de l’époque contribue à populariser cette idée. L’argent récolté qui devait servir à soulager la famine en Éthiopie a malheureusement été détourné par le dictateur qui organisait cette crise humanitaire.

Le Rainbow Warrior de Greenpeace. Il n’a pas laissé que de bons souvenirs en France (c) SIPA_sipausa31573525_000002
Infiltration de l’État et radicalisation
Les ONG commencent à investir les postes clés de l’État. En France, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) est créé par une convergence entre travailleurs sociaux (généralement trotskystes), militants associatifs, juristes et quatre énarques. Ces derniers, opposés à la majorité giscardienne et chiraquienne des années 1970, investissent les cabinets ministériels à partir de 1981 et soutiennent les ONG immigrationnistes. Le Gisti s’est depuis lors multiplié dans les organes de l’État, a bloqué toute réforme contraignante de la politique migratoire, manœuvrant au contraire pour élargir les conditions d’accueil[3].
La radicalisation de certaines ONG mène à des bras de fer avec les États, comme l’affaire du Rainbow Warrior (1984) qui refroidit subitement les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le Rainbow Warrior, navire de Greenpeace, est amarré au port d’Auckland (Nouvelle-Zélande), prêt à partir pour les atolls de Moruroa où la France réalise ses essais nucléaires, dans l’intention de les entraver. Les services français accusent à cette époque Greenpeace d’être financée par des organismes proches de l’appareil soviétique. Le gouvernement, avec l’accord de François Mitterrand pour qui le nucléaire est une priorité, décide d’envoyer des agents de la DGSE pour bloquer le navire. La destruction du navire par explosif provoque la mort d’un photographe membre de l’ONG.
À lire également
1990’s : plein essor et mouvement citoyen mondial
La fin de la guerre froide encourage la mondialisation et la décentralisation sur lesquelles les ONG vont se développer. Plus dépendantes des États par les subventions[4], elles deviennent aussi plus réactionnaires. Dans le même temps, elles rejoignent la convergence des luttes en Occident qui aboutit au mouvement citoyen mondial. Ce mouvement repose sur deux fondements : la défense du prolétariat et l’anticolonialisme[5], qui a muté en tiers-mondisme. Pendant la Troisième conférence ministérielle de l’OMC à Seattle (1999), 40 000 manifestants se réunissent pendant deux jours de contestations ponctuées d’actions directes. Ce sont les premières grandes manifestations altermondialistes. Parmi les organisations activistes, on distingue de nombreuses ONG : Consumers International, Earthjustice, la Confédération paysanne, les Amis de la terre, Greenpeace, Humane Society of the United States, Oxfam International, Sierra Club, etc. Ces mêmes ONG prennent en puissance tout au long des années 2000.
Nouvelle contraction géopolitique : nationalisation ou radicalisation ?
Désormais, l’influence des ONG devrait diminuer avec les dernières contractions géopolitiques. Les États qui cherchent à renforcer leur souveraineté dessaisissent les organisations des missions confiées, ou font appel à des associations nationalisées. Ainsi en Inde, les principales ONG sont-elles généralement nationalistes et interviennent-elles dans le domaine de l’éducation, la santé, le développement rural, les droits humains, etc. Elles sont soumises à des lois strictes et, en cas de conflit avec les politiques gouvernementales, font l’objet de contrôles. De facto, les ONG étrangères ne peuvent que très difficilement s’installer dans le pays. En France, d’éventuelles réformes sur les demandeurs d’asile auront sûrement pour conséquence de mettre un terme à l’intervention subventionnée des ONG dans chaque étape de la procédure.
L’histoire des ONG est cyclique, elle suit les périodes de contraction géopolitique durant lesquelles elles sont plus silencieuses. La politisation puis la radicalisation opérée depuis les années 1970 pourraient changer ce mouvement horloger. Les ONG en déclin pourraient être dépassées par des groupes encore plus radicaux, comme Soulèvements de la Terre qui s’est fait connaître à Sainte-Soline en septembre 2023. Un usage de la violence à grande ampleur n’est pas à exclure.
[1] CHARNOVITZ Steve, « Les ONG : deux siècles et demi de mobilisation », L’Économie politique n°13, Alternatives économiques, janvier 2002.
[2] GREGG Samuel, « De Marx à Gaïa », Conflits, 27 octobre 2019.
[3] FONTANA Philippe, La vérité sur le droit d’asile, Éditions de l’Observatoire, 2023.
[4] FARDEAU Jean-Marie, « D’où vient l’argent des ONG ? », Alternatives économiques, 1er janvier 1998.
[5] MASSIAH Gustave, « Le mouvement citoyen mondial », L’Économie politique n°13, Alternatives économiques, janvier 2002.