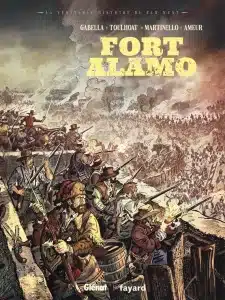Célèbre pour ses ouvrages destinés à la jeunesse, Pierre Gripari n’est pas que cela. Il fut aussi un homme de lettres, qui participa à la vie intellectuelle de son temps.
« Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots » (Louis-Ferdinand Céline).
Né en 1925 et décédé en 1990, Pierre Gripari est un écrivain français demeuré à la postérité, surtout pour ses écrits destinés à la jeunesse. Issu d’une famille plutôt bourgeoise, il fit face à une certaine misère après le décès de ses deux parents, survenu pour des causes différentes, au cours du second conflit mondial. Il interrompit alors ses études en prépa littéraire pour exercer divers petits alimentaires : commis agricole, clerc de notaire ou pianiste dans des bals. De 1946 à 1949, il s’engagea dans les troupes aéroportées. De 1950 à 1957, il fut employé à la Mobil Oil, où il assuma les fonctions de délégué syndical.
Écrivain de la jeunesse
Pierre Gripari arrêta ensuite de travailler pour écrire, mais, faute de pouvoir publier, travailla de nouveau comme garçon de bibliothèque au CNRS. Il avait été, entre-temps, l’amant de Charles Trenet. En 1962, il se fit connaître par une pièce de théâtre, Lieutenant Tenant, créée à la Gaîté-Montparnasse, recueillant alors le soutien de Michel Déon. Cela lui permit la parution en 1963 d’un récit autobiographique, Pierrot la lune, à la Table ronde (la maison qui éditait également l’ancien secrétaire de Maurras). Mais les écrits de « Pierrot », comme il se faisait appeler, ne rencontrèrent guère le succès. Il fut congédié par son éditeur en 1967. Pendant presque dix ans, il fut boudé par la totalité des maisons d’édition parisiennes. C’est que, dans l’intervalle, Gripari, qui n’était plus stalinien, s’était mis à « mal penser » comme il l’admit officiellement à Jacques Chancel dans l’émission Radioscopie, une de ses rares apparitions médiatiques. Et, selon lui, ce n’est pas son homosexualité qui le rendait infréquentable, ni même en soi ses idées politiques, sinon, de tenir des propos d’extrême droite tout en étant pauvre : « penser mal quand [comme Roger Nimier] on est une personnalité parisienne à voiture et qu’on sort … mais penser mal quand on est employé de bureau à mi-temps, c’est impardonnable, cela fait partie des choses qui ne se font pas »[1].
À lire aussi : Cartels, voyage au pays des narcos. Livre de Frédéric Saliba.
S’ensuivit toute une période de bohème, pour manier la litote (en réalité d’importante pauvreté). Gripari n’eut plus d’éditeur jusqu’en 1974, et sa rencontre avec Vladimir Dimitrijević, des éditions suisses L’Âge d’Or, qui lui accorda une licence totale et accepta tous ses textes. Maîtrisant la dactylographie, il occupa divers emplois de bureau à mi-temps. Peu encombré mentalement par ces travaux alimentaires, il pouvait consacrer le reste de son existence à la littérature (hormis, par ailleurs, des piges dans la presse nationaliste et quelques chroniques radiophoniques). On lui fournissait vêtements et livres … qu’il offrait systématiquement à plus nécessiteux que lui (après les avoir lus s’agissant des bouquins). Gripari continua en tout cas d’être édité et lu (en moins de trente ans, il fit paraître presque cinquante volumes, de toutes sortes : pièces de théâtre, romans, poèmes, chroniques, journaux, nouvelles et contes pour enfants). Ces derniers sont restés à la postérité, dont Les Contes de la rue Broca et Le conte de Paris. Leur inscription au programme de l’éducation nationale par Jack Lang permit à Gripari de souffler financièrement, en tout cas de ne plus travailler par ailleurs. Il demeura toutefois dans une très grande précarité, ne pouvant s’empêcher d’être généreux malgré son indigence. Il mourut la veille de Noël 1990, à l’hôpital, d’un accident opératoire.
Trois œuvres au moins permettent de comprendre le parcours intellectuel de Gripari : Pierrot la Lune, Frère Gaucher ou le voyage en Chine et Patrouille du conte, publiés respectivement en 1963, 1975 et 1982. Il est toujours délicat de sonder ce que pense vraiment un écrivain : narrateur, auteur et personnages constituent trois instances narratives et on ne peut forcément attribuer à l’écrivain en tant qu’être pensant la paternité de ce qu’il narre ou faire dire à ses héros. Admettons à l’inverse qu’un prosateur puisse délivrer un message par le truchement de ses personnages, quand bien même il s’en dissocierait ou les disqualifierait. Enfin, si l’écrivain n’est pas en soi irresponsable au sens juridique, il est littérateur. Or la littérature n’est point le réel, sinon elle n’aurait aucun intérêt. Aussi un auteur n’est-il pas formellement comptable de tous ses jugements, bravades, attaques et autres formules.
Un homme de lettres
Pierrot la lune est un écrit de jeunesse, une sorte d’autofiction comme on dirait aujourd’hui, un récit initiatique dans lequel sont comptées les jeunes années de Gripari. Le chaos de la guerre aidant, le garçon y connaît des expériences marquantes et troublantes : exil en Touraine, persécutions à l’école, dipsomanie et folie de sa mère, perte de ses parents et premiers émois homosexuels. L’auteur y développe des thèmes et une pensée en phase avec la France de la Libération et des années cinquante, et que l’on pourrait qualifier de « progressistes » : soutien à la France Libre, anglomanie, acceptation de son homosexualité, rejet de la religion chrétienne et des antisémites.
Ensuite, la période communiste de Gripari a sans doute correspondu à l’air du temps et s’est nourrie de son passage à la CGT. Elle peu documentée, sinon négativement dans Frère Gaucher ou le voyage en Chine, sa grande œuvre selon nous. Publié en 1975 après les années de refus sus-évoquées, ce roman épistolaire narre le voyage d’observation en URSS puis dans la Chine maoïste d’un linguiste et de son fils marxiste. Tout l’art de Gripari y gît : son érudition, sa drôlerie, son sens de la provocation et … son passage de l’autre côté du miroir. Ses yeux décillés, sa critique du communisme y est féroce et irrésistible. Sans doute même avant E. Todd, il y décrit ce qui emporta inexorablement la chute du régime soviétique : l’aboulie et le nihilisme quotidien afférents à l’absence d’économie réelle. L’empire soviétique ne tenait que grâce à sa périphérie, et ses pseudo-ennemis. « Pierrot » cingle : « rien d’étonnant à ce que la bureaucratie du Parti, en régime socialiste, se conduise, mon Dieu, comme une morue. Que craint-elle en effet ? Étant à la fois capital, État, police, syndicat, justice, église, et ne tolérant aucune opposition, elle est seule à produire, seule à distribuer, seule à vendre. Chaque citoyen est obligé de lui louer sa force de travail et de ne la louer qu’à elle seule. Elle ne craint ni la concurrence ni le mécontentement de la clientèle. Elle peut donc faire les prix à sa guise et organiser le marché noir officiel. Elle peut, au surplus, payer ses salariés aussi mal qu’elle le désire, sans crainte de les voir changer de patron ou s’établir à leur compte … Bref, en régime socialiste, il n’y a pas de limite à l’exploitation de l’homme par l’homme, sinon la nécessité, pour le Parti-trust de vendre sa camelote – mais il préfère la vendre à l’étranger pour avoir des devises – ou, à l’extrême, le désespoir des masses travailleuses, lequel désespoir peut prendre épisodiquement la forme de la révolte, mais s’exprime le plus souvent par la passivité, le fatalisme, le vol et le tirage au cul »[2]. Ou encore, dans un désopilant lexique de la langue marxiste-léniniste, il donne une définition du prolétariat (« comité central du parti communiste »), du peuple (« parti communiste »), de l’économie planifiée (« capitalisme monopolistique au profit du parti ») et du fascisme (« tout ce qui s’oppose, directement ou indirectement, à la volonté de la casse ouvrière »)[3].
Une vie ambiguë
L’auteur y écrit des passages antisémites[4], qu’il réitéra à la radio[5] ou dans d’autres écrits. Ses propos antijuifs sont formulés autour des axes traditionnels : le prétendu racisme des Israélites et la dénonciation du « juif de gauche », comme figure nomade et urticante. Mais, comme souvent, pareil antisémitisme – dont on ne peut exclure qu’il relève de la pure provocation, ce qui ne l’excuse pas – est contradictoire[6]. Pierre Gripari critique le sionisme, tout en soutenant, en « fasciste » et à la manière de Rebatet à la même époque (celle de Suez et de la guerre des Six Jours), Israël dans la guerre qui l’oppose à ses voisins arabes[7]. Israël est vu par les droitiers personnages comme un État-nation à la population homogène et au service de ses habitants (par opposition aux démocraties européennes mâtinées et soumises à l’étranger)[8]. Le sionisme d’extrême droite est toujours suspect …
Enfin, dans Patrouille du conte, l’écrivain s’en prend au politiquement correct. On ne sait s’il est encore pertinent de convoquer pareille expression, tant la manipulation perverse de langue et de la réalité – c’est la même chose – au profit du progressisme est désormais paroxystique. Patrouille du conte est une sorte de mise en abyme dans laquelle notre écrivain pour enfants rédige un conte pour adultes dans lequel la maréchaussée de la pensée conforme demande à une brigade ad hoc d’aller quérir les personnages de contes célèbres pour moraliser leur contenu, ou afin qu’ils fassent amende honorable. Ceux qui s’étonnent d’une telle intuition de la censure wokiste dès 1982 sont des incultes. 1984 fut publié en 1948. 1968 avait largement fait son œuvre au bout de quinze ans. École de Francfort et freudo-marxisme[9] dominaient les sciences sociales, si bien que ce qui doit nous étonner est uniquement la bêtise des progressistes actuels, qui ne feignent même plus de penser. Le plus intéressant dans Patrouille du conte est la corrélation qui est faite entre la République, la destruction de tout et la novlangue. C’est au nom de l’égalitarisme et du progrès républicains que tous les crimes contre, non pas la tradition, mais la simple fonctionnalité des choses, sont commis. La République avec une majuscule – pas la République française – n’est donc point une hypostase, sinon un pays alternatif, un projet messianique et antinational qui se développe plus ou moins sur le même territoire et le même fonds historique que la France. Pierre Gripari devine également le grand guichet que va devenir notre pays exsangue à force de socialisme. La vie publique se mue progressivement en une entreprise de pillage de l’État par tous à force de redistribution, puis, une fois les caisses vidées, en vol de tous par chacun. Les victimes, qui sont souvent des perdants qui ne s’acceptent pas, sont alors légion[10].
Ce n’est ni par réaction ni par esthétique que Gripari demeurait en marge, mais par honnêteté : un écrivain doit écrire ce qu’il pense (« le jeu vaut qu’on fasse quelques petits sacrifices … Le plaisir de l’écriture vaut largement tout cela […] La vie que je mène me convient »[11]). Et sa marginalité autorisait son authenticité.
Livre de poche ?
En 1964, Hubert Damisch avait publié un article polémique intitulé « La culture de poche« , dans lequel il reprochait aux promoteurs de cette collection de vendre de la culture comme de la lessive, sur un mode purement quantitatif, sans garantie que les lecteurs en auront pour leur argent, ni même que leur nombre s’accroîtra. Et il est vrai que l’édition de poche n’a créé, au contraire d’autres supports décriés, aucune culture propre, fût-ce sur un mode dégradé. Il y eut désormais une déconnexion entre possesseurs de livres et lecteurs[12]. Un autre auteur avait vilipendé, toujours via le livre de poche, que la masse s’octroyât désormais un droit de mépris[13]. Gripari n’écrivait pas autre chose : « autrefois, les éditeurs travaillaient pour un public restreint, celui des gens qui savaient lire. Les illettrés, de leur côté, avaient une culture à eux parfaitement authentique et d’une grande valeur : le folklore. Aujourd’hui, on a tué le folklore et on l’a remplacé par le journal, le magazine la radiotélévision, le best-seller. Les gens qui savent lire sont toujours là, toujours minoritaires, mais l’industrie du livre travaille de moins en moins pour eux. Commercialement parlant, ils ne sont pas intéressants. Éditeurs, distributeurs et libraires ont tout intérêt à se mettre au service du philistin salarié, de la petite dactylo snob – en un mot des analphabètes scolarisés – car ce sont eux qui ont le fric. C’est ainsi que l’on tue une culture. Résultat : ce n’est plus l’intérêt littéraire de l’œuvre qui compte, mais sa rentabilité. Sur quoi un éditeur juge-t-il de la rentabilité d’un texte ? Sur sa ressemblance plus ou moins grande avec le succès de librairie de l’année passée. Tout ce qui s’en écarte est rejeté avec des phrases du genre qui voulez-vous qui lise cela ? ou encore oui, mais maintenant, voyez-vous, ce que le public aime c’est plutôt … »[14]. Il y a en tout cas une conséquence indiscutable de cette démocratisation du livre : la désaffection pour la littérature. De même que les jeunes gens qui n’ont rien à faire à l’école passé un certain âge veulent symboliquement détruire ce qu’ils perçoivent comme une oppression et un produit frelaté (l’éducation au rabais qu’on leur impose), le public se détourne de la soi-disant littérature contemporaine.
À lire aussi : Anthologie de la littérature kazakhe contemporaine
Mais au-delà, n’est-ce pas dans l’imprimerie et la diffusion de la presse qu’il faut en chercher l’origine ? Jadis, ne savaient lire que ceux qui écrivaient. Avec l’essor de la presse, consubstantiel à la révolution industrielle, le paradigme fut inversé : tout lecteur s’est fait auteur, pouvant écrire aux journaux afin d’y donner son opinion. C’est qu’il y a un particularisme des créations, objets d’une reproduction mécanisée : le tirage en masse ôte à l’œuvre sa fonction ritualisée[15]. Et de proche en proche en proche, on a cru que toute personne maîtrisant une langue à l’écrit pouvait potentiellement se faire écrivain, comme s’il suffisait de savoir donner un coup de pied pour être footballeur. Or, nous avons quitté la civilisation de l’écrit et du livre, et rejoint celle de l’image et des écrans. Il s’ensuivra peut-être une renaissance de la littérature. Qui, dans quelque temps encore, suera sang et eau pour produire un texte dans un monde où plus personne ne lit ? Peut-être les authentiques auteurs …
Michel Houellebecq avait expliqué le prestige du cinéma dans les années 1930 à 1970 par … l’avènement de la machine à écrire. Le dactylographe ne permettant guère d’incises, le style linéaire et journalistique s’était imposé dans l’écriture ; la plupart des génies migrèrent alors vers le cinéma où ils se comportèrent au demeurant comme des auteurs. Puis le micro-ordinateur permit de nouveau un travail sur la langue par le palimpseste du traitement de texte. Le roman reprit ses droits, mais, comme un effet indésirable, la démocratisation de la bureautique engendra la multiplication des manuscrits (il était autrefois coûteux pour l’impétrant-écrivain de rédiger à la main ou même reproduire plusieurs centaines de pages …). Enfin, les intelligences artificielles d’aide à la rédaction pourraient permettre la génération quasi instantanée de texte non-littéraires, rendant surnuméraires les auteurs à la petite semaine. Tout cela semble également réjouissant pour les authentiques écrivains. Il faut savoir parfois travailler pour la vie d’après, encore qu’on ne soit jamais à l’abri d’un succès inattendu. Tel fut dans une certaine mesure le cas pour Gripari.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=S-pWpi_pvxM
[2] v. P. Gripari, Frère Gaucher ou le voyage en Chine, L’Age d’homme, 1975, p. 196.
[3] v. Frère Gaucher ou le voyage en Chine, op. cit., p. 192.
[4] v. par ex., pp. 36, 38 ou 63.
[5] In Radioscopie, ibid.
[6] Sur la question, v. J. Roche, Le cas Pierre Gripari, https://omnilogie.fr/O/Le_cas_Pierre_Gripari
[7] « Quant à l’argument des atrocités, là je vous le dis tout de suite, je ne marche pas. Pourquoi ce qui était bien en Algérie serait-il mal en Palestine ? Je pense, en effet qu’un partisan est, par définition, un criminel de guerre et une salope, mais c’était déjà vrai du temps de la Résistance ! Or depuis 1944 (et sur la pression des milieux juifs, justement), nous sommes priés de trouver les partisans sublimes et de considérer comme criminels ceux qui luttent contre eux. Eh bien en Palestine, la Résistance est arabe et la gestapo juive. C’est ainsi. Si vous admettez la guerre de partisans, vous admettez également la Terreur, la provocation, le chantage, la torture, le massacre des non-belligérants », in Frère Gaucher ou le voyage en Chine, op. cit., p. 37.
[8] Encore que, curieusement, Gripari intègre le monde arabo-musulman dans la sphère civilisationnelle euro-méditerranéenne.
[9] Comme il a été écrit au sujet de Pierre Gripari : « les nuages noirs qui menaçaient toute entreprise littéraire, toute réflexion à cette époque, c’était le communisme et la psychanalyse : il n’y avait pas d’autre grille de lecture. Hélas, à peine en a-t-on fini avec celles-là que d’autres se précipitent à l’horizon : la même quantité de bêtise et de conformisme pèse toujours sur le monde, sous une forme ou sous une autre. Aujourd’hui, les droits de l’homme et les bons sentiments continuent de semer la mort à tous les points cardinaux : fuyons les amoureux de l’humanité », par A. Martin-Conrad, Pierre Gripari, portrait de l’écrivain en joyeux pessimiste, in Stalker, à retrouver sur le lien https://www.juanasensio.com/archive/2010/11/21/pierre-gripari-infrequentable-anne-martin-conrad.html
[10] v. P. Gripari, Patrouille du conte, éditions Cavaliers, 2025, p. 197.
[11] In Radioscopie, ibid.
[12] Dans le film préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, le personnage de Patrick Dewaere, professeur de gymnastique un peu freluquet, se vante quand il accueille chez lui Carole Laure, de posséder la collection complète du Livre de poche qu’il exhibe en connaissant tous les numéros par cœur, sans manifestement les avoir tous lus …
[13] https://www.facebook.com/watch/?v=1032036330473185
[14] In Frère Gaucher ou le voyage en Chine, op. cit., p. 213.
[15] Sur la question, v. W. Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, texte posthume, 1955 à retrouver sur le lien https://ia902905.us.archive.org/14/items/BENJAMINWalterLoeuvreDartALeppoqueDeSaReproductiniliteTechnique/BENJAMIN%20Walter-L%27%C5%93uvre%20d%27art%20a%CC%80%20l%27e%CC%81poque%20de%20sa%20reproductinilite%CC%81%20technique.pdf : « jadis, le tableau n’avait pu s’offrir qu’à la contemplation d’un seul ou de quelques-uns. La contemplation simultanée de tableaux par un grand public, telle qu’elle s’annonce au XIXe siècle, est un symptôme précoce de la crise de la peinture, qui ne fut point exclusivement provoquée par la photographie mais, d’une manière relativement indépendante de celle-ci, par la tendance de l’œuvre d’art à rallier les masses ».