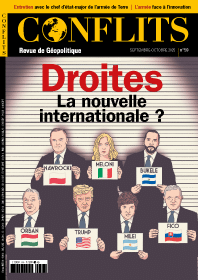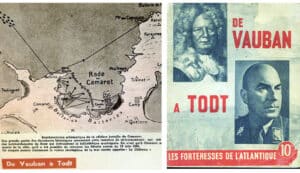Tandis que l’administration Trump affirme un renouveau d’intérêt pour l’Amérique latine, et que la Chine y a tissé, des années durant, des relations économiques affirmées, un constat s’impose comme une anomalie : la France, septième puissance mondiale, y porte peu d’intérêt au point que la région est considérée comme « l’angle mort de la diplomatie française ».1
Par le passé, la France a pourtant porté une grande considération pour le sous-continent. Faut-il rappeler que ce dernier doit son nom d’« Amérique latine »2 aux cercles de l’Empereur français Napoléon III, lequel en fit un concept clef pour sa stratégie dans la région. Il opposa cette « latinité »3 à l’influence des États-Unis, alors puissance protestante montante sur le continent. Le point d’orgue de la diplomatie française fut l’intervention militaire au Mexique en 1861.
Au XIXe siècle, une diplomatie française aux résultats contrastés
Lors de la vague d’indépendance du début du XIXe siècle en Amérique latine, l’Europe entière remplaça les métropoles coloniales en devenant le principal pourvoyeur de capitaux et de travailleurs du sous-continent (6 millions entre 1850 et 1930). L’historien Pierre Chaunu parle d’un « trusteeship collectif des grandes puissances » européennes sur l’Amérique latine.4 Le Royaume-Uni aura été de loin le premier investisseur en consacrant une somme égale à la moitié de ses investissements effectués dans son propre empire, soit 20 milliards de francs-or.
Déjà, au XIXe siècle, la France détonnait par des capitaux tournés en majorité vers le continent européen, auquel elle consacrait plus de la moitié de ses investissements à l’étranger, et consacrant 6 milliards à l’Amérique latine.5 Obnubilée par le concept de « latinité », la France se montra plus ambitieuse dans le règlement des affaires diplomatiques et politiques du sous-continent en menant une politique de la canonnière. Elle tira peu profit économiquement de cette nouvelle « ruche manufacturière du monde »6 qu’étaient alors les terres latino-américaines.
En dépit de certains désaccords et de l’échec de l’intervention au Mexique, l’intérêt français pour l’Amérique latine suscita en retour celui de certains pays, tels que l’Équateur, qui demanda en 1861 la protection de la France au travers d’un protectorat.
Des liens culturels, intellectuels et artistiques forts, mais bien seuls
Ainsi, le fait le plus marquant de la relation franco-latinoaméricaine fut, et demeure toujours, d’ordre culturel, intellectuel et artistique, en témoigne la francophilie de nombreux artistes, intellectuels et politiques latinoaméricains. Ce n’est pas un hasard si c’est en Amérique latine que le réseau des Alliances françaises (créé en 1883) est le plus dense au monde (330 villes).
C’est sous la IIIe République que fut créé l’essentiel des groupements d’universités, des comités, des instituts en France et aux Amériques ayant favorisé les échanges universitaires et l’enseignement par des professeurs français de l’autre côté de l’Atlantique 7 comme l’ethnologue Claude Lévi-Strauss. Ces forts liens intellectuels et universitaires ont subsisté jusqu’à aujourd’hui pour devenir premiers au détriment des liens politiques et de la coopération économique.
L’échec de la diplomatie environnementaliste française
La tournée du président Emmanuel Macron en Amérique du Sud en 2024 devait marquer un renouveau dans les relations franco-sudaméricaine. En dépit d’accords de déclarations communes (« l’appel de Valparaiso »8), le discours français majoritairement centré sur l’environnement ne suffit pas à susciter un élan diplomatique durable.
Pire, cette diplomatie environnementaliste est perçue comme moralisatrice et s’assimile à de l’ingérence. En témoigne l’inepte proposition du président E. Macron de créer une gouvernance mondiale de l’Amazonie, faite depuis Biarritz au G7… Si la Guyane française est réputée sur le continent pour ses mesures de protection environnementale, celles-ci relèvent davantage d’une sanctuarisation du territoire. Improductif économiquement, ce modèle ne séduit pas les pays latinos souhaitant mobiliser des leviers de développement.
Tandis que la France échangeait à peine 22 Mds € (2024) avec l’Amérique latine dans sa globalité, la Chine en échangeait près de 500 Mds€. Les mises en scène diplomatiques avec le président brésilien Lula mêlant discours, brimades et chamailleries n’auront pas dopé les échanges franco-brésiliens (8 Mds € en 2024), alors que les échanges sino-brésiliens eux, ne cessent de croître (157 Mds$ en 2024).
La France face au non-alignement de l’Amérique latine
La France et les pays latinos font état de profondes divergences de points de vue quant à l’ordre du monde. La guerre d’Ukraine, le conflit à Gaza, la quête de multilatéralisme, la bataille pour le « leadership » mondial sont tout autant de sujets de discordes dont la diplomatie française ne saisit pas l’importance pour les pays latinos en quête d’autonomie sur la scène internationale.
C’est dans la continuité du mouvement des non-alignés, initié en 1961 à Belgrade, que cette volonté de non-alignement diplomatique s’est affirmée pour l’Amérique latine. Cette dernière subissait de plein fouet la toute-puissance nord-américaine (coups d’État, opération Condor, etc.).
Cette vision des relations internationales est aussi un héritage de son histoire conflictuelle. Minée par les ingérences, ignorée durant ses guerres interaméricaines et comme mise de côté par les grands mouvements géopolitiques mondiaux du XXe siècle, l’Amérique latine tente aujourd’hui d’affirmer sa voix. Mettant à profit les convoitises pour leurs ressources et pour leurs poids géopolitiques (vote à l’ONU, discours, etc.), les états latinos ont fait leur cette notion de non-alignement. En poussant au régionalisme, de façade tout du moins (Unasur, CELAC, etc.), le sous-continent aspire à affirmer une voix unifiée qui ne soit pas celle des puissants, une position novatrice et équilibriste au milieu des rivalités de puissance.
Cette particularité latinoméricaine est incomprise par la diplomatie française, qui cherche encore ses repères sur le sous-continent. Le concept de non-alignement est pourtant étudié, poussant certains à en faire un sujet d’étude géopolitique : le « non-alignement actif ».9 Au-delà de ce débat sémantique, il nous apparaît que le non-alignement est en réalité et surtout une ambitieuse illustration du réalisme.
Un changement de paradigme nécessaire pour la diplomatie française en AMLAT
L’incompréhension de la diplomatie française à l’égard de l’Amérique latine est une anomalie étant donné le vaste tissu universitaire, journalistique et artistique les unissant. Sont ignorées en France les réalités humaines des pays de cette région, lesquelles font pourtant les spécificités politiques et diplomatiques de ces pays. C’est-à-dire la manière dont ils se perçoivent dans les relations internationales.
En fait, l’étude en France du continent porte essentiellement sur les dynamiques sociales et sociologiques dans le domaine politique, au détriment du reste. L’Amérique latine est vue comme « un champ précieux d’expériences et de comparaison ».10 Y sont délaissés les défis ancrés pour de la théorie et l’élaboration de concepts relevant en grande partie de la sociologie politique.
Ainsi, l’on manque des pans essentiels dans l’étude géopolitique de cette région latine, tels que les dynamiques politiques, ethniques, économiques et sécuritaires. De fait, la géographie cabossée de ces territoires a brisé les velléités unificatrices et a révélé des partitions naturelles frustrant jusqu’aux plus grandes ambitions sans pouvoir les annihiler. De là naquirent des consciences nationales affirmées générant des rivalités d’abord territoriales, puis de puissance qui structurent encore aujourd’hui la géopolitique de l’Amérique latine. C’est là un tempérament latino dont il faut s’imprégner.
Pour l’émergence d’un réalisme français dans la région
Par conséquent, il faut à la Diplomatie française de nouveau s’imprégner de réalisme dans son approche des relations internationales pour aborder l’Amérique latine. Il lui faut se fonder sur le respect des souverainetés, sur le besoin de reconnaissance des États (T. Lindemann) et sur la quête d’intérêts mutuels. Il lui faut alors abandonner sa quête universaliste dont le besoin effréné de mimétisme a causé plus de tort que n’a apporté de progrès dans le monde.
En effet, l’interventionnisme occidental a définitivement vacciné les états latinos qui se méfient de son idéalisme démocratique et lesquels ont compris que la notion de puissance prévalait sur celle des idées, à savoir l’économie et la sécurité. C’est pourquoi comprendre la volonté brésilienne de devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU est essentiel.
Dans la lignée de Richelieu et de Delcassé, le général de Gaulle avait affirmé un réalisme français au XXe siècle dont pourraient s’inspirer les dirigeants français d’aujourd’hui : en redonnant à la France les attributs d’une « puissance d’équilibre ». Cette notion aurait un écho favorable auprès des états attachés au non-alignement.
En finir avec la « non-stratégie »11 de la France en Amérique latine
De cette pensée diplomatique ainsi refondée pourrait découler une stratégie politique ambitieusepour la France en l’Amérique latine. En prenant en considération l’atout géostratégique de ses collectivités territoriales ultramarines situées en Amérique latine(Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, etc.),la France gagnerait également en légitimité. C’est là une notion essentielle qui fait écho à celle de la souveraineté, au cœur même de l’approche réaliste des relations internationales.
-
Vaïsse Maurice, La Puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958, Paris, Fayard, 2009.
-
Espinosa-Dassonneville Gonzague, « Napoléon III et l’Equateur de Gabriel Garcia Moreno : un projet d’union en prélude de l’expédition du Mexique (1859-1862) », Napoleonica. La Revue, 2022/2 N°43, p.185-206, 2022
-
Ibid.
-
Chaunu, Pierre, Histoire de l’Amérique latine, Presses Universitaires de France, 2012, page 107
-
Ibid, p. 113
-
Ibid,
-
Reitzer Jean-Luc, « La présence et les intérêts français en Amérique latine », Rapport d’information N°4333 déposé par la commission des Affaires étrangères, 2010-2012
-
Torquebiau Marion, « Au Chili, Emmanuel Macron et Gabriel Boric lancent un appel à la protection des océans », Les Echos, 22 novembre 2024
-
Parthenay Kevin, « Le « non-alignement actif » et l’Amérique latine dans l’ordre global », Le Grand continent, 3 octobre 2022
-
Huerta Mona, « Le latino-américanisme français en perspective »
-
Jean-Jacques Kourliandsky dans « La France en Amérique latine: quelle(s) stratégie(s) face aux reconfigurations régionales ? ». Mouvements, 2013/4 n° 76, p.49-64, [en ligne]