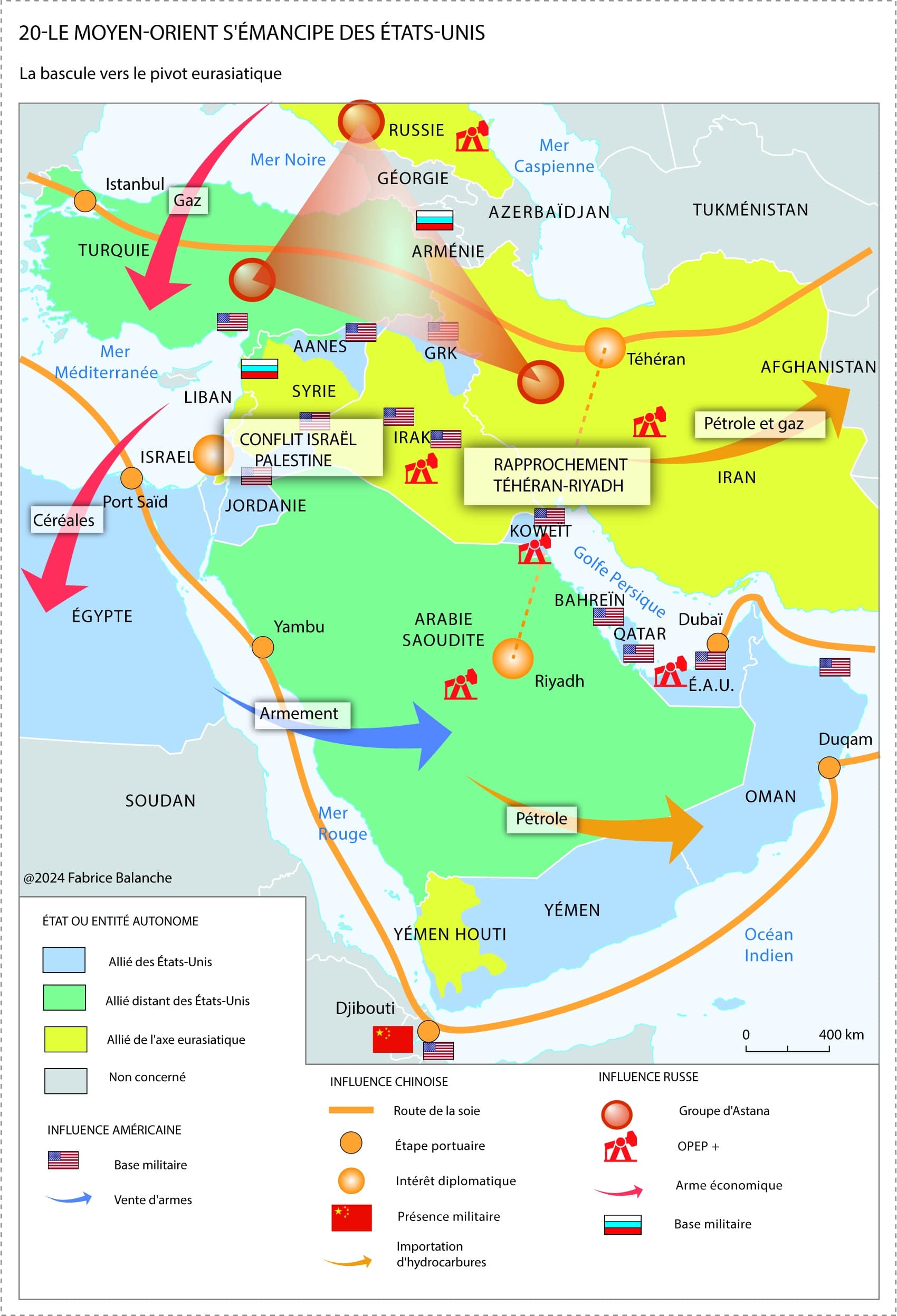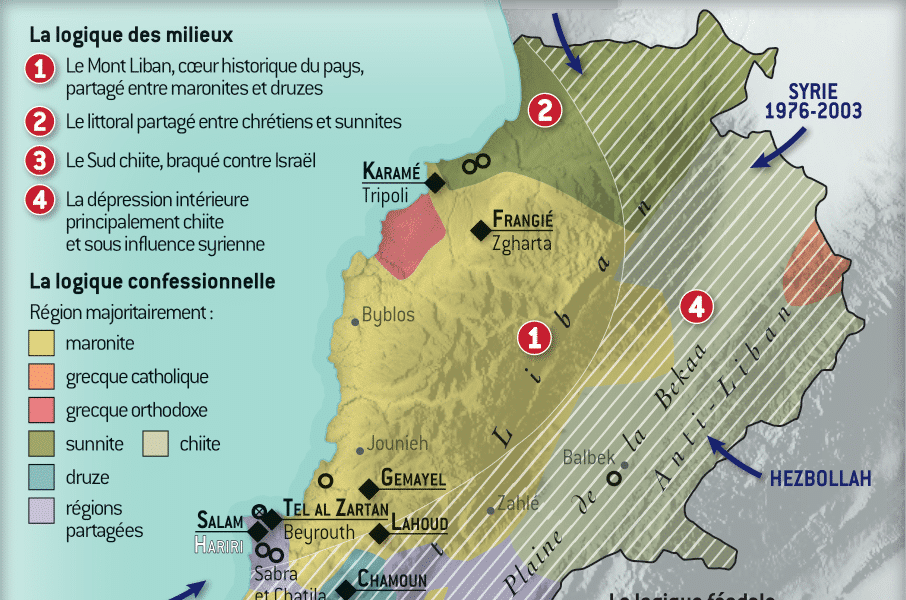La fin de l’opération Barkhane, annoncée jeudi 10 juin par le président de la République, soulève une multitude de questions. On s’interroge légitimement sur le bilan de l’opération, sur l’avenir de la situation dans la région comme sur l’état des lieux de l’armée française. Entretien avec Frédéric Blachon. Propos recueillis par Frédéric Pons.
Général de division (2esection), Frédéric Blachon est saint-cyrien, diplômé de l’ESSEC. Ancien chef de corps du 1errégiment de chasseurs parachutistes, il a notamment dirigé les trois écoles d’officiers de Coëtquidan (2015-2017) et la 1èredivision (Besançon, 2017-2020), période pendant laquelle il commanda l’opération Barkhane pendant un an. Différents postes en états-majors (recrutement, inspection générale, coordination pour la réforme) lui ont donné une vision complète du fonctionnement des armées. Dans cet entretien exceptionnel, il nous fait partager cette expérience, en revenant, en toute franchise, sur les opérations, la formation des soldats et les relations entre la hiérarchie militaire et le monde politique.
Entretien réalisé par Frédéric Pons.
Au Sahel, quel est le bilan de l’opération Barkhane ?
Au bout de huit ans, je constate que la plupart des analystes partagent à peu près le même constat. Nul ne prétend détenir de solution miracle et peu d’idées nouvelles émergent. Reconnaissons simplement que certains ont fait preuve d’une plus grande lucidité en prévoyant depuis longtemps le blocage de la situation au Sahel.
À lire aussi : Terrorisme au Sahel et en France : le mirage de la victoire
Quelles sont ces idées partagées ?
D’abord que la déstabilisation de la Libye a été une catastrophe, dont nous n’avons pas fini de payer les conséquences. Ensuite, qu’il aurait fallu probablement exercer une pression plus importante sur les tous les belligérants, dès la fin de l’opération Serval, au printemps 2013, quand l’armée française était en position de force et avait su créer les meilleures conditions possibles pour une négociation. La France aurait même pu menacer de retirer ses troupes dès ce moment-là, devant l’absence de progrès constaté.
Fallait-il vraiment négocier l’appui français ?
Le conditionner à la mise en œuvre d’avancées réelles aurait montré que notre appui n’était pas un dû. Ne soyons pas naïfs, les groupes les plus radicalisés n’auraient pas rendu leurs armes, mais on serait peut-être parvenu à mieux les séparer des autres protagonistes, défendant des causes moins dangereuses pour la stabilité de toute la zone.
Barkhane n’a donc rien résolu ?
Nul ne le conteste. Barkhane s’efforce de contenir la propagation du mal en évitant le pire. Sans être spectaculaires, les résultats sont plus qu’honorables, au vu de la complexité de la mission. Les familles des soldats tombés au Sahel peuvent avoir la certitude qu’ils ne sont pas morts pour rien.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les militaires sont les premiers à savoir que d’indéniables succès tactiques peuvent ne pas déboucher sur des avancées politiques probantes. Mais quand la situation politique est bloquée, les succès tactiques sont indispensables pour redonner confiance aux armées africaines, prouver notre détermination, entraîner les partenaires européens indécis, rendre la vie difficile aux djihadistes, et surtout tenter de recréer des conditions de négociation plus favorables.
La stratégie adoptée par la France est-elle payante ?
Oui, en dépit des limites évoquées plus haut. Avoir concentré les efforts en 2020, contre l’EIGS dans la zone des trois frontières, a été payant. Il faut dire que la férocité pratiquée par cette branche de l’État islamique en fait un ennemi repoussoir. Maintenant que les efforts se concentrent à nouveau contre AQMI, on constate qu’il est plus difficile de lutter contre cette nébuleuse, dont la stratégie exploite plus intelligemment les différentes fractures locales.
Alors que faire ?
La tâche de nos armées, de nos diplomates et des spécialistes du développement est abyssale. Ne cessons pas de rappeler que la zone dans laquelle nous intervenons est la plus pauvre du monde, cumulant tous les handicaps possibles, étatiques, climatiques, démographiques, économiques et sécuritaires. À moyen terme, il n’y a pas de bonne solution. Si la France se désengage rapidement, la zone connaîtra une forte déstabilisation. Nul ne peut prévoir l’attitude de populations qui se rallieraient peut-être à une forme d’islamisation plus marquée.
Les effectifs et les matériels déployés sont-ils adaptés ?
Nous avons des équipements robustes, adaptés au besoin de grande mobilité pour des espaces très vastes et à la protection contre les IED. L’idéal serait de disposer de matériels spécifiques pour la guerre dans le désert. Mais ne rêvons pas et veillons à ménager notre capital, afin de ne pas pénaliser la préparation des armées aux engagements futurs.
Les modes d’action doivent-ils évoluer ?
La « sahélisation » pendant plusieurs semaines de nos unités, en appui direct des forces africaines, constitue un vrai progrès. Accompagner au combat, sans se substituer aux armées du Sahel, est un horizon indépassable. L’empilement des forces et des instances destinées à aider les Africains ne doit pas faire illusion. Au bout du bout, ce sont bien ceux qui luttent à leurs côtés qui leur témoignent la plus grande solidarité.
Faut-il toujours parler de GAT (groupes armés terroristes), la terminologie officielle ?
Elle a toujours été ambiguë. L’utilise-t-on, comme Daech, pour éviter d’employer les mots qui fâchent ? Le terrorisme n’est qu’un mode d’action. Pour combattre un adversaire, il faut le nommer. Mais ne parler que de « groupes djihadistes » serait, a contrario, donner une vision réductrice de la situation au Sahel.
Doit-on dialoguer avec ces groupes djihadistes ?
La France ne le souhaite pas. Elle a été très claire à ce sujet. Mais le débat existe, au sein de la société malienne. La Conférence d’entente nationale de 2017 en avait fait l’une de ses recommandations. En décembre 2019, une conférence du même type, appelée Dialogue national inclusif, a confirmé cette volonté de reprise du dialogue, y compris avec Iyad Ag Ghali.
On a l’exemple de l’Afghanistan…
Effectivement. Ceux qui prônent cette voie rappellent que les Américains avaient exclu la possibilité de discuter avec les talibans pendant près de dix-neuf ans, mais qu’ils ont dû s’y résoudre. Au niveau local, certains maires n’ont pas attendu pour reprendre le dialogue avec ceux qui font la loi au quotidien.
Les pays africains prennent-ils leurs responsabilités dans cette guerre ?
Les groupes djihadistes sont nos seuls ennemis. S’agissant des revendications des autres groupes armées, c’est aux gouvernements africains de les prendre en compte. Tout ne doit pas être réduit au paravent du djihadisme, pour s’assurer du soutien de la France, sans avoir à régler des problèmes éminemment endogènes comme la corruption, la défaillance de l’État et le clientélisme.
La France a-t-elle vraiment une stratégie au Sahel ?
La France s’efforce de maintenir la stabilité des pays du Sahel, avec si possible des régimes laïcs à leur tête. Le but est d’éviter un « Africanistan », selon l’expression de Serge Michailof. L’enracinement du salafisme y est néanmoins bien visible, comme le montre la multiplication du nombre de madrasas sous influence étrangère. Les liens historiques et, disons-le, une conception assez désintéressée de la coopération font que la France continue à s’impliquer dans la sécurité et le développement de l’Afrique de l’Ouest et centrale.
Une attitude désintéressée, dites-vous ?
Oui, car il n’y a pas de corrélation entre les interventions militaires de la France et l’implantation de ses intérêts économiques majeurs. Il suffit de voir où vont ses investissements directs sur le continent africain. Les pays d’Afrique du Nord, le Nigeria et l’Angola constituent à cet égard des partenaires économiques bien plus importants que ceux du Sahel.
Mais que faites-vous de toutes les critiques adressées à la France ?
Un regard lucide sur l’impéritie des États et la propagande démagogue permettrait d’éviter que notre pays ne devienne le bouc émissaire de toutes les frustrations. Néanmoins, même si la place qu’occupait la France est en net recul, son influence demeure, ne serait-ce qu’au travers de la langue. Sans cultiver la haine de soi, la France s’efforce de ne pas laisser le champ libre aux Chinois et aux Turcs, et de faire en sorte que les Africains ouvrent bien les yeux sur la réalité du soi-disant désintéressement de ses nouveaux partenaires.
Dans sa vision stratégique pour 2030, le chef d’état-major de l’armée de terre veut « réapprendre la grammaire de la guerre de haute intensité. » Un effet de mode ?
La plupart des analystes partagent ce point de vue. L’indéniable dégradation du contexte international et l’utilisation décomplexée de la violence rendent à nouveau possible le risque d’un conflit de haute intensité. Nous avons pris conscience que certaines conditions, qui nous étaient favorables ces trente dernières années, sont révolues.
De quelles conditions parlez-vous ?
La maîtrise du temps, la supériorité technologique de notre camp, le soutien continu de haut niveau. Il était temps de tenir compte des effets provoqués par les attaques cyber et la perte de la supériorité aérienne. Ce sera l’un des enjeux de l’exercice ORION programmé en 2023. Cet exercice de haute intensité de niveau divisionnaire verra un déploiement de forces en terrain libre, sans précédent depuis des décennies.
La France pourrait-elle à la fois conduire des guerres asymétriques (Sahel) et symétriques ?
De 1945 à 1991, l’armée française s’est préparée pour conduire simultanément deux types d’engagements très différenciés. Quand elle affrontait le vietminh puis le FLN, elle tenait en même temps son créneau en Centre Europe face au bloc soviétique. Ce n’est donc pas une nouveauté. Ce qui serait préjudiciable, ce serait que la guerre dite asymétrique nous fasse oublier les exigences de la haute intensité. L’analogie avec l’armée du Second Empire est classique : on peut avoir mené de glorieuses campagnes en Afrique, en Asie, au Levant et au Mexique, et subir une cuisante défaite à Sedan, face à un adversaire bien préparé et maîtrisant les armes de son temps, aujourd’hui les mini-drones et le cyber.
Faut-il consacrer plus de temps et de moyens à l’entraînement à la haute intensité ?
La « haute intensité » n’est pas un effet de mode, destiné à justifier des budgets. C’est le constat que même des armées de second rang peuvent se doter de technologies très performantes qui les rendraient redoutables en cas d’affrontement.
Que doivent trouver les jeunes Français dans l’armée quand ils s’engagent ?
Une camaraderie qui renforce leur amour du pays et la fierté de le servir, un style de vie qui développe leur goût pour l’action, une institution qui les promeut à hauteur des efforts accomplis.
Comment la formation des militaires a-t-elle évolué ces dernières années ?
La formation initiale se veut plus concrète et débarrassée d’une certaine forme d’intellectualisme qui avait fini par alourdir les programmes. Même si elle doit demeurer progressive et adaptée au niveau physique des recrues afin d’éviter les départs prématurés, l’objectif est bien d’aguerrir davantage les soldats. Il faut hausser le niveau d’exigence de la préparation opérationnelle, conformément à la volonté du CEMAT.
À lire aussi : La France au Sahel en 6 questions
La formation des jeunes officiers est-elle suffisante pour affronter la complexité du monde moderne ?
Quel que soit leur mode de recrutement, la durée de leur formation initiale et la richesse des cursus proposés sont bien adaptées. Nos élèves-officiers disposent du bagage requis pour devenir des chefs de section ou de peloton immédiatement efficaces. Pour ce qui est de la formation intellectuelle, la complexité du monde moderne me semble bien appréhendée par la diversité des enseignements dispensés.
Quel est le défi le plus crucial ?
Former des chefs de caractère, disciplinés, qui sauront dire la vérité. Cette formation du caractère doit hanter le véritable instructeur. L’histoire le rappelle : nos défaites ont rarement résulté d’une défaillance du matériel ou d’une infériorité numérique, mais bien d’une inaptitude à dire les choses telles qu’elles sont et non pas comme on souhaiterait qu’elles soient. L’obsession du formateur est de lutter contre le phénomène de cour. Il faut former des Vauban, capables de déplaire, tout en servant avec abnégation.
On pense à « l’incident de Villiers » de juillet 2017. Quels doivent être les rapports entre les chefs militaires et les responsables politiques ?
Cet incident a été surmonté avec le temps, même si certains commentaires désobligeants employés à l’encontre de l’ancien CEMA ont été ressentis, par la communauté militaire, comme des affronts qui auraient pu être évités. Ce couac donne néanmoins une fausse image des rapports entre dirigeants et chefs militaires qui sont plutôt apaisés, ces derniers respectant scrupuleusement la subordination de l’armée au pouvoir politique, avec la nécessité du devoir de vérité vis-à-vis de la nation et ses élus.
Mais il y a déjà eu des démissions de grands chefs !
Elles sont extrêmement rares. En cinquante ans, seuls trois CEMAT (Lagarde, Delaunay, Cuche) et un CEMA (de Villiers) ont quitté prématurément leur poste, la plupart du temps à la suite de désaccords sur le budget des armées.
Que pensez-vous de la notion de « droit de réserve » et de « loyauté » évoquées lors de la « tribune des généraux » ?
Rares sont les généraux qui durent quitter le service après avoir eu le courage d’exprimer un point de vue divergent. Je pense notamment au général Desportes, portant un regard critique sur la stratégie américaine en Afghanistan en 2010, alors qu’il commandait l’École de guerre. Onze ans après, on pourra toujours arguer qu’un général en activité se devait de faire preuve d’une plus grande retenue, la pertinence de son appréciation est bien réelle.
Les anciens militaires n’ont-ils pas le droit de s’exprimer ?
Leur dénier le droit de s’exprimer sur les problèmes touchant à la pérennité de la cité, en les cantonnant à un rôle de citoyens de seconde zone, témoigne d’une interprétation « fondamentaliste » du devoir de réserve. Seules la coutume et une pression subtilement entretenue l’ont transformé en mutisme de bon aloi.
Mais alors pourquoi cet émoi avec les tribunes de mai ?
Toutes ces réactions à l’emporte-pièce m’ont paru exagérées. Rendre hommage, à longueur de discours, à la clairvoyance du colonel de Gaulle et s’offusquer d’une tribune n’est pas cohérent. Encourager les militaires à s’exprimer pour faire profiter la nation de leur expérience et trouver intolérable une prise de position dans le débat public relève d’une certaine forme de jésuitisme. Le devoir de réserve, en rien spécifique aux militaires puisque s’imposant à l’ensemble de la fonction publique, avec les exigences de neutralité et de loyauté, vient-il interdire le « devoir de s’exprimer », en son âme et conscience, quand on estime le sujet essentiel pour l’avenir de son pays.
Et les allusions à une menace de putsch ?
Elles sont non seulement insultantes, mais grotesques. Comme l’a montré la réaction de l’opinion publique, « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Cette référence éculée n’a d’autre but que d’essayer de délégitimer des propos, sans avoir à y répondre sur le fond. Personne n’est dupe.
Mais le militaire ne se doit-il pas d’être totalement loyal ?
Il l’est, et tous ceux qui connaissent les armées en conviennent, sinon elles ne bénéficieraient pas d’un tel capital de confiance et de soutien. Mais ne confondons pas loyauté avec docilité qui peut conduire au mensonge et au reniement. Être loyal, c’est dire la vérité sans prendre parti, c’est défendre son point de vue, sans trahir de secret.
Où est alors la déloyauté ?
La pire des déloyautés à l’égard de son pays est celle dont fait preuve le chef militaire lorsqu’il ne dit aux dirigeants que ce qu’ils souhaitent entendre. On sait que le général Gamelin faisait preuve d’un art consommé dans ce domaine. Ce n’était pas le cas d’un Foch, capable de s’opposer vivement à Clemenceau, après la signature de l’armistice, pour défendre des garanties qui lui paraissaient plus à même de protéger la France. Qui de Foch ou de Gamelin fut le plus déloyal à la France ?
Les hommes politiques connaissent-ils vraiment les armées ?
À part les anciens auditeurs de l’IHEDN, la classe politique connaît relativement mal les armées. Un certain nombre de parlementaires, souvent spécialistes des questions de défense de leur parti, peut néanmoins se targuer d’une incontestable maîtrise des grands sujets et d’une vraie proximité avec les militaires. Ils connaissent bien les unités de leur circonscription, les visitent régulièrement en opération et produisent des rapports utiles pour notre défense.
Ce qui n’a pas empêché plus de trente années de baisse du budget de la défense de 1982 à 2018…
Oui, avec un vrai décrochage entre 1992 à 2002. On connaît les conséquences en matière capacitaire et dans l’usure des équipements. Cette situation montre les limites de l’intérêt porté à l’institution quand il n’est pas suivi de preuves concrètes d’amour.
À lire aussi : Terrorisme au Sahel et en France : le mirage de la victoire
On observe quand même un redressement depuis 2015…
Il est indéniable, surtout depuis 2018, même si l’on peut déplorer qu’il n’ait pas résulté d’une vision à long terme, mais d’une réaction dans l’urgence, devenue indispensable après les attentats de 2015. Sans ces tueries, on peut se demander jusqu’à quel point de non-retour l’armée française aurait continué de décroître. Un pays comme le nôtre, encore hanté par le spectre de1940 et qui fait encore reposer la responsabilité de la défaite sur l’inertie des chefs militaires, sait ce qu’il en coûte de ne pas anticiper les grandes ruptures géopolitiques. Seule une détermination inscrite dans la longue durée peut permettre de conserver une armée digne de ce nom.
Quand vous commandiez Barkhane, quel était votre livre de chevet ?
Un sentiment d’inachevédes lieutenants-colonels Oliva et Le Flem, remarquable de lucidité sur l’efficacité des opérations.
Quelles lectures conseillez-vous à un jeune qui envisage de s’engager ?
Les mémoires d’un Français rebelle du général Loustaunau-Lacau, pour réaliser ce qu’est la force d’âme, en dépit de toutes les vicissitudes. Castelnau, le quatrième maréchal de Benoît Chenu, pour comprendre la signification du mot abnégation. 1940, l’effondrement d’Henry de Wailly, pour ne jamais oublier où peut conduire le manque de caractère.