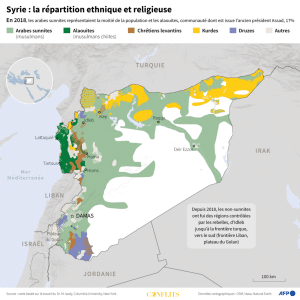Pakistan, Iran, Arabie saoudite : trois événements majeurs en terre d’islam qui font de 1979 une année tournant dans la géopolitique du monde musulman
L’année 1979 constitue un véritable point de bascule pour le monde musulman et, au-delà, pour l’ensemble du système international. Quatre événements s’enchaînent et se répondent : la prise de pouvoir de l’ayatollah Khomeini en Iran et la fondation de la République islamique, le coup d’accélérateur donné par le général Zia ul-Haq à l’islamisation du Pakistan, la prise d’otages à l’ambassade des États-Unis à Téhéran et, enfin, la prise d’otages à La Mecque menée par des insurgés radicaux contre la monarchie saoudienne. Tous traduisent une profonde reconfiguration de la place de l’islam dans la politique, dans les relations internationales et dans les rapports de pouvoir au sein du monde musulman.
Iran : la révolution
La révolution iranienne constitue l’élément le plus décisif de ce basculement. L’éviction du Shah, allié clé des États-Unis dans le Golfe, et l’avènement d’un régime théocratique chiite porteur d’un discours de mobilisation panislamique et révolutionnaire bouleversent les équilibres régionaux. Avec la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran, Khomeini donne à sa révolution une tournure ouvertement anti-américaine et se positionne comme le porte-parole des « opprimés » contre l’« arrogance » occidentale, ce qui lui permet de trouver des échos bien au-delà du monde musulman, depuis ce qu’on appelle aujourd’hui le « Sud global » jusqu’aux intellectuels de la gauche européenne. Dans le même mouvement, il se pose en adversaire déclaré des régimes arabes et musulmans jugés compromis avec l’Occident, au premier rang desquels l’Égypte, qui a signé cette même année les accords de paix avec Israël sous l’égide américaine, l’Arabie saoudite, allié stratégique de Washington, et le Pakistan, lui aussi inscrit dans la logique de la guerre froide et soutenu par les États-Unis face à l’Inde non alignée.
Arabie saoudite : attaque à La Mecque
Au même moment, la monarchie saoudienne est frappée de plein fouet par l’attaque de la Grande Mosquée de La Mecque, en novembre 1979 (16 jours après la prise d’assaut de l’ambassade américaine à Téhéran par les étudiants islamistes), qui révèle sa vulnérabilité face à un radicalisme sunnite endogène contestant sa légitimité religieuse.
Le 20 novembre 1979, au premier jour de l’an 1400 du calendrier hégirien, la Grande Mosquée de La Mecque, lieu le plus sacré de l’islam, est prise d’assaut par un groupe armé mené par Juhayman al-Otaybi, ancien membre de la Garde nationale saoudienne, et par son beau-frère Mohammed Abdullah al-Qahtani, présenté comme le Mahdi, le « messie » attendu par certains courants apocalyptiques de l’islam.
Le commando, composé de près de 200 hommes armés, parvient à infiltrer la mosquée avec des caisses d’armes dissimulées dans des cercueils censés contenir des fidèles décédés, profitant de la grande affluence des pèlerins pour brouiller les contrôles. Une fois à l’intérieur, ils proclament l’avènement du Mahdi et appellent les fidèles à prêter allégeance à leur chef.
La surprise est totale. Les forces de sécurité présentes sur place sont débordées et incapables de reprendre le contrôle du sanctuaire. Rapidement, les assaillants s’installent dans l’enceinte sacrée, bloquent les issues et organisent la résistance, utilisant les minarets comme positions de tir. Pendant deux semaines, la mosquée devient le théâtre d’un siège d’une rare intensité.
Le roi Khaled et le prince héritier Fahd ordonnent une répression totale, mais l’armée saoudienne n’a pas les moyens nécessaires de faire face à la situation. Pour débloquer la situation, Riyad fait appel à des conseillers étrangers, notamment des membres du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale française (GIGN), dépêchés sous couvert de « techniciens ». des forces spéciales pakistanise sont également dépêchées.
Les combats durent jusq’au 4 décembre 1979. Les assaillants tiennent la mosquée jusqu’au bout, multipliant les embuscades. Finalement, l’assaut combiné de l’armée saoudienne et des forces spéciales permet de reprendre progressivement le contrôle du sanctuaire. Le bilan est lourd. Environ 127 soldats saoudiens tués et plus de 450 blessés. Côté assaillants, la plupart sont tués au combat, tandis qu’une soixantaine de survivants sont capturés, jugés sommairement et exécutés publiquement en janvier 1980.
L’épisode marque profondément le royaume. Jamais la famille royale n’avait été ainsi défiée dans le lieu le plus sacré de l’islam, et par des sunnites issus de son propre terreau wahhabite. Or, le contrôle de la Mecque (et de Médine) est le rocher sur lequel les Saoudes (qui ne sont pas issus du prophète) ont bâti leur légitimité quand ils ont conquis ces lieux des mains de Hachemites, qui eux sont descendants en ligne directe de Hachim ibn Abd Manaf (mort en 510), arrière-grand-père de Mahomet, ils appartenaient comme lui à la tribu des Quraychites, riche et commerçante, qui dominait La Mecque. C’est donc une faille dans l’alliance entre le pouvoir politique et l’autorité religieuse saoudienne, que Riyad tentera aussitôt de colmater par un durcissement religieux massif.
Cet épisode pousse Riyad à accentuer son recours à l’islam comme instrument de légitimation politique. Le royaume mobilise alors ses ressources pour financer et soutenir (avec des cadres saoudiens) la diffusion d’un islam rigoriste, conçu comme une contre-offensive idéologique à l’appel révolutionnaire de Téhéran.

Des manifestants brûlent une effigie de l’Oncle Sam, devant l’ambassade des États-Unis à Téhéran, lors d’une manifestation de soutien aux militants iraniens qui ont pris le contrôle de l’ambassade le 4 novembre. 13 novembre 1979.
Pakistan : l’islamisation en accélérée
C’est dans ce contexte que se situe le rôle du Pakistan de Zia ul-Haq. Parvenu au pouvoir en 1977, il choisit après 1979 d’accélérer une islamisation par le haut, en adoptant la charia comme cadre législatif et en multipliant les références religieuses dans les institutions. L’Arabie saoudite soutient financièrement et idéologiquement ce processus, voyant dans le Pakistan un allié stratégique de poids démographique et militaire contre l’expansionnisme idéologique chiite de l’Iran. Riyad investit massivement dans l’éducation religieuse pakistanaise et dans la construction de mosquées et de madrasas, en exportant son modèle wahhabite.
Lorsque l’Union soviétique envahit l’Afghanistan en décembre 1979, le tournant islamiste pris par le général Zia ul-Haq au Pakistan trouve une nouvelle fonction. Dans la logique bipolaire de l’époque, la présence de troupes soviétiques aux portes de l’océan Indien est perçue comme une menace directe pour les intérêts occidentaux. Les États-Unis, encore meurtris par le traumatisme du Vietnam et empêtrés dans la crise iranienne, cherchent alors à riposter par un engagement indirect. Dans le contexte de la guerre froide il devient une arme au service de Washington. Le Pakistan de Zia, qui partage une longue frontière avec l’Afghanistan, se transforme en base arrière de la résistance moudjahidine.
Riyad, de son côté, s’associe étroitement à ce dispositif. L’Arabie saoudite, soucieuse d’endiguer l’influence de l’Iran révolutionnaire et de démontrer son rôle de champion du monde sunnite, injecte des milliards de dollars pour financer l’effort de guerre afghan. La CIA organise la logistique et l’armement des moudjahidines, l’Arabie saoudite égalant dollar pour dollar l’aide américaine, et le Pakistan, par l’intermédiaire de l’ISI (Inter-Services Intelligence), assure la formation, la redistribution et l’encadrement des combattants.
C’est pendant la décennie post-79 qu’apparaît une nouvelle génération de militants islamistes transnationaux, recrutés dans tout le monde musulman pour participer au djihad contre l’« infidèle soviétique ». Parmi eux, un jeune Saoudien issu d’une famille fortunée, Oussama Ben Laden. Il finance des activités et participe à la mobilisation idéologique et développe un réseau de volontaires étrangers venus d’Égypte, d’Algérie ou encore du Yémen. Ce qui n’était au départ qu’une lutte afghane contre une occupation étrangère devient progressivement une école du djihad global.
Ces choix ont des conséquences internes lourdes pour le Pakistan car ils ouvrent la voie à une polarisation confessionnelle jusque-là contenue. L’essor des mouvements sunnites radicaux, financés par l’étranger et favorisés par Zia, transforme progressivement les chiites pakistanais – pourtant bien intégrée dans la société pakistanaise – en cible. Les violences confessionnelles s’intensifient, inscrivant le pays dans une dynamique de confrontation religieuse qui perdure encore aujourd’hui, faisant oublier le fait que le père fondateur de la république islamique de Pakistan, Jinnah, était lui-même chiite.
Guerre au sein de l’islam
Sur le plan géopolitique, se dessine alors une sorte d’axe Islamabad–Riyad, opposé à Téhéran, dont la clef de voûte est l’islam politique mais selon une déclinaison concurrente. L’Iran révolutionnaire entend universaliser son modèle théocratique chiite et se pose en alternative aux régimes « inféodés » à l’Occident. L’Arabie saoudite, épaulée par le Pakistan, promeut au contraire une lecture rigoriste mais conservatrice de l’islam, arrimée à l’ordre établi, armée et alignée sur Washington. Dans cette rivalité, le Pakistan devient l’espace d’exportation et d’affrontement des deux visions, tout en servant de levier stratégique pour Riyad dans son combat d’influence.
Ainsi, 1979 ne constitue pas seulement une année charnière, mais un moment fondateur d’une conflictualité intra-islamique qui, en se superposant à la rivalité géopolitique entre Washington et Moscou, redessine durablement les équilibres du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud. L’axe Islamabad–Riyad, forgé dans la lutte contre l’Iran khomeiniste et consolidé par l’invasion soviétique de l’Afghanistan, inaugure une ère où l’islam politique devient le champ d’affrontements doctrinaux et politiques profonds entre ses versions sunnite et chiite. La révolution islamique en Iran a donné naissance à un chiisme d’État revendiquant un rôle hégémonique, tandis que le Pakistan et l’Arabie saoudite, avec l’appui américain, ont instrumentalisé l’islam sunnite comme arme stratégique dans la guerre froide. Ce double dynamique a nourri des fractures confessionnelles qui, des rues de Karachi aux vallées afghanes, se sont progressivement inscrites dans la géopolitique régionale et mondiale.
Aujourd’hui, cette histoire et l’imaginaire qu’elle a produit demeurent mobilisés dans le contexte nouveau de la compétition régionale entre l’Iran et l’Arabie saoudite, prolongée par des guerres par procuration en Irak, en Syrie, au Yémen ou au Liban. Le spectre de 1979 hante toujours la politique du monde musulman et reste l’une des clés essentielles pour comprendre la conflictualité actuelle au Moyen-Orient et au-delà.