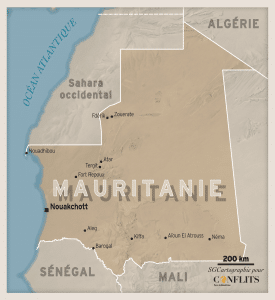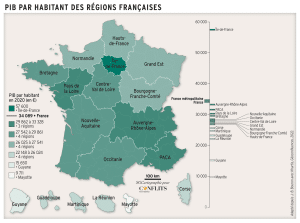Après un mandat initial au cours duquel il tenta de contrebalancer le poids de la Chine en amendant la relation des États-Unis avec la Russie selon la formule d’une stratégie triangulaire d’esprit kissingérien, le président Trump pourrait faire siens, désormais, certains concepts d’inspiration néoréaliste, alliant une stratégie d’offshore balancing dirigée contre la Chine, à un renforcement, dans la lutte hégémonique les opposant à cette dernière, des positions économiques des États-Unis.
Article paru dans le no56 – Trump renverse la table
La première élection de Donald Trump intervenait dans un contexte particulier, marqué par l’échec, sous tous ses avatars, de la doctrine de l’élargissement démocratique. Il paraissait loin le temps où l’effondrement de l’Union soviétique semblait annoncer la fin de l’histoire et l’avènement d’un monde unipolaire, quand, en septembre 1993, le conseiller pour la sécurité nationale du président Clinton, Anthony Lake, pouvait proclamer : « À la doctrine de l’endiguement doit nécessairement succéder une stratégie de l’élargissement, l’élargissement de la communauté mondiale libre des démocraties de marché[1]. » Pas plus que sa première expression, la forme militarisée que prit cette stratégie sous la présidence de George W. Bush ne permit aux États-Unis d’imposer au monde un ordre libéral[2].
Après la commotion causée par la crise financière de 2008 et l’effritement de la crédibilité des États-Unis dû à leur interventionnisme, Donald Trump engagea une politique censée assumer l’émergence du « monde post-américain[3] » décrit par Fareed Zakaria, après le « moment unipolaire[4] » qu’évoquait Charles Krauthammer.
Attentifs aux conseils d’Henry Kissinger[5], Donald Trump voulut conduire une politique consistant, non plus à surjouer l’unipolarité, mais à assumer la réalité d’un monde travaillé par la multipolarité.Selon les chercheurs sud-coréens Taesuh Cha et Jungkun Seo, le premier mandat de Donald Trump permit ainsi le « retour à une grande stratégie kissingérienne[6] ». L’Amérique de Trump voulait désormais rationaliser ses engagements extérieurs et promouvoir un « réalisme guidé par des principes ». Le nouveau président en lança la formule dans le discours qu’il prononça devant l’Assemblée générale des Nations unies le 19 septembre 2017. Il y exaltait la souveraineté comme vecteur de l’intérêt national et base d’une entente réciproque entre nations :
« Nous n’attendons pas que des pays divers partagent les mêmes valeurs, les mêmes traditions, voire les mêmes systèmes de gouvernement.
« … nous ne cherchons pas à imposer notre mode de vie à quiconque…
« En matière de politique étrangère, nous sommes en train de renouveler ce principe fondateur qu’est la souveraineté.
« Notre politique consiste en un réalisme guidé par des principes, enracinée dans des buts, des intérêts et des valeurs partagés. »
L’administration Trump confirma cette perspective dans la Stratégie de sécurité nationale publiée en décembre 2017 :
« Cette stratégie est inspirée par un réalisme guidé par des principes. Elle est réaliste parce qu’elle reconnaît le rôle central de la puissance en politique internationale, affirme que les États souverains sont le meilleur espoir pour la paix du monde et définit clairement nos intérêts nationaux… Nous sommes guidés par nos valeurs et disciplinés par nos intérêts[7]. »
Ces principes jetaient les bases d’un rééquilibrage prenant pour horizon la consolidation d’une stabilité multipolaire, que n’eût pas reniée Richard Nixon, selon qui :
« Nous devons nous rappeler que nous n’avons connu, dans l’histoire du monde, de périodes durables de paix qu’au temps où il y a eu un équilibre des puissances. C’est lorsqu’une nation devient infiniment plus puissante que son rival potentiel que le danger de guerre s’accroît[8]. »
Face au rival chinois
L’ascension de sa rivale chinoise était précisément, pour l’Amérique trumpienne, le premier défi à relever. Pour la contrebalancer, l’administration Trump entreprit de la replacer dans le cadre du triangle diplomatique formé, avec les États-Unis, par la Chine et la Russie. Alors que, dans les années 1970, Henry Kissinger avait entamé un progressif rapprochement avec la Chine pour rendre plus nécessaire, aux yeux de l’Union soviétique, sa politique de détente, Donald Trump tenta d’amender la relation des États-Unis avec la Russie, pour dissuader cette dernière de s’accorder avec la Chine. À rebours de la vision géopolitique de Zbigniew Brzeziński, l’intérêt des États-Unis était, dans cette perspective, que Moscou craignît davantage Pékin que Washington.
À lire aussi : Rencontre Chine-USA à Anchorage : concurrence stratégique
Dès l’élection de Donald Trump, Henry Kissinger avait milité en faveur d’un rapprochement avec la Russie. Après son investiture, le président Trump voulut s’engager dans cette voie. Il se heurta aussitôt à l’hostilité de hauts responsables du Département d’État et de membres du Congrès. Le 27 juillet 2017, le Sénat imposa au président Trump une loi renforçant les sanctions dirigées, entre autres, contre la Russie, le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Le 2 août, le président fut contraint de signer cette loi, qui compromettait sa tentative de rapprochement. Le sommet tenu à Helsinki avec Vladimir Poutine, en juillet 2018, n’aboutit, en conséquence, à aucune avancée significative.
Du côté de la Chine, l’Amérique trumpienne avait obtenu, certes, des résultats visibles, concrétisés par l’accord commercial conclu avec Pékin en janvier 2020, au terme d’un bras de fer commencé en 2018. Cependant, l’impossibilité d’amender la relation américano-russe pour détacher Moscou de Pékin laissa inachevé le projet diplomatique de Trump.
Second mandat et recentrage radical
Au début de son second mandat, Donald Trump semble faire le choix d’un recentrage strict sur les intérêts des États-Unis, afin de faire pièce aux ambitions chinoises. À la consolidation classique, chère à Nixon et à Kissinger, d’un ordre global, synonyme de stabilité, est préférée désormais la recherche d’une posture plus offensive, non exempte de schématisme, investissant le théâtre central de la rivalité sino-américaine. Sous le mot d’ordre de « la paix par la force » et l’influence de personnalités comme Elbridge Colby, le transactionnalisme de Donald Trump pourrait s’accommoder avec les concepts des néoréalistes John Mearsheimer et Robert Gilpin.
Plusieurs des personnalités désignées par Donald Trump durant la période de transition pour exercer des responsabilités ont pu sembler enclines à interpréter les enjeux mondiaux selon une grille de lecture civilisationnelle. Ce peut être le cas de Mike Huckabee, nommé ambassadeur en Israël. D’autres nominations semblent contredire cette tendance, comme celle de Tulsi Gabbard à la Direction du renseignement national. Ancienne représentante démocrate ralliée à Trump en 2024, elle est, de longue date, opposée à toute ingérence armée de nature idéaliste dans les affaires intérieures d’autres États. Croisant ainsi Reagan et Nixon en survalorisant des tactiques transactionnelles brutales, le trumpisme est en fait un peu tout cela en même temps. Notons également que, dans l’entourage de Trump, l’empreinte idéaliste semble aussi fonction de l’âge : la génération qui émerge paraît plus spontanément ouverte au réalisme. Le point commun à ces figures diverses, de Marco Rubio, nouveau secrétaire d’État, à Mike Waltz, conseiller pour la sécurité nationale, semble, de fait, leur détermination à contrer prioritairement la Chine.
Cet objectif sera au cœur de la nouvelle stratégie trumpienne. La désignation d’Elbridge Colby, le 22 décembre 2024, comme sous-secrétaire à la Défense pour les questions politiques, paraît le confirmer. Au début du premier mandat de Donald Trump, Elbridge Colby avait élaboré la Stratégie nationale de défense des États-Unis de 2018. Ce document reconnaissait que « la compétition stratégique interétatique [était] le souci primordial de la sécurité nationale des États-Unis[9] ». C’est dans le même texte que l’on voit apparaître la première occurrence de l’expression « paix par la force », « peace through strength ».
Les réflexions d’Elbridge Colby pourraient structurer intellectuellement, en les portant à un niveau vraiment stratégique, les intuitions de Donald Trump. Petit-fils de William Colby, directeur de la CIA de 1973 à 1976, Elbridge Colby est avant tout un réaliste, clairement opposé à toute surextension du dispositif stratégique des États-Unis. Avec lui, Trump fait une place, dans son cabinet, à un réalisme qui pense aussi la lutte hégémonique. Dans The Strategy of Denial, Colby affirme que l’Asie est « la région la plus importante du monde », l’un des « théâtres décisifs pour la politique mondiale[10]», polarisé, en son milieu par la Chine, rivale principale des États-Unis pour la prépondérance mondiale. Il en déduit que les Américains devraient concentrer leurs efforts sur l’Asie et sur la région Indopacifique, au lieu de s’engager, de manière coûteuse, dans des régions aussi différentes et éloignées que l’Ukraine et le Moyen-Orient. Ainsi la priorité stratégique des États-Unis devrait-elle être d’empêcher la Chine d’établir, dans sa région et à son bénéfice, une vaste sphère de prospérité.
Elbridge Colby sait toutefois que l’Amérique ne peut y réussir seule. À la stratégie de la « domination », qui, de son propre aveu, est aujourd’hui impraticable, il convient, selon lui, de substituer une stratégie du « déni », qui est une stratégie de contention opposée à la puissance chinoise. Elle se présente, en partie, comme une actualisation de la stratégie d’« offshore balancing », fréquemment évoquée par le réaliste offensif John Mearsheimer. Pour Colby, d’accord avec Mearsheimer, l’Amérique ne peut espérer exercer une hégémonie ubiquiste et s’imposer comme le gendarme du monde. Le « pouvoir paralysant des eaux » dont parle Mearsheimer[11], c’est-à-dire le cloisonnement spatial imposé par les océans, assigne aux hégémonies une sorte de bornage régional : aucune puissance n’a les moyens de s’imposer décisivement sur tous les continents. Dès lors, la stratégie rationnelle que la puissance hégémonique centrale doit opposer à l’émergence d’un rival sur un autre continent consiste à favoriser l’affirmation de puissances régionales qui lui fassent contrepoids. Colby ne propose pas autre chose, lorsqu’il affirme[12] :
« Le moyen pour les États-Unis de s’assurer qu’un autre État n’établisse pas son hégémonie sur une région clef consiste à maintenir des équilibres de puissance favorables au niveau régional. L’on peut empêcher un État comme la Chine d’atteindre l’hégémonie régionale si un nombre suffisant d’autres États, situés ou actifs dans la région clef, parviennent à se coaliser pour disposer de plus de puissance que la puissance aspirant à l’hégémonie. »
C’est pourquoi Colby souligne la nécessité pour l’Amérique de favoriser l’émergence d’une telle coalition dans la zone Indopacifique, joignant, à son propre poids, celui de puissances régionales comme le Japon, l’Australie et l’Inde, et même le Vietnam communiste.
À lire aussi : Etats-Unis : Moist county
En consonance avec le mercantilisme trumpien, Elbridge Colby se garde bien, cependant, de n’envisager ce bras de fer que selon des modalités militaires. La dimension économique de cette rivalité est considérée comme centrale. À la grille de lecture de John Mearsheimer, les décideurs trumpiens superposent le schéma des cycles hégémoniques défini par Robert Gilpin[13]. La stratégie de contention qu’ils souhaitent conduire a, en effet, pour visée d’accroître, pour la Chine, les coûts marginaux d’un changement hégémonique, de sorte qu’ils soient supérieurs aux bénéfices marginaux que celle-ci pourrait en tirer. Cette même stratégie ne peut réussir que si, dans le même temps, la puissance hégémonique, c’est-à-dire les États-Unis, veille à réduire les coûts marginaux liés au maintien du statu quo, de sorte qu’ils n’oblitèrent pas sa capacité de croissance. D’où le tropisme mercantiliste du président Trump, qui, voyant les principales puissances engagées dans un nouveau grand jeu, qu’il conçoit comme un jeu à somme nulle, entend maximiser les gains économiques de son pays et développer le plus possible ses capacités productives. En ce sens, l’administration Trump entend bien favoriser le retour brutal à une forme d’équilibre global au profit des États-Unis, équilibre défini par Gilpin comme la situation dans laquelle aucun acteur ne peut escompter tirer bénéfice d’un changement systémique.
Un réalisme offensif
Après le rééquilibrage kissingérien tenté lors de son premier mandat, est venu, pour Donald Trump, le moment d’un recentrage. Ce recentrage est stratégique, puisqu’il doit conduire les États-Unis à rapporter strictement leurs engagements à leurs intérêts ; il est géographique et concerne au premier chef la zone Indopacifique, où se joue leur rivalité systémique avec la Chine ; il est radical, car fonction des foucades du président et de sa survalorisation de l’outil transactionnel.
C’est surtout en mettant en œuvre une véritable stratégie de contention à distance aux abords de la Chine, qui passe par la formation d’une coalition anti-hégémonique liant aux États-Unis des puissances régionales, que l’administration Trump pourrait rétablir, selon l’expression d’Elbridge Colby, un « équilibre favorable ».
Pour entreprendre cette tâche dans la durée, Donald Trump dispose d’atouts. La formation rapide de son cabinet révèle l’ascension d’une nouvelle génération de responsables, tout à la fois conservateurs et plus volontiers réalistes en matière de politique étrangère.
Après l’échec des néolibéraux et des néoconservateurs, les Américains pourraient entrer, avec Donald Trump, dans une ère réaliste originale, croisant étonnamment la brutalité de tactiques transactionnelles et de pulsions jacksoniennes avec la logique structurante d’une stratégie de réaffirmation indirecte, face à un monde anarchique et compétitif, où ils n’auraient plus à prêcher mais à négocier. Si cette évolution se confirmait, l’homme d’affaires Trump aurait réussi, après les très cérébraux Nixon et Kissinger, à acclimater aux États-Unis une forme de réalisme.
[1] « The Four Pillars to Emerging `Strategy of Enlargement’ », The Christian Science Monitor, 29 septembre 1993.
[2] MEARSHEIMER, John J., « Bound to fail : The Rise and Fall of the Liberal International Order », International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 7–50.
[3] ZAKARIA, Fareed, The Post-American World : And The Rise Of The Rest, Penguin Books Ltd, 2009, 336 p.
[4] KRAUTHAMMER, Charles, « The Unipolar Moment », Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, America and the World 1990/91 (1990/1991), pp. 23-33 (11 pages).
[5] WOLFF, Michael, Fire and Fury : Inside the Trump White House, New York, Little, Brown, 2018, 336 p.
[6] CHA, Taesuh, et SEO, Jungkun, « Trump by Nixon : Maverick presidents in the years of U.S. relative decline », Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 30, mars 2018, pp. 79-96 ; p. 86 : a « Kissingerian grand strategy redux ».
[7] https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf ; Conclusion, p. 65
[8] KISSINGER, Henry A., Diplomacy, New York, Simon & Schuster, 1994, 912 p. ; p. 705.
[9] Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America, Sharpening the American Military’s Competitive Edge, 11 p. ; p. 1.
[10] COLBY, Elbridge A., The Strategy of Denial, American Defense in an Age of Great Power Conflict, New Haven and London, Yale University Press, 2021, 356 p. ; p. 5 . »
[11] MEARSHEIMER, John J., The Tragedy of Great Power Politics, New York, W.W. Norton & Co., 2001, 576 p.
[12] COLBY, Elbridge A., op. cit., p. 16.
[13] GILPIN, Robert, War and Change in International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, 288 p.