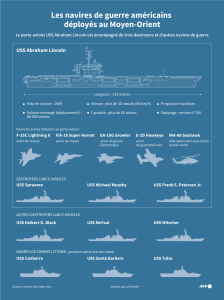Entre la Chine et Taïwan, l’équilibre est précaire. Taipei maintient son indépendance face à Pékin qui souhaite l’annexion. Les États-Unis sont-ils prêts à défendre l’île coûte que coûte ? Personne ne souhaite vraiment sortir de l’ambiguïté stratégique.
Le statut politique de Taïwan (désignée officiellement comme la République de Chine) constitue un sujet de discorde majeur entre Pékin et Taipei depuis son établissement de facto comme État en 1949. La pérennité du statu quo qui s’est progressivement imposé interroge tant les positions des deux parties semblent irréconciliables.
En 1999, le Parti Démocrate Progressiste taïwanais adoptait une résolution affirmant la souveraineté de Taïwan et déclarant que tout changement au statu quo devra être décidé par les citoyens taïwanais par voie de référendum. La République Populaire de Chine considère au contraire que l’archipel fait partie intégrante de la Chine, Xi Jinping rappelant fréquemment l’objectif de « réunification » sans écarter un éventuel retour à la force.
Le maintien de ce statu quo est un enjeu majeur pour Washington, qui y voit un vecteur de stabilité de la zone indopacifique, mais aussi un atout stratégique en ce qu’il permet aux États-Unis d’entretenir des relations, notamment commerciales, avec la Chine et Taïwan. Ces intérêts expliquent le recours à la politique de l’« ambiguïté stratégique », une doctrine qui dicte la politique étrangère américaine sur ce sujet depuis 1979. L’efficacité de cette dernière est néanmoins contestée par les tenants de la « clarté stratégique », un courant plus offensif présenté par ses soutiens comme davantage adapté à la menace que représentent aujourd’hui les ambitions hégémoniques chinoises.
L’« ambiguïté stratégique » concernant Taïwan, une tradition américaine
Bien que les premières évocations de ce concept en tant que tel datent des années 1990, ses origines se situent au 15 décembre 1978, date à laquelle le président américain Jimmy Carter annonçait publiquement sa volonté de rompre les relations diplomatiques avec Taïwan afin de renforcer ses liens avec la République Populaire de Chine1. Cette réorientation diplomatique impliquait la résiliation unilatérale d’un traité de défense mutuelle (Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of China) signé en 1954 entre les États-Unis et Taïwan. En vertu de ce traité, les signataires s’engageaient notamment à « développer individuellement et collectivement leur capacité à résister à toute attaque armée ou activité communiste subversive » menaçant « leur intégrité territoriale et stabilité politique » ainsi qu’à considérer toute attaque contre l’une des parties comme « menaçant sa propre sécurité »2.
Dans le double objectif de rassurer Taïwan face à ce revirement, mais aussi de préserver ses intérêts économiques avec l’archipel, le Congrès adoptait le Taiwan Relations Act (TRA) en 1979. Selon les termes de ce dernier, l’établissement d’une relation diplomatique avec Pékin ne devait se faire qu’à condition « que le futur de Taïwan soit déterminé par des moyens pacifiques » ; dans le cas contraire, les États-Unis « se réservent la possibilité de s’opposer à tout usage de la force qui menacerait la sécurité de peuple de Taïwan »3. Il ressort de l’adoption du TRA que ce qui pouvait être vu comme une garantie de sécurité bilatérale automatique dans le cadre du traité de 1954 perdait ce caractère d’automaticité pour n’être plus soumis qu’à la seule volonté discrétionnaire de l’administration américaine. Cette absence d’engagement ferme des États-Unis introduit un élément d’incertitude qui servira de base à la doctrine de « l’ambiguïté stratégique ».
Les États-Unis sont-ils prêts à intervenir ?
Dès lors, les différentes administrations américaines eurent successivement recours à une stratégie consistant à laisser planer le doute quant à une intervention militaire de Washington en cas d’agression. Cette « stratégie de l’ambiguïté » est intimement liée à la politique d’« une seule Chine » (one-China policy) entretenue par Washington. En adoptant la politique d’« une seule Chine », Washington reconnaît officiellement la République Populaire de Chine comme seul gouvernement officiel en Chine au détriment du gouvernement taïwanais. Cependant, cette politique inclut les dispositions du TRA qui permettent aux États-Unis d’entretenir des relations non officielles avec Taipei sur les plans politique, économique et sécuritaire. L’administration américaine se réserve ainsi la possibilité d’invoquer le TRA en cas d’attaque contre Taïwan.
Ainsi articulée, cette politique d’« une seule Chine » , en raison notamment de la dimension discrétionnaire du TRA, offre la possibilité aux États-Unis de s’appuyer sur la « stratégie de l’ambiguïté » afin d’instaurer une double dissuasion qui pèse tant sur la Chine continentale que sur Taïwan et qui fait figure de pilier du statu quo. Le TRA vise en effet à prévenir toute modification unilatérale de ce statu quo, qu’elle soit initiée par Pékin ou Taipei, en laissant planer le doute quant à l’intervention effective des États-Unis le cas échéant. Toute agression décidée par Pékin est découragée par la perspective de voir les États-Unis intervenir aux côtés de Taïwan. Parallèlement, la crainte que Washington n’intervienne pas est censée dissuader Taipei de toute initiative allant à l’encontre du statu quo, comme entreprendre une déclaration d’indépendance. L’efficacité de cette position qui conduit à soutenir l’autonomie de Taïwan sans reconnaître son indépendance ni s’engager clairement à défendre l’archipel en cas d’offensive continentale fait cependant l’objet de débats nourris par les prétentions hégémoniques grandissantes de Pékin.

Présence du président taïwanais, Lai Ching-Te, à une cérémonie de remise de diplôme d’officiers de l’armée taïwanaise. 26 juin 2025. (Credit Image: © Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire)
Une stratégie remise en question
La « stratégie de l’ambiguïté » a parfois été remise en question depuis le Bureau ovale. En 2001, George W. Bush déclarait que les États-Unis feraient « ce qu’il faut pour aider Taïwan à se défendre » sans toutefois donner plus de précisions sur les moyens qui seraient mis en place. Plus récemment, c’est le président Joe Biden qui est sorti de la « stratégie de l’ambiguïté » en rappelant que Washington s’était engagé à défendre Taïwan en cas d’attaque. Le démocrate ira même jusqu’à comparer cet engagement à l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord : « Nous avons pris un engagement sacré via l’article 5 selon lequel, nous répondrons à quiconque envahit ou s’en prend à nos alliés de l’OTAN. C’est la même chose avec le Japon, la Corée du Sud, avec Taïwan »4. Ces prises de positions claires ont donné naissance à une stratégie alternative, la « stratégie de la clarté ».
Faut-il changer de stratégie ?
Les soutiens de cette dernière estiment que le contexte international se prête à un changement de stratégie en soulignant l’agressivité croissante de la Chine continentale. Depuis plusieurs années Pékin multiplie les pressions sur Taïwan en adoptant une approche multi-dimensionnelle. D’un point de vue militaire, la Chine diligente divers exercices à proximité de l’archipel et pénètre fréquemment son espace aérien. Cette approche hybride, parfois qualifiée de « stratégie de l’intégration », passe également par l’isolement diplomatique de Taïwan et des campagnes d’influence5. Pour ses détracteurs, la « stratégie de l’ambiguïté » ne suffirait plus à dissuader la Chine, qui ne cesse d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de Taïwan, de passer à l’offensive. L’U.S. Naval Institute estime ainsi que Washington doit sortir de la « stratégie de l’ambiguïté » afin de convaincre Pékin, « sans équivoque », que tenter de mettre en œuvre son projet d’unification par la force aurait un coût trop élevé. En clair, Washington devrait clairement s’engager à défendre Taïwan et indiquer à Pékin les actions qui entraîneraient une réponse américaine6.
Un tel changement de stratégie risque néanmoins de nuire aux intérêts commerciaux des États-Unis dans la zone indopacifique, ces derniers bénéficiant de la « stratégie de l’ambiguïté », sans présenter de plus-value. La « stratégie de la clarté », davantage adaptée à l’hypothèse d’une action militaire ou d’un blocus, ne permettrait pas, par exemple de mettre fin aux attaques dites « de zone grise » que subit Taïwan7. Cette alternative stratégique pourrait surtout être perçue comme une provocation par le gouvernement chinois, ce qui pourrait mener à l’escalade8. Ce risque amène la plupart des experts à militer pour le maintien d’une « stratégie de l’ambiguïté » certes imparfaite, mais qui est demeurée efficace jusqu’ici.
Depuis son retour à la Maison–Blanche, Donald Trump semble s’inscrire dans la tradition stratégique américaine concernant Taïwan. Lors de la campagne de 2024, certaines de ses prises de position avaient suscité l’inquiétude à Taipei. Ainsi de sa déclaration selon laquelle « Taïwan vole notre marché des puces électroniques, et ils veulent qu’on les protège » ou de ses attaques sur le budget alloué par Taïwan à sa défense, qu’il considère insuffisant. Toutefois, Donald Trump s’inscrit dans la tradition de la « stratégie de l’ambiguïté » dès lors que le sujet d’une intervention américaine en cas d’agression est abordé. Refusant de donner une réponse claire (« Je ne fais jamais de commentaire là-dessus. Je n’ai pas envie de me mettre dans une telle position »), le républicain n’écarte pas d’éventuelles sanctions financières à l’encontre de Pékin (« Je lui dirais : si vous envahissez Taïwan, je suis désolé, mais je vais vous imposer des droits de douane allant de 150 à 200% »). Ces déclarations, considérées comme la définition même de la « stratégie de l’ambiguïté », indiquent que cette dernière prévaut toujours dans le cadre du conflit opposant la Chine continentale à Taïwan9.
-
https://www.heritage.org/asia/report/the-taiwan-relations-act-after-20-years-keys-past-and-future-success
-
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/chin001.asp
-
https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479
-
https://www.fpri.org/article/2025/05/the-return-to-strategic-ambiguity-assessing-trumps-taiwan-stance/
-
https://www.ft.com/content/e253e7d4-b97e-44b1-8820-5351cb531ab2
-
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2023/march/strategic-ambiguity-taiwan-has-run-its-course
-
https://www.heritage.org/china/commentary/should-the-usa-maintain-its-policy-strategic-ambiguity-towards-taiwan
-
https://www.nbr.org/publication/in-defense-of-strategic-ambiguity-in-the-taiwan-strait/
-
https://www.nbr.org/publication/in-defense-of-strategic-ambiguity-in-the-taiwan-strait