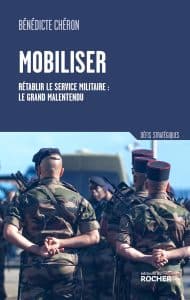Arthur Ballanger
Dans l’ombre du Kremlin, loin des projecteurs médiatiques occidentaux, opèrent des institutions largement ignorées du public français mais qui jouent un rôle essentiel dans la construction du discours stratégique russe. Le Club Valdaï, le Conseil russe des affaires internationales (RIAC), l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales (IMEMO). Ces noms n’évoquent probablement pas grand-chose pour la plupart des observateurs européens, pourtant, ces think tanks constituent des rouages essentiels de la machine diplomatique russe, participant activement à la formulation des concepts qui structurent la vision du monde portée par Moscou.
Ces laboratoires d’idées incarnent un paradoxe fascinant. D’un côté, ils se présentent comme des centres de recherche indépendants, produisant analyses et recommandations. De l’autre, leur proximité avec le pouvoir, leurs modes de financement et la circulation de leurs personnels avec l’appareil d’État en font des instruments au service d’une politique étrangère centralisée. Cette ambiguïté n’est pas un défaut de conception mais bien une caractéristique structurelle qui révèle la nature même du système politique russe contemporain.
Comment ces institutions participent-elles concrètement à la construction doctrinale de la politique étrangère russe ? Quels concepts produisent-elles, comment les diffusent-elles, et quelle est leur influence réelle sur les orientations stratégiques du Kremlin ? L’analyse de ces questions offre une clé de lecture importante pour comprendre non seulement la politique russe, mais aussi la manière dont se fabrique aujourd’hui le discours géopolitique dans un contexte de confrontation entre la Russie et l’Occident.
Un paysage institutionnel entre héritage et renouveau
L’écosystème des think tanks russes ne peut se comprendre sans un détour par l’histoire. La chute de l’URSS en 1991 a profondément bouleversé l’organisation de la recherche stratégique, ouvrant une période de transformation qui se poursuit aujourd’hui. L’ancien système soviétique, où l’analyse politique était monopolisée par des structures intégrées à l’appareil d’État comme l’agence TASS ou les instituts de l’Académie des sciences, s’est progressivement mué en un paysage plus diversifié, bien que toujours étroitement lié au pouvoir¹.
Les années 1990 ont constitué une première phase d’expérimentation. Les structures héritées du système soviétique ont dû s’adapter à un contexte de liberté nouvelle mais aussi de ressources drastiquement réduites. Des initiatives privées ont émergé, comme le Centre Carnegie de Moscou, financé par des fondations occidentales, ou le Bureau des échanges informationnels de Moscou, première tentative de créer une agence d’information indépendante². Cette période d’effervescence a vu naître une multitude de petites structures, souvent éphémères, qui cherchaient leur modèle entre conseil politique, journalisme d’analyse et recherche académique.
La décennie 2000 marque une phase de consolidation sous l’impulsion du pouvoir poutinien. Le Kremlin prend conscience de l’importance de disposer d’institutions capables de produire une expertise stratégique tout en projetant une image de sophistication intellectuelle sur la scène internationale. C’est dans ce contexte que s’opère une restructuration profonde. Certains cabinets de conseil se transforment en véritables think tanks, d’autres disparaissent, et de nouvelles institutions voient le jour sous l’égide directe ou indirecte de l’État.
Les années 2010 inaugurent une troisième phase, celle de l’instrumentalisation assumée. La création du RIAC en 2010 par décret présidentiel illustre parfaitement cette évolution³. Il ne s’agit plus de feindre l’indépendance mais d’assumer la création d’outils au service de la diplomatie publique russe. Cette période voit également la transformation du Club Valdaï d’un cercle confidentiel en une vitrine médiatique internationale⁴.
Trois institutions emblématiques incarnent aujourd’hui les différents modèles de think tanks russes. L’IMEMO, fondé en 1956 et rebaptisé en l’honneur d’Evgueni Primakov en 2015, représente la continuité du modèle académique soviétique. Avec plus de 130 chercheurs permanents, il maintient une approche traditionnelle centrée sur la recherche fondamentale. Sa production, environ 100 articles par an, privilégie la qualité analytique sur la quantité, et ses publications restent majoritairement physiques, témoignant d’une certaine résistance à la modernisation numérique. L’institut conserve néanmoins une influence considérable, figurant régulièrement dans le top 50 mondial des think tanks selon le classement de James McGann⁵.
Le RIAC incarne un modèle radicalement différent. Créé en 2011 sous l’impulsion de Dmitri Medvedev, il fonctionne comme une plateforme de diplomatie publique institutionnalisée. Avec une production dépassant 400 articles par an, disponibles en russe et en anglais, le RIAC mise sur une diffusion massive et multilingue. Son financement hybride – 50 % de fonds publics, 50 % de contrats privés – lui permet d’afficher une apparence d’indépendance tout en restant étroitement lié au ministère des Affaires étrangères⁶. L’institution mobilise une équipe permanente de 35 personnes mais s’appuie sur un réseau de centaines d’experts externes, créant ainsi une structure flexible capable de s’adapter rapidement aux enjeux du moment.
Le Club Valdaï représente le cas le plus singulier. Fondé en 2004 comme un cercle fermé permettant des rencontres informelles entre experts occidentaux et dirigeants russes⁷, il s’est métamorphosé en un forum international majeur. Sa conférence annuelle, point d’orgue médiatique avec la participation systématique de Vladimir Poutine, est retransmise en direct à la télévision. Le Club a développé quatre programmes thématiques permanents et publie régulièrement des rapports qui façonnent le débat stratégique russe. Sa transformation illustre parfaitement l’évolution de la diplomatie publique russe d’un espace de dialogue discret à un instrument de projection du narratif stratégique national.
Ces trois modèles adoptent des stratégies de communication radicalement différentes. L’IMEMO maintient une présence numérique minimale, privilégiant les canaux académiques traditionnels. Le RIAC développe une stratégie multiplateforme, présent sur les réseaux sociaux russes (Telegram, VKontakte) comme occidentaux, organisant un à deux événements mensuels. Le Club Valdaï mise sur l’événementiel spectaculaire, avec des conférences régionales et surtout son forum annuel qui attire l’attention médiatique internationale. Cette diversité d’approches révèle moins une concurrence qu’une complémentarité orchestrée, chaque institution occupant une niche spécifique dans l’écosystème de la diplomatie publique russe.
À lire également : Le syndrome post-impérial russe : entre nostalgie et ambitions géopolitiques
La fabrique des concepts stratégiques
Les think tanks russes ne se contentent pas de commenter l’actualité internationale : ils produisent activement les concepts qui structurent la vision du monde portée par le Kremlin. Cette production intellectuelle s’organise autour de grandes thématiques récurrentes qui forment le socle idéologique de la politique étrangère russe contemporaine.
La multipolarité constitue le concept cardinal de cette architecture intellectuelle⁸. Présentée non comme un projet mais comme une réalité objective découlant de la redistribution du pouvoir mondial, elle offre une grille de lecture alternative à l’ordre dit « fondé sur des règles » promu par l’Occident. Les think tanks russes développent inlassablement cette thématique, l’enrichissant de nuances et de développements qui permettent de l’adapter aux évolutions géopolitiques. Le RIAC comme le Club Valdaï en ont fait l’un de leurs axes d’analyse privilégiés, multipliant les articles et les tables rondes sur cette question.
L’idée d’État-civilisation représente une innovation conceptuelle majeure dans le discours des think tanks russes⁹ ¹⁰. Cette notion transcende le cadre westphalien de l’État-nation pour présenter la Russie comme le cœur d’un espace civilisationnel orthodoxe et eurasiatique. Le « Monde russe », englobant les populations russophones au-delà des frontières, devient ainsi non pas un projet impérialiste mais l’expression d’une réalité culturelle et spirituelle qui justifie une politique étrangère protectrice. Cette construction intellectuelle permet de légitimer des interventions extérieures tout en les présentant comme défensives.
La dichotomie entre « majorité mondiale » et « milliard doré » occidental constitue une trouvaille rhétorique particulièrement efficace¹¹. Développée à partir de 2022, elle permet de présenter la Russie non comme isolée mais comme porte-parole du Sud global face à une minorité occidentale privilégiée. Cette inversion du rapport de force symbolique transforme les sanctions en preuve de l’injustice du système international et positionne Moscou comme leader naturel des pays non alignés.
L’analyse quantitative de la production de ces think tanks révèle des évolutions significatives. Sur l’ensemble des publications analysées, 70 % concernent les questions diplomatiques au sens large, mais on observe un pic notable des thématiques sécuritaires en 2022, passant de 15 % à près de 30 % des articles. Cette inflexion traduit l’adaptation du discours au contexte de confrontation avec l’Ukraine et l’OTAN.
Le cas du « tournant vers l’Asie » illustre parfaitement les mécanismes de circulation des idées entre think tanks et sphère officielle. Le concept apparaît d’abord dans une série de rapports du Club Valdaï publiés entre 2012 et 2016, intitulés *« Vers le grand océan »*¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵. L’analyse lexicométrique des documents officiels de politique étrangère montre une augmentation de 32 % des références à l’Asie entre les conceptions de 2008 et 2023¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹. Les termes comme « Eurasie », absents en 2008, apparaissent 11 fois dans le document de 2023. Cette progression n’est pas fortuite : elle traduit l’intégration progressive d’un concept d’abord théorisé dans les cercles experts avant d’être repris et officialisé par le pouvoir.
La production de ce vocabulaire stratégique commun remplit plusieurs fonctions :
– elle fournit un langage partagé qui devient la référence pour tous les acteurs du débat ;
– elle donne une justification intellectuelle aux décisions politiques, qui apparaissent comme logiques ;
– et elle permet d’exporter ces idées à l’international, notamment vers les pays du Sud global partageant une méfiance envers l’ordre occidental.

Des partisans de la junte au pouvoir au Niger brandissent un drapeau russe au début d’une manifestation appelant à lutter pour la liberté du pays et à repousser l’ingérence étrangère à Niamey, au Niger, le 3 août 2023.
(AP Photo/Sam Mednick) (C) SIPA
À lire également : La poussée russe en Afrique se poursuit
Une influence ambiguë entre expertise et légitimation
L’analyse de l’influence réelle des think tanks russes sur la politique étrangère révèle un paradoxe fondamental. Ces institutions produisent indéniablement des idées qui se retrouvent dans le discours officiel, organisent des forums où se rencontrent décideurs et experts, publient des analyses qui façonnent le débat stratégique. Pourtant, leur impact direct sur le processus décisionnel reste limité par la structure même du système politique russe.
La verticalité du pouvoir en Russie constitue la première limite structurelle à l’influence des think tanks. Les décisions de politique étrangère sont prises dans un cercle restreint autour du président, impliquant le Conseil de sécurité, l’administration présidentielle et quelques conseillers proches. Les think tanks, même les plus prestigieux, n’ont pas de siège à cette table décisionnelle. Leur influence s’exerce en amont, par la production de concepts et de grilles d’analyse, mais sans reconnaissance explicite.
La reconnaissance publique du rôle des think tanks reste limitée et sélective. Si Vladimir Poutine participe annuellement au forum du Club Valdaï et évoque parfois les débats qui s’y tiennent, il ne cite jamais explicitement les rapports ou analyses produits par ces institutions comme sources de ses décisions. Les concepts circulent, le vocabulaire est adopté, mais l’origine intellectuelle reste floue. Cette ambiguïté maintient une distance symbolique : le pouvoir montre qu’il écoute les experts lors de forums prestigieux, mais préserve l’image d’une décision souveraine.
L’analyse de la composition des conseils d’administration de ces institutions révèle une autre dimension de cette relation ambiguë. Le RIAC compte parmi ses dirigeants d’anciens ministres et ambassadeurs ; le Club Valdaï est présidé par des figures proches du Kremlin ; l’IMEMO, institution de l’Académie des sciences, cumule les liens institutionnels et financiers. Cette interpénétration crée moins une influence ascendante qu’une circulation des idées dans un milieu homogène.
Trois modalités d’influence indirecte caractérisent néanmoins l’action de ces think tanks :
– L’influence structurelle : ils créent le cadre conceptuel dans lequel s’inscrit le débat stratégique. Les notions de multipolarité, d’État-civilisation ou de majorité mondiale deviennent des évidences.
– L’influence instrumentale : leurs analyses sont mobilisées pour justifier des décisions déjà prises, fournissant un habillage intellectuel a posteriori.
– L’influence symbolique : ils projettent l’image d’une Russie sophistiquée, capable de produire une réflexion stratégique de haut niveau.
Leur rôle s’apparente ainsi à celui d’un accompagnement intellectuel du pouvoir : ils conçoivent des visions, sans décider de leur application.
Les think tanks remplissent également une fonction de diplomatie parallèle, maintenant des canaux de communication avec l’étranger même en période de tensions : le Club Valdaï continue d’attirer des experts occidentaux, le RIAC maintient des partenariats internationaux, l’IMEMO participe à des projets conjoints. Ces liens préservent des possibilités de dialogue et permettent de tester des propositions sans engagement officiel.
Conclusion
Les think tanks russes incarnent les ambiguïtés du système politique qui les a engendrés : ni véritablement indépendants, ni simples courroies de transmission du pouvoir, ils occupent un espace intermédiaire où se formulent les justifications de l’action politique. Leur observation révèle comment le pouvoir russe cherche à construire et projeter une vision cohérente de sa place dans le monde.
Comprendre le rôle du Club Valdaï, du RIAC ou de l’IMEMO permet de décrypter les discours stratégiques russes et d’identifier les concepts structurants de sa politique étrangère. Depuis 2022, ces institutions réorientent leurs activités vers de nouveaux partenaires — BRICS, Asie, majorité mondiale — illustrant la reconfiguration des priorités diplomatiques de Moscou. Leur production intellectuelle reste ainsi un indicateur précieux des directions stratégiques envisagées par le Kremlin.
Notes
¹ Kuzmina, A. (2013). *Think Tanks en Russie : Conditions d’émergence et de pérennisation.* Université Panthéon-Sorbonne.
² Sungurov, A. (2012). *« Fabriki Mysli » i Centry Publichnoj Politiki v Rossii i v Drugih Post-Komunisticheskih Stranah : Razvitie i Funkcii \[Think tanks et centres de politique publique en Russie et dans d’autres pays postcommunistes : Développement et fonctionnement].* *The Soviet and Post-Soviet Review*, 39(1), 22-55. (https://doi.org/10.1163/187633212X623952)
³ *Rasporjazhenie Prezidenta Rossijskoj Federacii O sozdanii nekommercheskogo partnerstva « Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam » \[Décret du Président de la Fédération de Russie sur la création du partenariat à but non lucratif « Conseil russe des affaires internationales »]*, Pub. L. No. 59 rp (2010). [http://kremlin.ru/events/president/news/6779](http://kremlin.ru/events/president/news/6779)
⁴ Muhametshina, E. (2014, octobre 16). *Na « Valdae » smenjatsja uchrediteli, povestka i glavnyj smysl \[Valdaï va changer de fondateurs, d’agenda et de signification principale].* *Ведомости.* (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/10/16/na-valdae-smenyatsya-uchrediteli-povestka-i-glavnyj-smysl)
⁵ McGann, J. G. (2020). *2020 Global Go To Think Tank Index Report.* Think Tanks and Civil Societies Program.
⁶ Pallin, C. V., & Oxenstierna, S. (2017). *Russian Think Tanks and Soft Power.* Swedish Defence Research Agency, SE(4451).
⁷ Panov, A., Korjukin, K., & Nikolaeva, A. (2004). *Putin ob »jasnilsja s mirom \[Poutine s’explique avec le monde].* *Vedomosti.* (https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2004/09/08/putin-obyasnilsya-s-mirom)
⁸ Arapova, E., & Lisovolik, J. (2022). *BRIKS+ : Otvet global’nogo juga na novye vyzovy \[BRICS+ : La réponse du Sud mondial aux nouveaux défis]* (118; Valdajskie zapiski). Club Valdaï. [https://ru.valdaiclub.com/files/41948/](https://ru.valdaiclub.com/files/41948/)
⁹ Tipajlov, E. (2023). *Civilizacionnyj podhod k gosudarstvennomu stroitel’stvu \[Approche civilisationnelle de la construction de l’État].* Club Valdaï. (https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/tsivilizatsionnyy-podkhod/)
¹⁰ Popov, V. (2024). *Rossija — Samostojatel’naja evrazijskaja civilizacija \[La Russie est une civilisation eurasienne indépendante].* RIAC. (https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-samostoyatelnaya-evraziyskaya-tsivilizatsiya/)
¹¹ *« Na puti, a ne na pereput’e ? Rossijskoe obshhestvo i gosudarstvo pered licom menjajushhejsja real’nosti » || XXXII Assambleja Sovet po vneshnej i oboronnoj politike \[« En route, pas à la croisée des chemins ? La société et l’État russes face à une réalité changeante » || XXXIIe Assemblée du Conseil de politique étrangère et de défense].* (2024). SVOP.
¹² Karaganov, S. A., Barabanov, O. N., & Bordachev, T. V. (2012). *K velikomu okeanu, ili novaja globalizacija Rossii \[Vers le grand océan, ou la nouvelle mondialisation de la Russie].* Mezhdunarodnyj diskussionnyj klub « Valdaj ». (https://ru.valdaiclub.com/files/22553/)
¹³ Karaganov, S. A., & Larin, V. L. (2014). *K velikomu okeanu – 2, ili rossijskij ryvok k Azii \[Vers le Grand Océan — 2, ou le saut de la Russie vers l’Asie].* Mezhdunarodnyj diskussionnyj klub « Valdaj ». (https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/k3m6g0x94n/147140130.pdf)
¹⁴ Karaganov, S. A., Barabanov, O. N., & Bordachev, T. V. (2015). *K velikomu okeanu — 3, sozdanie Central’noj Evrazii \[Vers le grand océan — 3, création de l’Eurasie centrale].* Mezhdunarodnyj diskussionnyj klub « Valdaj ». (https://ru.valdaiclub.com/files/19625/)
¹⁵ Karaganov, S. A. (2016). *Povorot k Azii : Istorija politicheskoj idei \[Le tournant vers l’Asie : Histoire d’une idée politique].* *Rossija v global’noj politike.* [https://globalaffairs.ru/articles/povorot-k-azii-istoriya-politicheskoj-idei/](https://globalaffairs.ru/articles/povorot-k-azii-istoriya-politicheskoj-idei/)
¹⁶ *Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii \[Doctrine de la politique étrangère de la Fédération de Russie]*, Présidence de la Fédération de Russie (2008). (http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf)
¹⁷ *Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii \[Doctrine de la politique étrangère de la Fédération de Russie]*, Présidence de la Fédération de Russie (2013). (http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf)
¹⁸ *Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii \[Doctrine de la politique étrangère de la Fédération de Russie]*, Présidence de la Fédération de Russie (2016). (http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010045.pdf)
¹⁹ *Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii \[Doctrine de la politique étrangère de la Fédération de Russie]*, Présidence de la Fédération de Russie (2023). (http://kremlin.ru/acts/bank/49090)