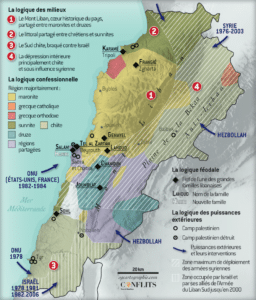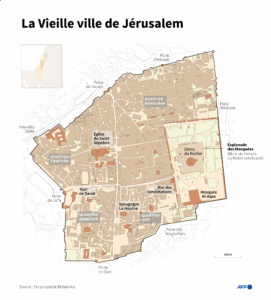En 1981, Ronald Reagan a dû batailler pour vendre des F-35 à l’Arabie saoudite. En 2025, Donald Trump est confronté au même dilemme.
À lire également : Arabie Saoudite – Pakistan, la grande alliance
Il y a quarante ans, presque jour pour jour, Ronald Reagan livrait au Sénat américain l’un des combats les plus âpres de sa présidence : faire passer, contre un Congrès hostile et un lobby pro-israélien à son zénith, la vente de quarante-deux F-15 Eagle à l’Arabie saoudite. Le 21 mai 1986, il sauva son veto par trente-quatre voix contre soixante-six, l’une des victoires les plus étriquées jamais enregistrées sur une grande vente d’armes. Quarante ans plus tard, en novembre 2025, Donald Trump annonce que l’Arabie saoudite recevra des F-35. Le décor a changé, les acteurs ont vieilli, mais le dilemme est identique : jusqu’où les États-Unis peuvent-ils armer un allié arabe sans mettre en péril la supériorité militaire qualitative d’Israël et, au-delà, leur propre contrôle sur la prolifération de technologies sensibles ?
Afin de persuader le Congrès d’accepter la vente de F-15 à l’Arabie saoudite en 1978, l’administration Carter dut proposer un compromis selon lequel le paquet n’inclurait ni supports de bombes ni missiles. Les Saoudiens en conçurent un profond ressentiment. En janvier 1980, Zbigniew Brzezinski aurait indiqué à Riyad que l’administration Carter se montrerait favorable à une nouvelle demande d’armement. Lorsque ces informations parvinrent au Congrès, soixante-huit sénateurs et cent soixante-dix-huit représentants, mobilisés par l’AIPAC exprimèrent leur opposition à toute nouvelle vente d’armes. En année électorale, Carter renonce à la proposition.
Vente d’armes
À son arrivée au pouvoir en janvier 1981, le président Reagan décida de vendre à l’Arabie saoudite les équipements complémentaires retirés du contrat de 1978. Le département d’État expliqua ce revirement par l’évolution du contexte stratégique : l’invasion soviétique de l’Afghanistan, les bouleversements de la révolution iranienne, la guerre Iran-Irak. Dans ce climat, renforcer l’Arabie saoudite et rassurer ses dirigeants éprouvés par la prise d’otage de la Mecque fin 1979 redevenait essentiel.
En février, plusieurs membres du Congrès exprimèrent à Reagan leur inquiétude, certains allant jusqu’à considérer qu’une modification des F-15 saoudiens constituerait une violation directe de l’accord passé avec l’administration Carter. Pourtant, Reagan bénéficiait encore d’un capital politique considérable auprès d’une partie des électeurs juifs américains, déçus par Carter, convaincus par sa politique économique et sensibles à son amitié déclarée envers Israël.
Ainsi, bien que l’opposition à la vente des améliorations du F-15 eût commencé à se manifester, elle demeura relativement modérée. Jusqu’à ce que l’administration décide d’ajouter au contrat les avions-radars AWACS (Airborne Warning and Control System). Cette décision fut prise lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, alors que Reagan se remettait des blessures subies lors d’une tentative d’assassinat. Le général David C. Jones, chef d’état-major interarmées, avait apparemment poussé à cette décision pour des raisons économiques autant que stratégiques : le contrat saoudien permettrait de réduire le coût de production des avions-radars destinés à l’US Air Force.
Quelques jours plus tard, après des fuites dans la presse révélant la nouvelle proposition, plus de cent membres du Congrès prononcèrent des discours s’opposant à la vente, et, selon la presse américaine, seuls vingt sénateurs furent favorables à la vente d’AWACS à l’Arabie saoudite.
Action de l’Arabie
Le débat sur les AWACS fut d’une brutalité inédite. L’enquête de Steven Emerson révéla l’ampleur de la mobilisation saoudienne : lobbying massif auprès des grandes entreprises américaines, pression sur les réseaux économiques dépendant des pétrodollars, usage méthodique de relais politiques comme le prince Bandar bin Sultan, qui opéra quasiment depuis un bureau du Sénat mis à sa disposition. Formé aux États-Unis, fils du ministre saoudien de la Défense et neveu du roi, le prince Bandar ben Sultan avait accès à l’administration Reagan non seulement en tant que diplomate, mais aussi comme partenaire de tennis de George Shultz et adversaire de racquetball du général David Jones. Le même qui a poussé à la vente des AWACS lors de l’absence de Reagan, blessé le 30 mars dans un attentat.
Les opposants, eux, rallièrent cinquante-quatre sénateurs et deux cent vingt-quatre représentants, mais la résolution de désapprobation fut finalement rejetée (52-48). Le président annonça alors que « la paix était de nouveau en marche au Moyen-Orient ». Pour Israël, l’enseignement était double : le président américain disposait encore du dernier mot, mais l’âpreté du combat dissuaderait Washington de tenter trop souvent de nouvelles ventes risquées.
En 1986, l’argument stratégique demeurait limpide. Face à l’Iran et à une Union soviétique armant Bagdad et Damas, il fallait un contrepoids sunnite crédible. Les F-15 saoudiens, même bridés, garantissaient la sécurité du détroit d’Ormuz et la survie des monarchies pétrolières. Reagan accepta le compromis classique consistant à des livraisons échelonnées, équipements sensibles retirés, assurances écrites et compensations à Israël pour maintenir son avantage technologique (Qualitative Edge). Sans oublier la Guerre froide qui imposait sa logique binaire.
À lire également : La mer de lamentation. Israël et la mer rouge

Trois F-35 volant en formation. (C) SIPA
Un contrepoids sunnite
En 2025, la menace n’est plus seulement iranienne, mais aussi chinoise. Les rapports de la Defense Intelligence Agency montrent que Riyad entretient des sites de missiles balistiques construits par Pékin et que des ingénieurs chinois ont accès à certaines bases saoudiennes. Donner le F-35, avion furtif dont les capteurs et le logiciel constituent le cœur de la supériorité technologique américaine, à un royaume qui flirte avec l’adversaire systémique des États-Unis représente un saut qualitatif infiniment plus risqué que celui des F-15 d’antan. Pourtant, Trump balaie les objections : « We’ll be doing that », lance-t-il le 17 novembre devant Mohammed ben Salmane.
Ce qui frappe, c’est la disparition progressive des garde-fous qui avaient permis à Reagan d’emporter la décision sans tout casser. En 1986, le président dut négocier, amender, compenser. En 2025, Trump semble vouloir imposer la vente brute, sans exiger la normalisation avec Israël, exigence qui avait accompagné les F-35 émiratis en 2020, et sans se soucier outre mesure des risques de fuites technologiques. Le Congrès, fracturé, n’a plus la cohésion d’antan. Le lobby pro-israélien, lui, est affaibli structurellement par l’alignement israélien sur les Républicans et surtout Trump. C’est le soutien bi partisan à Israël et la possibilité de travailler avec des démocrates qui était la base de son pouvoir. Quant à Netanyahou, comme Bégin avec les F-15, il est soucieux de préserver l’axe sécuritaire régional, préfère négocier des compensations discrètes plutôt que d’affronter frontalement une Maison-Blanche amicale. Le débat sur la vente d’AWACS et de F-15 « enhanced » à l’Arabie saoudite oblige l’administration à expliciter la règle. Reagan déclare alors que Israël est un « atout stratégique majeur » Les États-Unis doivent garantir sa supériorité militaire qualitative. C’est la première déclaration présidentielle claire. Mais la QME est déjà un instrument de négociation. Pour chaque vente sensible aux Arabes, Israël reçoit des compensations : crédits militaires, équipements supplémentaires, versions plus avancées ainsi que des avantages annexes non importants (comme le droit de vendre des systèmes d’armements avec composant américains). Il s’agit d’un engagement que la Maison-Blanche met en avant lorsqu’elle souhaite promouvoir une vente d’armes à un pays arabe, mais qu’elle n’hésite pas à réinterpréter, voire à remettre en cause, lorsque les circonstances évoluent.
Or ces circonstances ont tendance à changer très souvent. Israël, de son côté, a régulièrement accepté que des alliés arabes disposent d’armements avancés, en échange des certaines compensations. C’est très probablement ce qui se produirait cette fois-ci aussi.
Nous pouvons également constater que, depuis plus de quarante ans l’Arabie saoudite dispose d’un lobby très efficace à Washington et que AIPAC, le lobby israélien, est puissant, mais loin de tirer les ficelles de la politique étrangère américaine. Enfin, entre le gouvernement israélien et l’AIPAC, les intérêts convergent très largement sans toutefois être identiques. Les stratégies propres au bon fonctionnement de l’AIPAC et ses logiques de pouvoir jouent un rôle non négligeable. L’histoire ne se répète peut-être pas, ce que nous ne pouvons pas dire de notre propension à l’oublier.
À lire également : Le F-35, plug in de souveraineté américaine dans la connectique alliée