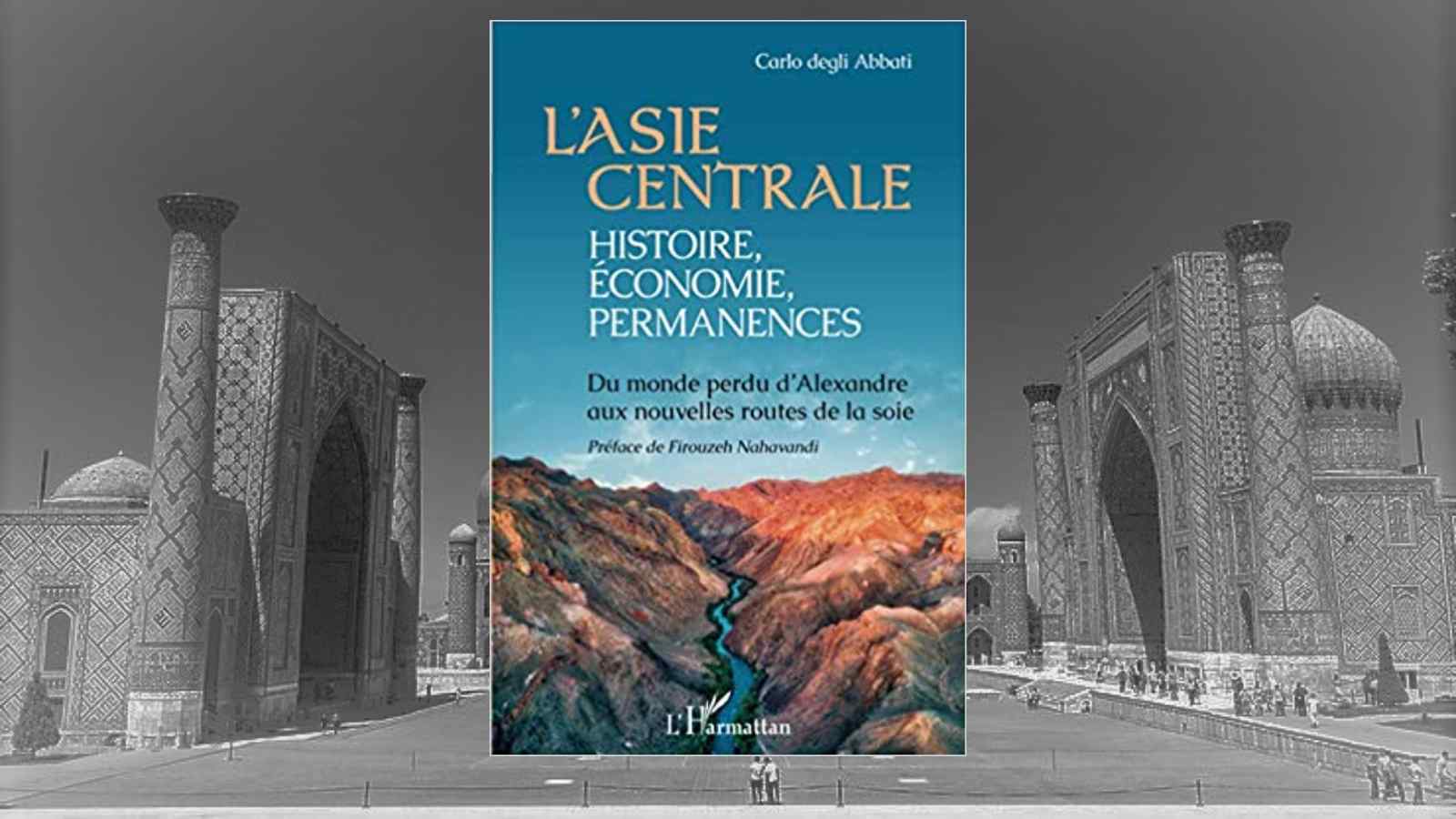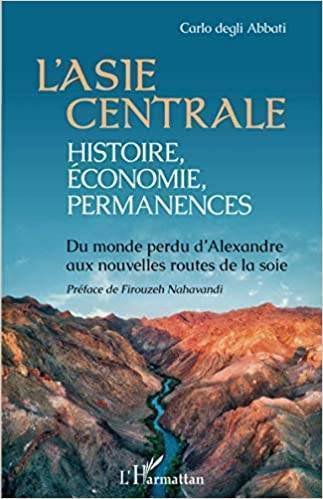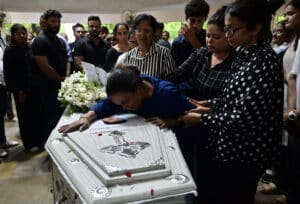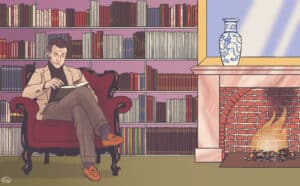Le 21 décembre 1991, à Almaty, capitale en ce temps du Kazakhstan, onze partis communistes signaient une déclaration par laquelle l’Union soviétique disparaissait en tant qu’entité fédérée. Un Empire puissant, multinational, édifié au cours des deux derniers siècles ; acteur important durant la période de guerre froide, se partageait en quinze États indépendants, dont les cinq Républiques musulmanes d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan et Turkménistan) et l’Azerbaïdjan dans le Caucase sur lesquelles porte cet ouvrage.
Au contraire de ce qu’avaient prédit nombre de spécialistes de l’URSS développant l’idée que les contestations et les demandes d’indépendance viendraient du flanc sud et de parties musulmanes, le détachement du Centre avait été moins bien accueilli par les dirigeants de ces contrées qui durent s’y plier bien malgré eux. Ils n’avaient pas été conviée à la rencontre du 8 décembre entre le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine et ses homologues des deux autres républiques slaves d’Ukraine et de Biélorussie, Leonid Kravtchouk et Stanislas Chouchkievitch, qui se réunirent dans une datcha de la forêt » vierge » de Bielovej en Biélorussie, près de Minsk, la capitale biélorusse , dernière réserve naturelle d’Europe pour chasser le sanglier et festoyer. Les trois présidents se résolurent à adopter leur fameuse déclaration : « Nous, Républiques de Belarus, Fédération de Russie, Ukraine, en qualité d’Etats fondateurs de l’URSS, signataires du traité de l’Union de 1922 …constatons que l’URSS a cessé d’exister en tant que sujet de droit international et en tant que réalité géopolitique ». Mais Boris Eltsine, hanté par l’idée d’éviter la rupture totale et l’éloignement et l’isolement de l’Ukraine, avance l’idée d’Union à quatre, avec le Kazakhstan.[1]
De fait, le 7 décembre il s’efforce de convaincre Noursoultan Nazarbaïev, le secrétaire général du PC ukrainien de les rejoindre. Mais celui-ci déjà dans l’avion en partance vers Moscou, n’en fut averti qu’à son arrivée. Il a d’abord dit oui mais ensuite, après avoir parlé avec Gorbatchev s’est ravisé a rapporté Leonid Kravtchouk. L’article 1er de l’Accord que les trois chefs d’Etat signent peu après, précise « Les Hautes parties contractantes fondent le Communauté des Etats indépendants », puis ils indiquent que cette Communauté est ouverte à « tous les Etats membres de l’URSS et d’autres Etats qui partagent les buts et principes de ce traité. » Les trois présidents instituent donc à sa place une Communauté des États indépendants (CEI), officiellement constituée le 21 décembre par 11 des anciennes républiques de l’Union soviétique (à l’exception de la Lituanie, de la Lettonie, de l’Estonie et de la Géorgie). L’article 5, à la demande de Kravtchouk, garantit par ailleurs, l’intégrité territoriale des trois républiques.
Très rapidement, les nouveaux États « indépendants » furent confrontés à de nombreux problèmes qui n’étaient pas sans rappeler ceux bien plus connus et étudiés de pays anciennement colonisés à l’indépendance. Il fallait, entre autres, construire l’État-nation et redéfinir une identité nationale, consolider le développement économique nécessaire pour conforter l’indépendance politique, clarifier les alliances internationales, bâtir une diplomatie nouvelle et mettre sur pied les instruments de la gestion des indépendances. Tous ces États ne partaient pas de conditions favorables. Entre autres, ceux d’Asie centrale faisaient partie des États de l’Union les plus pauvres en termes de revenus (entre 54 % du revenu en pourcentage pour le Tadjikistan et 93 % pour le Kazakhstan). Tous se caractérisaient par un taux élevé de fécondité et de mortalité infantile, un chômage et un sous-emploi comparativement plus élevé que dans le reste de l’URSS. Les essais nucléaires organisés par Moscou dans la steppe kazakhe avaient laissé des niveaux de pollution alarmants. La monoculture du coton promue d’abord par les tsars puis par le Parti communiste avait légué à l’Ouzbékistan des problèmes écologiques importants en asséchant les fleuves. La disparition de la mer d’Aral est un cas unique en son genre. Néanmoins, le potentiel économique de tous ces pays était élevé. Ils étaient riches en matières premières, pétrole au Kazakhstan, gaz au Turkménistan et à un moindre titre en Ouzbékistan, même si fragilisés par l’ancienne division du travail à laquelle ils avaient été soumis on les transformait en entités dépendantes de Moscou.
Ainsi, à l’aube du XXIe siècle, l’évolution future dépendait de la manière où les dirigeants allaient gérer les questions telles que le pluralisme politique, les conflits de classes, les différences ethniques, le partage artificiel des populations, ce que l’on pourrait appeler les legs coloniaux. Cette évolution fut diverse bien évidemment. Aujourd’hui, ces pays sont classés en termes d’indice de développement humain dans la catégorie « élevé » et « moyen ». D’un point de vue de l’étude, l’effondrement de l’URSS a ouvert dans ces parties de nouveaux domaines. Avant la dissolution, il était, par exemple, commun de parler d’Asie centrale englobant dans un ensemble les différents États.
Par ailleurs, les recherches étaient plus orientées par une perspective russe et englobées dans les études soviétiques. Cela pouvait en partie s’expliquer par l’histoire, néanmoins, aujourd’hui ces nouvelles Républiques indépendantes doivent être considérées dans leur singularité et leur dynamique propre et dans les configurations nouvelles qui ont caractérisé la région, en particulier la montée en puissance de la Chine, qui est devenue à peu près partout leur premier partenaire commercial et y déploie ses Routes de la Soie. S’ils offrent maints traits communs ces pays présentent des traits spécifiques. Trois sont riverains de la mer Caspienne et se disputent les grandes richesses du bassin en hydrocarbures : Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan. Trois sont frontaliers du Xinjiang chinois, une des régions les plus complexes et instables de l’Empire du Milieu : Tadjikistan, Kirghizistan et à nouveau le Kazakhstan. Un seul, l’Ouzbékistan, d’ailleurs le plus peuplé, ne confine ni avec la Caspienne ni avec le Xinjiang. L’Asie centrale dépend donc de l’évolution future du marché des hydrocarbures, mais aussi de celle de la situation interne et internationale du grand voisin chinois. Dans les six Républiques, vit globalement une population très jeune de 75 millions d’habitants, avec une moyenne d’âge de 22,4 à 30,7 ans selon les pays.
A lire aussi : L’économie de la Russie et des pays de l’ex-URSS
Les questions abordées dans ce livre toucheront tous ceux qui s’intéressent au processus de décolonisation et de développement, car chacune des républiques indépendantes a dû gérer cette décolonisation. Quoi qu’il en soit, depuis 1991, les études sur l’Asie centrale et l’Azerbaïdjan se sont diversifiées et multipliées. Cet ouvrage de synthèse en donne une approche d’ensemble riche et diversifiée, résultat qu’il est de multiples interventions de son auteur, le professeur Carlo Degli Abbati dans le cadre des conférences bimensuelles organisées par le Centre d’études de la coopération internationale et du développement (CECID) de l’Université libre de Bruxelles qui portent sur « Les mondes musulmans en transition ».
Ces interventions ont suscité un enthousiasme considérable auprès du public, touché par l’érudition et les connaissances de l’orateur et sa capacité à multiplier les éclairages. Carlo Degli Abbati, professeur de relations internationales, a une expérience sans grand équivalent. Il a sillonné la région, y a travaillé et a eu la possibilité d’observer et d’étudier l’évolution de chaque pays tout en ayant une vision comparative. Son expérience sur le développement à la Cour des comptes européenne lui a en outre permis une vision pratique et institutionnelle des questions actuelles.
Tous ces éléments qui ont fait la richesse des présentations, auxquels il faut ajouter les demandes du public, ont donné naissance à cet ouvrage qui ambitionne de donner des repères de compréhension à des ensembles complexes et des pistes de réponses aux questions que traversent les Républiques musulmanes de l’ex-Union soviétique.
[1] Cf l’étude juridique complète de Roman Yakemtchouk La Communauté des Etats indépendants AFDI, 1995, pp. 245 – 280.