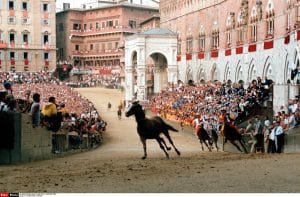Ne soyez pas honteux si le nom de Brunanburh ne vous dit rien : dans le pays même où elle fut livrée, cette bataille comme son emplacement furent longtemps oubliés. Signe de son insignifiance ? Bien au contraire ! Son importance était telle que tout le monde l’appelait « la grande bataille », comme les contemporains disaient « la Grande Guerre » pour parler de la Première Guerre mondiale, sachant qu’elle ne pouvait être confondue avec aucune autre. De son issue émergea en effet une des futures puissances majeures de l’histoire mondiale : l’Angleterre.
Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?
L’histoire médiévale des îles Britanniques est jalonnée de nombreuses batailles « décisives » : Hastings (1066), Bannockburn (1314) ou Bosworth (1485) ont déjà fait l’objet de chroniques dans Conflits, d’autres sont un peu plus confidentielles (Stirling, Towton) ; mais toutes avaient largement éclipsé cette « mère des batailles » que fut Brunanburh, que le xxie siècle a cependant remis en lumière pour deux raisons : d’une part, après un méticuleux travail de recherche littéraire et archéologique, le lieu de la bataille, sombré dans l’oubli, a pu être identifié par le professeur Michael Livingstone ; d’autre part, cette période si méconnue du haut Moyen Âge a suscité un nouvel intérêt avec le succès de la série The Last Kingdom, diffusée sur la BBC entre 2015 et 2022.
The Last Kingdom
À la fin du ixe siècle, la Grande-Bretagne est divisée en plusieurs royaumes rivaux. Trois sont dirigés par des dynasties issues des envahisseurs germaniques christianisés (les Angles et les Saxons) arrivés à partir du ve siècle : le Wessex au sud, la Mercie au centre et la Northumbrie au nord. Une partie des populations celtes ont quitté la Bretagne vers le continent, mais d’autres ont fusionné, bon gré mal gré, avec les Anglo-Saxons, ou ont formé des États dans les régions périphériques (Écosse, Irlande, Pays de Galles ou Cornouailles). Au ixe siècle, de nouveaux venus se taillent un domaine couvrant tout l’est de l’Angleterre actuelle : les Danois. Leur territoire, aux frontières fluctuantes, est appelé Danelaw et intègre la majeure partie du littoral de la mer du Nord jusqu’à l’estuaire de la Tamise. Ce territoire ne forme pas toujours un ensemble politique homogène : ses pôles géographiques et historiques sont l’ancien royaume saxon d’East-Anglie, au sud, la région des Cinq Bourgs, conquise aux dépens de la Mercie, au centre, et le royaume d’York, au nord, arraché à la Northumbrie et qui atteint au début du xe siècle la mer d’Irlande à l’Ouest.
Suscitant l’hostilité de leurs voisins, les principautés danoises sont aussi en butte aux nouvelles vagues de raids scandinaves : au début du xe siècle, les Norvégiens établis en Irlande depuis près d’un siècle mettent la main sur le royaume d’York. Mais l’adversaire le plus redoutable est le royaume de Wessex, dirigé par Alfred le Grand, qui grignote les possessions danoises et s’efforce de faire l’unité des royaumes chrétiens, notamment en mariant sa fille Ethelfleda au roi de Mercie. Malade, ce dernier laisse sa femme exercer le pouvoir à partir de 902, avant qu’elle ne devienne à sa mort, en 911, la dame de Mercie – une reine sans le titre.
L’œuvre unificatrice d’Alfred est amplifiée par son fils, Édouard l’Ancien, qui règne de 899 à 924 et achève la conquête du Danelaw, tout en intégrant la Mercie sous son autorité après la mort de sa sœur en 918, aux dépens de sa nièce Aelfwynn. Édouard vassalise aussi les trois ou quatre royaumes gallois et semble avoir maté une série de révoltes à la fin de son règne. À sa mort, il est possible que ses deux fils se soient disputé sa succession, mais la mort d’Aelfweard, peu après celle de son père, laisse le champ libre à son demi-frère aîné, Aethelstan. D’abord intronisé en Mercie, ce dernier rallie les nobles du Wessex et achève d’unifier l’Angleterre en conquérant le royaume d’York en 927.
« Une bataille fondatrice mais oubliée »
La grande alliance
En 934, pour des raisons mal éclaircies, Aethelstan mène un raid en Écosse et contraint le roi Constantin II à le reconnaître comme suzerain. Au début de ces années 930, le roi du Wessex signe ses actes du titre de roi de toute la Bretagne et utilise même la titulature impériale byzantine. Sa puissance ascendante contraste avec les agressions extérieures (Normands, Hongrois voire Sarrasins) et les querelles intestines qui affaiblissent les Carolingiens sur le continent. Mais ses prétentions hégémoniques finissent par liguer contre lui ses ennemis subjugués.
L’initiative vient du roi de Dublin, Olaf Gothfrithson, qui a succédé à son père en 934 et consacré trois ans à éliminer ses rivaux. Une fois solidement assis sur le trône, il projette de récupérer le royaume d’York, perdu par son père, et contacte pour ce faire Constantin d’Écosse, qui supporte mal sa vassalisation, et Owain de Strathclyde, un autre roi écossais d’ascendance celtique, dont les terres occupent la région resserrée située entre le Firth of Forth et le Firth of Clyde, à la frontière de la Northumbrie. L’union de ces princes, qui s’étaient régulièrement combattus jusqu’ici, pour des questions de territoires ou de religion, était suffisamment improbable pour qu’Aethelstan en fût surpris, comme les chroniques le soulignent. Surprise encore accrue par le moment de l’attaque : la bataille fut en effet livrée au cœur de l’automne, sans doute au mois d’octobre, bien après la meilleure saison pour la guerre.
Ultime facteur déroutant : les coalisés arrivèrent par la mer. Ayant rassemblé une immense flotte – les sources parlent de plus de 600 navires –, ils se donnent rendez-vous en un point qui a pu être identifié comme la péninsule de Wirral, à l’ouest de l’Angleterre, à la jonction avec le pays de Galles. Cette pointe extrême de la Mercie de l’époque, constituant la rive occidentale de l’estuaire de la Mersey et ouvrant sur la mer d’Irlande à la hauteur de la moderne Liverpool, offrait un mouillage suffisant pour la flotte alliée et permettait de s’enfoncer rapidement vers le cœur du royaume d’Aethelstan grâce à une voie romaine, préservée depuis près d’un millénaire. C’est cette même voie romaine qu’Aethelstan suivit avec son armée pour venir barrer la route des envahisseurs qui avaient commencé à ravager les alentours.
L’importance de la rencontre explique que l’on dispose de sources relativement abondantes à son sujet. Par exemple, une source contemporaine, la Chronique anglo-saxonne, qui se limite d’ordinaire à des mentions lapidaires des événements, expose la bataille sous la forme d’un long poème de 73 vers qui occupe l’intégralité de l’année 937. Pour autant, même en recoupant avec d’autres récits, il est difficile d’avoir beaucoup de détails sur la façon dont la bataille s’est déroulée, d’autant que les quelques précisions apportées pourraient relever du topos littéraire, se retrouvant dans des récits d’autres combats, d’autant plus stéréotypés que les narrateurs en furent rarement les témoins. Nous en sommes donc réduits aux conjectures, à partir des caractéristiques des armées du temps et des pratiques guerrières les plus communes. C’est aussi ce qui explique que le lieu exact du combat se soit perdu pendant tant de siècles.
Des murs de boucliers
Où eut lieu exactement la bataille ? Les assaillants étant les premiers sur place, ils ont eu le choix du terrain et se sont probablement installés en position dominante, près d’une levée de terrain où se trouvait alors l’embryon du village de Storeton, d’où la voie romaine plongeait de 10 à 20 mètres en direction de la plaine. Il existe à l’est du Wirral, pile au sud de Liverpool, une ville nommée Bromborough, qui pourrait tirer son nom de la bataille, mais le théâtre de l’affrontement était probablement 3 km plus à l’ouest, entre deux lieu-dit, Storeton Hall et Brimstage Hall, là où passe aujourd’hui l’autoroute M53 – ce qui ne facilite pas les recherches archéologiques.
Quel scénario est le plus probable ? Les deux armées étaient sans doute de force équivalente. À partir des 5 à 600 navires des coalisés, on arrive à une troupe n’excédant pas 10 000 combattants, ce qui était sans doute aussi le potentiel qu’avait pu réunir Aethelstan, pressé par l’urgence. La grande masse est constituée de fantassins, diversement équipés selon leur rang et leur fortune. La tactique est sûrement assez sommaire : les armées se disposent face à face, sur une seule ligne, et s’avancent l’une vers l’autre en constituant un mur de boucliers grâce au recouvrement, aussi précis que possible – ce qui n’est pas simple avec des écus principalement ronds, mais pouvant aussi bien avoir des formes ovales ou rectangulaires – des boucliers de la première, voire de la deuxième ligne de combattants. Des fantassins légers, équipés d’armes de trait (arcs, javelots), harcèlent la ligne d’en face depuis les flancs ou l’arrière du dispositif. Une fois les deux lignes au contact, le combat se résume à deux poussées contradictoires, comme dans le combat entre phalanges grecques, tandis que les combattants des premiers rangs tentent d’atteindre leurs ennemis avec leur lance ou leur épieu, voire leur épée quand l’arme d’hast est rompue ou perdue. Les combattants blessés tiennent aussi longtemps qu’ils peuvent supporter la douleur, ou sont remplacés par des hommes frais venant des rangs arrière.
Quelques récits, pas forcément applicables à Brunanburh, évoquent des ruses de guerre : un repli simulé pour aspirer l’ennemi dans une position où il se retrouve bloqué, puis l’intervention d’un contingent tenu en réserve, éventuellement à cheval – la cavalerie est peu nombreuse dans les armées britanniques ou viking, et limitée au commandement et à ses gardes du corps – pour le tourner et l’attaquer par-derrière. C’est ce scénario qui est retenu dans la reconstitution de Brunanburh que propose le film Sept rois doivent mourir, mais c’est plus pour mettre en valeur l’inventivité du héros et ajouter un ressort dramatique à l’intrigue que par souci de vérité historique, car cette dernière nous oblige à avouer notre ignorance totale. Ce qui est sûr, c’est que, dans les combats de ce type, lorsqu’une brèche s’ouvrait dans une des lignes, le mur de boucliers se fragmentait, les combattants, ne se sentant plus couvert sur leurs flancs ou leur arrière, paniquaient et commençaient à s’enfuir. C’est ce qui se produit à Brunanburh, au bénéfice des Anglais, qui pourchassent alors les fuyards jusqu’à leurs vaisseaux, occasionnant « le plus grand massacre » jamais vu jusqu’alors en terre anglaise, selon les termes de la Chronique anglo-saxonne.
Le nombre de victimes s’élève sans aucun doute à plusieurs milliers d’hommes ; quelles furent les plus prestigieuses ? Les chroniques parlent encore d’Olaf et de Constantin après 937, ce qui montre qu’ils ont survécu, contrairement à Owain qui disparaît sans être nominativement désigné parmi les cinq « rois » et nombreux « princes » tombés en ce jour, dont le propre fils de Constantin. La mort d’Aethelstan, dès 939, redonnera de l’espoir à ses ennemis, puisque Olaf pourra s’emparer de la Northumbrie, mais le rétablissement de l’unité anglaise sera assuré dès le milieu du xe siècle. Brunanburh n’a donc pas le caractère décisif d’une fondation, mais celui d’un avenir qui se ferme, car si Aethelstan avait été vaincu, ses terres démembrées auraient sans doute été plus difficiles à réunifier.