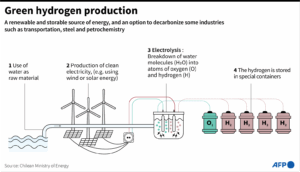Buenos Aires est de loin la plus grande ville d’Argentine, la deuxième d’Amérique du Sud après Sao Paulo. L’agglomération (Gran Buenos Aires), en pleine croissance, a 15 millions d’habitants (plus du tiers de la population nationale, alors que la ville elle-même avec 2,9 millions ne varie plus depuis 70 ans).
La ville a longtemps été tournée vers l’Europe, du fait de ses origines, de son peuplement, de son commerce, de ses mœurs et de ses modes (« la Paris del Sur »). Avant la conquête de la Pampa et de la Patagonie, elle tournait le dos à son hinterland, faiblement peuplé de « barbares » amérindiens (« el desierto »), où se multipliaient les vaches et les chevaux sauvages laissés par les premiers colons espagnols. Elle était à l’époque coloniale le port d’entrée des marchandises ibériques et des esclaves noirs amenés d’Afrique, et celui de l’exportation vers la métropole de l’or et de l’argent du Pérou. Ce dernier métal précieux a donné son nom à l’Argentine et au Rio de la Plata, l’estuaire sur lequel la ville est située, sur un terrain plat et marécageux de la rive ouest, aussi large qu’une mer, mais rendu jaunâtre par les alluvions du Parana et de l’Uruguay qui se déversent ensemble dans l’Atlantique.
La ville est d’abord un port, ouvert sur l’Atlantique et l’Europe. Le rivage du Rio de la Plata a reculé pour étendre la ville, le port a été déplacé plusieurs fois, mais il reste lié à la cité. Les anciens docks et les abattoirs ont été reconvertis en logements et lieux de loisirs et de culture « branchés ».
Elle a été dominée par une élite commerçante moins intéressée par le développement de l’espace intérieur (Pampa et Patagonie) que par la liberté des échanges maritimes (en particulier avec l’Angleterre), le revenu des douanes et la contrebande. À la fin du xixe, cette élite marchande a été concurrencée par les propriétaires terriens (agriculture et élevage), qui grâce au frigorifique vont se tourner vers l’exportation.
Une ville européenne
Paradoxalement, elle fut fondée la première fois par la mer (Pedro de Mendoza en 1530) et ce fut un échec du fait des assauts des tribus indiennes anthropophages. Mais elle a gardé son nom de Buenos Aires (Notre-Dame des vents favorables, protectrice des marins). La deuxième fois (en 1586), ce fut par l’intérieur, par une expédition venue d’Asuncion (au Paraguay). Il en est resté un fort, qui devint la résidence des gouverneurs, des vice-rois espagnols, puis des gouvernements argentins, avant d’être démoli pour construire la Casa Rosada, résidence du Président de l’Argentine depuis 1898.
Buenos Aires est depuis 1880 capitale de l’Argentine et district fédéral, détaché de la province du même nom (les habitants de la ville sont les Portenos, ceux de la province les Bonaerenses). En 1996, elle est devenue une ville autonome, avec sa législature et son chef de gouvernement (comme le fut Macri, l’actuel président du pays). Elle a eu, tout au long de son histoire, des relations compliquées avec sa province et avec le reste du pays, du fait de sa situation, de sa population, de ses intérêts et de ses ambitions. En 1986 le président Alfonsin a voulu mettre en œuvre un vieux « serpent de mer », le projet de transfert de la capitale aux limites de la Patagonie (« vers le sud, vers la mer, vers le froid »), afin de séparer le pouvoir politique du poids économique (Buenos Aires fournit 40 % du PIB national) et culturel écrasant de Buenos Aires. Le « Proyecto Patagonia » a été abandonné en 2009.
Buenos Aires avait 45 000 habitants à l’indépendance, en 1810. Aujourd’hui 13 % des habitants de la ville sont nés à l’étranger, 40 % hors de l’agglomération. L’immigration a toujours été encouragée (y compris par la constitution), principalement depuis l’Europe, et au temps de l’esclavage depuis l’Afrique aussi. Mais la grande ville est restée européenne par son peuplement, plus qu’aucune autre en Amérique. Des estimations donnent en 2017 89 % de Blancs, 7 % de métis, 2 % d’Asiatiques (Syro-Libanais), 2 % de Noirs.
Les Espagnols (Basques et Galiciens entre autres) et les Portugais ont constitué le noyau de la colonisation, mais l’immigration ibérique a continué et s’est même accélérée jusqu’au xxe siècle. Les Italiens surtout (aussi bien du nord, comme les parents du pape François, que du sud), arrivés en masse du milieu du xixe siècle au milieu du xxe (ils représentent 60 % des immigrants pendant cette période), ont marqué l’architecture (les maisons génoises du vieux port de La Boca), la langue (lunfardo, argot local), les idées politiques (mazzinisme, anarchisme, fascisme), l’opéra et le bel canto. Il y a sur la Plaza Italia un monument à Garibaldi. Les Juifs de Pologne et de Russie, fuyant les pogroms et la misère, ont introduit le socialisme et la psychanalyse (Buenos Aires est sans doute la ville au monde avec le plus fort taux de psychologues et de psychanalystes). Deux attentats en 1992 et 1994 (le plus meurtrier, 85 morts) ont frappé l’ambassade d’Israël et le siège de la communauté juive.
La particularité de Buenos Aires est que les Noirs issus de la traite ont beaucoup diminué dans la population de la ville au xixe, à cause de l’immigration européenne massive qui a absorbé par le métissage les minorités de couleur, mais aussi des pertes militaires dans les guerres du xixe où les Noirs étaient très mobilisés dans l’armée. Il y avait 30 % d’« Afroportenos » au début du xixe et environ 2 % aujourd’hui. Ils étaient vendeurs de rue, lavandières, pêcheurs, marins, y compris dans la marine de guerre. Ils ont laissé leur marque dans les fêtes, la musique et la danse, et des mots dans la langue locale.
À partir des années 1930, l’exode rural a renforcé l’élément indien venu des provinces du nord-ouest, et récemment des pays voisins (Paraguay, Bolivie, Pérou). Il a formé une bonne part de la base populaire du péronisme. Les Amérindiens restent toutefois une petite minorité dans la ville. En 2013, le gouvernement a décidé d’enlever la statue de Christophe Colomb située derrière la Casa Rosada pour y mettre celle d’une métisse originaire de Bolivie qui avait combattu pour l’indépendance, suscitant la colère des hispanophiles et des Italiens de la ville qui l’avaient offerte, riches et pauvres, en 1921. Elle gît en morceaux sur la place en attendant d’être mise au bord du Rio de la Plata, derrière un héliport.
Buenos Aires a accueilli aux xix-xxe siècles beaucoup de réfugiés politiques, des révolutionnaires français, italiens et allemands, des juifs fuyant les pogroms ou la misère, des antifascistes, des républicains espagnols et, sous les militaires et Perón, des réfugiés nazis (Eichmann et Mengele), oustachi (le gouvernement croate en exil de Pavelic), des collaborateurs français, qui ont contribué à leur façon à l’effervescence intellectuelle et au scandale politique dans la ville.
La ville a sa spécificité, latina, avec le mythe du gaucho, le caudillisme, et le tango (danse des Noirs à l’origine, des bas-fonds ensuite, elle n’est devenue un produit culturel acceptable par les « gens décents » qu’après avoir triomphé à Paris), la viande grillée, et son ambiance.
A lire aussi : Argentine : retour du péronisme sur fonds de crise économique
Coups d’État et révoltes
Buenos Aires et l’Argentine ont une forte tradition de coups d’État militaires et de mouvements populistes, les militaires fournissant souvent eux-mêmes les caudillos populistes (Rosas de 1832 à 1852, qui s’appuyait sur les Noirs, Yrigoyen au début du xxe, Perón de 1945 à 1955) sur le thème : prendre le pouvoir à l’oligarchie pour le rendre au peuple. Au cœur de la ville, la Casa Rosada et la Plaza de Mayo ont été maintes fois assaillies et bombardées par l’armée ou l’aviation, ou occupées par les foules, catholiques ou anticléricales, démocrates, péronistes ou d’extrême gauche.
Vu d’Europe, le spectre politique argentin est insolite. Le péronisme domine la vie politique du pays depuis 70 ans. Il a instauré une semi-dictature élue démocratiquement, renversée deux fois (en 1955 et 1976) par un coup d’État militaire. Il est difficile à classer du fait de ses emprunts au nationalisme, au syndicalisme socialiste ou révolutionnaire et au fascisme italien, de la mobilisation des prolétaires de la périphérie, des dialogues du chef charismatique et de son épouse avec le peuple, de l’intervention de l’État, de la coopération des classes, de la redistribution des richesses, de l’anti-impérialisme économique, et aussi à cause de ses divisions, avant et surtout après la mort du chef, en tendances de gauche et de droite (parfois extrême). Le camp des antipéronistes (issus de la classe moyenne et supérieure, comme la famille de « Che » Guevara), va de l’extrême droite à l’extrême gauche (militaires, radicaux, socialistes, communistes, catholiques nationalistes, démo-chrétiens, laïcs, francs-maçons, antifascistes). Les présidents Nestor et Cristina Kirchner représentaient la tendance de gauche du péronisme. Ils ont annulé le processus de réconciliation nationale « Point final » de leurs prédécesseurs, rouvert les procès et obtenu la condamnation de nombreux acteurs de la dictature militaire pour « crimes contre l’humanité »).
Les « lieux de mémoire »
La toponymie de la ville réunit les adversaires d’hier, vice-rois et rebelles, royalistes fidèles à l’Espagne et héros de l’indépendance, fédéralistes et unitaires, radicaux et péronistes, du moins jusqu’en 1976. Des rues, des cités, des institutions portent encore le nom de Juan et d’Eva Perón, mais le projet d’Autel de la Patrie qui leur était destiné n’a pas eu de suite.
En revanche, les « lieux de mémoire » pour les victimes de la dictature militaire et du « terrorisme d’État » se sont multipliés dans la ville. Le « Processus de réorganisation nationale » (la dictature du général Videla et de ses pairs de 1976 à 1983), qui a mis fin par un coup d’État à la présidence de la deuxième épouse de Perón mort en 1974, répondait au départ à l’inquiétude d’une majorité de l’opinion en raison de la crise économique, de l’impuissance du gouvernement de la présidente Isabel Perón, et du chaos politique suscité par les groupes armés d’extrême gauche. Des militaires, des policiers et des civils (syndicalistes, patrons, intellectuels) et un ancien président, sont enlevés, assassinés ou tués dans des attentats par l’extrême gauche (800 victimes). Arrivées au pouvoir, les forces armées et la police enlèvent, fusillent à leur domicile, au Campo de Mayo à 30 km de la ville et dans les centres clandestins de détention (parfois par des « vols de la mort » au-dessus de la mer) des terroristes ou présumés tels, ou des adversaires du pouvoir militaire. « Les Mères de la Place de Mai », qui depuis 1977 sont devenues célèbres par leur manège silencieux hebdomadaire face à la Casa Rosada pour exiger l’aveu et la punition de ces enlèvements et de ces exécutions, avancent le chiffre symbolique de 30 000 disparus. Une enquête officielle l’estime à 8 961. Leur action a été relayée par les ONG et les médias internationaux. Le chanteur Sting est venu les soutenir en concert, après la chute des militaires. Leur organisation politique a maintenant une radio et une « université » reconnue par l’État.
Depuis le rétablissement de la démocratie en 1983, alors que les militaires sont dans les casernes et que le péronisme est éclaté ou dénaturé (le Parti Justicialiste kirchnerien s’est rapproché de l’Internationale socialiste dont fait partie son concurrent, l’Union Civique Radicale), la vie politique à Buenos Aires a été caractérisée, en dehors des élections (qui tendent maintenant à une alternance entre le centre-gauche et le centre-droit), par des manifestations de rue soutenues par les organisations politiques et professionnelles (les « caceroladas » ou concerts de casseroles) contre la politique économique et sociale, ou la corruption, et par la politique mémorielle.
Encore une façon pour la ville de se montrer européenne.