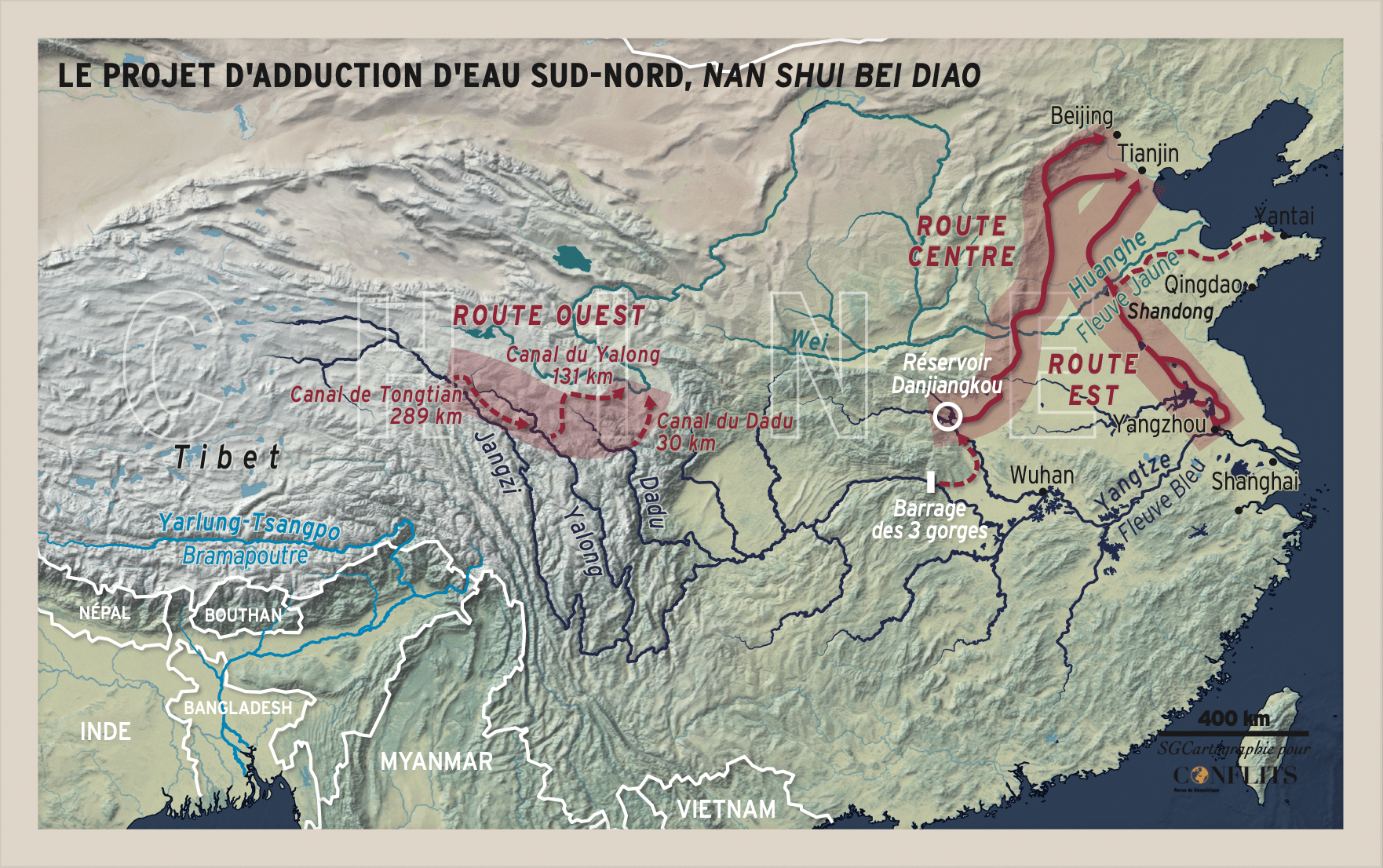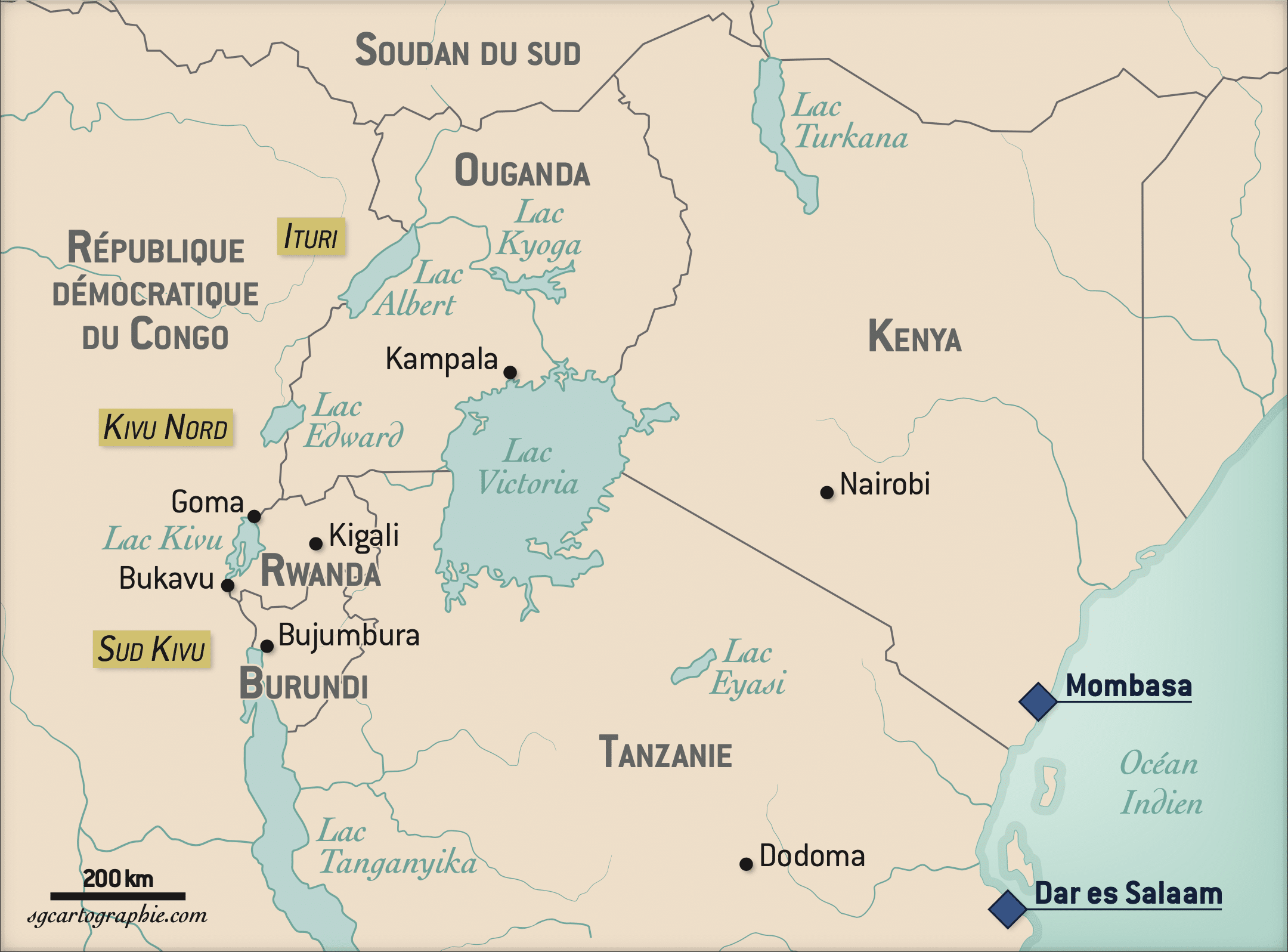Les richesses minières espagnoles : voilà un élément que l’on oublie souvent de mentionner lorsque l’on aborde le sujet de l’économie ibérique. Si le pays détient un sous-sol aussi riche que diversifié, la volonté étatique peine à déterminer une véritable politique d’extraction des minerais, ce qui pourrait profiter à une économie en quête de redressement.
L’abondance de minerais dans le sous-sol espagnol est un fait bien connu depuis l’Antiquité. Les Romains exploitaient déjà du cuivre en pleine Sierra Morena, en Andalousie, avant que ne leur succède une longue période d’abandon. C’est avec l’explosion industrielle du xixe siècle que les entrepreneurs européens redécouvrent ces ressources et se mettent à les extraire pour leur propre profit. C’est l’âge d’or de la Compagnie royale asturienne des Mines belges (fondée en 1853), de la firme Río Tinto (créée par les Anglais dans le Sud de la péninsule Ibérique en 1873), de l’Orcanera Iron Company britannique (1874) ou encore de la Société franco-belge des Mines de Somorrostro et La Peñarroya (1876), qui profitent de lois très libérales mises en place par le gouvernement espagnol entre 1839 et 1868. Jusqu’aux années 1960, la balance commerciale de notre voisin ibérique en matière minière reste ainsi excédentaire [simple_tooltip content=’Huetz de Lemps, L’économie de l’Espagne, Paris : Masson, 1989, page 206.’](1)[/simple_tooltip].
L’Andalousie fait, dans ce contexte, partie des régions les plus privilégiées outre-Pyrénées [simple_tooltip content=’Klein, Nicolas, « L’économie andalouse, mine d’or mal exploitée », Conflits, 27 novembre 2019.’](2)[/simple_tooltip]. Par ailleurs, le fer a longtemps été exploité au Pays basque, en Cantabrie, dans le León ou le sud de l’Aragon [simple_tooltip content=’Huetz de Lemps, op. cit., page 207.’](3)[/simple_tooltip] ; le cuivre, du côté de Huelva (Andalousie) ainsi qu’à Bilbao (Pays basque) et Palencia (Castille-et-León) ; le plomb, dans la Sierra Morena et à Carthagène (région de Murcie) [simple_tooltip content=’Id.‘](4)[/simple_tooltip] ; le zinc, dans les Asturies ; l’aluminium, en Galice et en Aragon ; le mercure, près d’Almadén (Castille-La Manche), etc. Et encore ne mentionnons-nous pas ici les minéraux à la base du ciment et de la faïence, deux productions traditionnelles de l’Espagne.
A lire aussi: Les défis de l’eau : l’Espagne face à la pénurie et au trop-plein
La pétrochimie, fer de lance de l’économie espagnole
Les Espagnols pourraient ainsi dire, pastichant les Français : « On n’a pas de pétrole, [simple_tooltip content=’Le pays en importe la quasi-totalité depuis l’étranger (González Navarro, Javier, « España importó de Venezuela un 65% menos de petróleo en 2016 », ABC, 20 mars 2017).’](5)[/simple_tooltip] mais on a des minerais ». Bien que le pays n’ait que très peu de réserves prouvées en hydrocarbures dans son sous-sol [simple_tooltip content=’García, Beatriz, « Adiós al último pozo de petróleo: cuando un pueblo de Burgos estuvo a punto de convertirse en el «Oklahoma español» », Libre Mercado, 11 novembre 2018.’](6)[/simple_tooltip], il mise depuis longtemps sur le raffinage du pétrole (domaine dans lequel il suppose, avec l’Allemagne et l’Italie, plus de 35 % des capacités européennes [simple_tooltip content=’« Alemania, Italia y España son los que más contribuyen a la capacidad de refinación en Europa », Revista petroquímica, 29 août 2018.’](7)[/simple_tooltip]) et la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) [simple_tooltip content=’« Terminal de GNL, El Musel, Gijón, España », Sacyr Fluor.’](8)[/simple_tooltip]. En matière d’extraction, stockage, transport et transformation des énergies fossiles, l’Espagne est ainsi devenue un référent international, qui vend ses technologies aussi bien dans les pays importateurs (comme l’Allemagne [simple_tooltip content=’Ugalde, Ruth, « La ingeniería española seduce a Alemania: casi pleno en su primera planta de GNL », El Confidencial, 4 octobre 2019.’](9)[/simple_tooltip]) qu’exportateurs (à l’instar de la Russie [simple_tooltip content=’Murga, Ainhoa, « Repsol afianza los lazos con Rusia y tantea el desarrollo de nuevos proyectos exploratorios », El Confidencial, 26 août 2019.’](10)[/simple_tooltip], de l’Iran [simple_tooltip content=’Ayestaran, Mikel, « Tubos españoles para el petróleo de Irán », ABC, 29 mai 2017.’](11)[/simple_tooltip] et du Canada [simple_tooltip content=’Mesones, Javier, « Técnicas Reunidas gana dos contratos en Indonesia y Canadá », El Economista, 12 novembre 2019.’](12)[/simple_tooltip]).
En raison de ce savoir-faire et de sa situation stratégique, notre voisin pyrénéen cherche désormais à réexporter massivement le gaz naturel qui transite par son territoire, notamment depuis l’Algérie, avec un succès mitigé jusqu’à présent [simple_tooltip content=’« El gasoducto que pretende conectar España y Francia podría ser una mala idea », El Economista, 19 avril 2018.’](13)[/simple_tooltip]. Il réfléchit également de plus en plus à l’utilisation de GNL à la place des carburants classiques [simple_tooltip content=’Manso Chicote, Carlos, « El gas natural sale de boxes y se perfila como una alternativa atractiva a la gasolina », ABC, 15 mars 2018 ; et Esteller, Rubén, « Renfe probará el lunes el primer tren propulsado con gas licuado », El Economista, 5 janvier 2018.’](14)[/simple_tooltip].
A lire aussi: Ralentissement économique de l’Espagne – Entre facteurs internes et tensions géopolitiques
Tout ce qui est rare est cher…
Mais la vraie richesse minérale de l’Espagne se trouve peut-être ailleurs. Le lithium et l’uranium sont très convoités en Galice, en Castille-et-León et en Estrémadure [simple_tooltip content=’« Berkeley encuentra oro, litio y cobalto en la mina de uranio de Salamanca y se dispara en Bolsa », El Economista, 23 janvier 2019 ; et López, Pablo, « La fiebre del litio: ilusión y alarma en el gran filón del noroeste peninsular », El Confidencial, 13 mai 2019.’](15)[/simple_tooltip]. Et plus encore, ce sont les terres rares, aujourd’hui essentiellement extraites et commercialisées par la Chine, qui attirent les regards.
Les îles Canaries sont, dans ce domaine, très bien placées et pourraient même devenir le premier producteur européen d’ici à quelques décennies [simple_tooltip content=’« Casi 2 millones de toneladas del nuevo «oro tecnológico», sin salir de Gran Canaria », El Diario, 22 juillet 2019 ; et « España también alberga las preciadas tierras raras, la baza china para presionar a EEUU », El Economista, 27 mai 2019.’](16)[/simple_tooltip]. L’archipel abrite également, au large de ses côtes, dans les profondeurs sous-marines, des nodules polymétalliques situés dans la zone économique exclusive espagnole [simple_tooltip content=’Miranda, Isabel, « España blinda su mar a los cazadores de «oro tecnológico» », ABC, 19 août 2018.’](17)[/simple_tooltip]. De quoi aiguiser l’appétit du Maroc, pays limitrophe, qui conteste à l’Espagne la souveraineté sur la région [simple_tooltip content=’Gutiérrez, Javier Alonso, « Marruecos le echa un pulso a España delimitando a Canarias como aguas marroquíes en busca del «tesoro» del Atlántico », ABC, 18 décembre 2019.’](18)[/simple_tooltip].
A lire aussi: Madrid fait le choix de la liberté économique
De l’État-stratège à l’État impuissant ?
Si l’Espagne a été capable, au cours du xxe siècle, de tirer parti de ces richesses souterraines en tant qu’État-stratège, pourquoi ne le pourrait-elle pas aujourd’hui ? Pourquoi ne le fait-elle pas plus massivement ? Les raisons sont au moins de deux ordres.
Le premier concerne les moyens financiers à mettre en œuvre – et cette tâche s’avère d’autant plus difficile en période de crise et de restriction budgétaire. Mais plus fondamentalement encore, notre voisin ibérique semble refuser purement et simplement d’extraire les minerais de son sous-sol. Ce sont avant tout des considérations politiques et écologiques qui sont en jeu, dans une nation très sensible aux problématiques environnementales et dirigée par un État apparemment impuissant.
C’est ainsi que l’on peut comprendre l’annulation de tous les programmes de prospection et d’extraction de pétrole et de gaz en péninsule Ibérique et dans les archipels espagnols [simple_tooltip content=’Caballero, Daniel, « Ni petróleo ni gas: España desprecia su riqueza oculta », ABC, 23 septembre 2019.’](19)[/simple_tooltip], l’interdiction stricte d’emploi de la méthode de fracturation hydraulique (ce qui a freiné tout projet lié aux hydrocarbures non conventionnels) et les entraves aux entreprises désireuses d’exploiter certains minerais comme l’uranium [simple_tooltip content=’« La mina de uranio que divide a España y Portugal », ABC, 24 février 2018.’](20)[/simple_tooltip].
Ces préoccupations écologiques sont à la fois louables et justifiées, mais s’accompagnent souvent d’une impréparation crasse de la part des autorités publiques. Ces dernières sont par exemple engagées dans un processus de fermeture totale des mines de charbon d’Espagne… mais leur décision entraîne en parallèle une augmentation drastique des importations de houille pour alimenter les centrales thermiques qui subsistent.
En abandonnant la possible exploitation de ses ressources souterraines, notre voisin ibérique fait donc plusieurs paris risqués, dont celui des énergies renouvelables. Ces dernières exigeront des investissements gigantesques dans les prochaines décennies et, même si les perspectives semblent alléchantes, rien ne garantit qu’elles deviendront réalité.