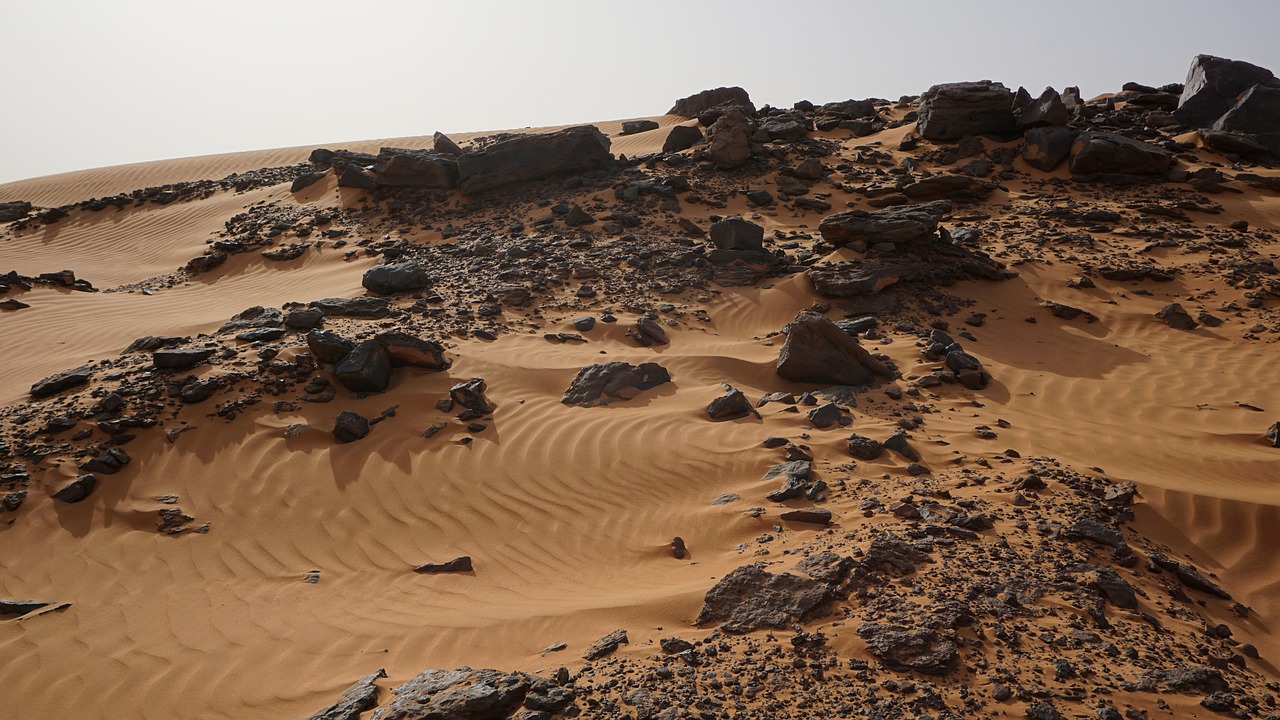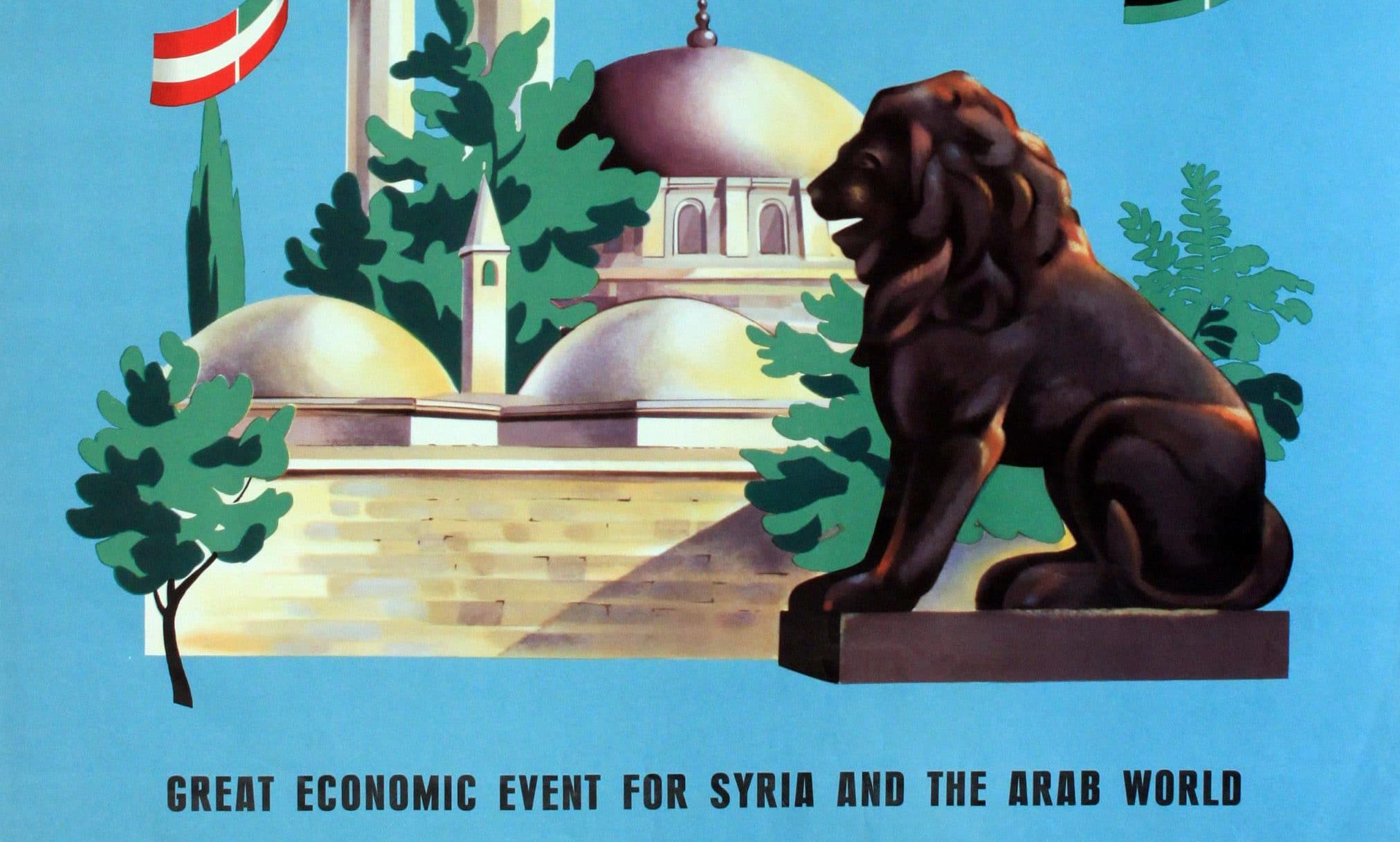Voilà un nom méconnu en France, mais qui évoque pour les Britanniques toute la splendeur de la « plus grande des races gouvernantes » célébrée par Joseph Chamberlain, alors ministre des Colonies, et tout l’éclat de l’Empire victorien. Il n’y eut pourtant rien d’éclatant dans ce combat déséquilibré qui vit plutôt s’évanouir ce qu’il restait de romantisme dans les exploits guerriers, même si le monde n’en prendra pleinement conscience que deux décennies plus tard.
Le contexte n’est pas sans rappeler la situation géopolitique actuelle. Au début des années 1880, Mohamed Ahmed ibn Abd-Allah s’autoproclame le « Mahdi » et soulève le Soudan contre l’Égypte, qui est sa suzeraine théorique et qui est en train de passer sous la coupe du Royaume-Uni. Le Mahdi est une figure prophétique de l’islam, une sorte de réincarnation du Prophète, annoncée par un hadith (1) comme précurseur du retour de Jésus (ou Issa) à la fin des temps.
La première « guerre au djihadisme »
L’armée égyptienne, même aidée par des officiers et du matériel britanniques, est balayée par les troupes mahdistes – improprement appelés « derviches » – qui combattent sous l’étendard noir attribué à Mohamed et aux Abbassides ; elle doit évacuer le Soudan. Ce retrait est symbolisé par la perte de Khartoum, la capitale, défendue par le général Charles Gordon, le chef légendaire de l’« Armée toujours victorieuse » en Chine. Fin janvier 1885, après plus de dix mois de siège, Khartoum tombe et Gordon est tué. Le Soudan s’organise alors comme une théocratie fondamentaliste – la Mahdiyya –, appliquant strictement la charia, modifiant la chahada (2) pour intégrer le Mahdi et remplaçant le hajj à La Mecque par le djihad (au sens de participation à la guerre sainte) ou par un pèlerinage à Omdurman, la capitale de l’État mahdiste située face à Khartoum sur la rive gauche du Nil blanc où s’élève le tombeau du Mahdi.
Mohamed Ahmed a en effet succombé cinq mois après Gordon, a priori du typhus. Malgré des dissensions entre ses lieutenants, Abdallahi ibn Muhammad lui succède avec le titre de Khalifa et tente de s’étendre vers l’Égypte ou l’Éthiopie – le grand royaume chrétien de l’Est africain. En 1887, le Khalifa invite même Victoria à venir à Omdurman pour se soumettre et se convertir à l’islam ! Sous sa direction, du fait des massacres, guerres et catastrophes « naturelles » (famine, épidémies…), le Soudan aurait perdu 7 de ses 9 millions d’habitants de 1885. Le Royaume-Uni finit par décider de soutenir la reconquête du Soudan et envoie Lord Kitchener qui débarque en Égypte en mars 1896.
Kitchener n’est pas le prototype du guerrier flamboyant, c’est plutôt un logisticien. Il planifie méticuleusement l’avance de ses 11 000 hommes en remontant la vallée du Nil, appuyé par une flottille de transports et 10 canonnières. Pour couper la boucle du fleuve entre la première cataracte et Abu Hamed, il construit une voie ferrée en plein désert, prolongée le long du fleuve jusqu’à Atbara, où il remporte un premier engagement en avril 1898. Il poursuit ensuite en direction d’Omdurman, où l’attend le Khalifa à la tête de l’Ansar (3) (voir carte).
A lire aussi : Le Soudan peut-il se relever ?
La dernière charge de la cavalerie anglaise
La rencontre dans la plaine de Kerreri, à 11 km au nord d’Omdurman, entre la colonne Kitchener, désormais forte de 26 000 soldats (dont 8 000 Britanniques), et l’armée djihadiste, qui en compte au moins le double, n’est pas vraiment une bataille « napoléonienne ». Les troupes britanniques ne portent plus les éclatantes tuniques rouges de Waterloo : elles sont désormais en kaki. Elles ne se déploient pas face à l’ennemi mais restent dans un premier temps abritées derrière un enclos aménagé, dos au fleuve – une hérésie tactique en Europe, mais ici un moyen sûr d’empêcher l’encerclement par un ennemi numériquement supérieur et de bénéficier de l’appui des canonnières fluviales. Pour stopper la charge de l’ennemi, dont seule une minorité est équipée d’armes modernes, les Britanniques comptent sur la puissance de feu d’une cinquantaine de canons, mais aussi sur les mitrailleuses Maxim alignées pour la première fois en grand nombre. L’infanterie anglaise est enfin armée de balles à ogive expansive (dum-dum), qui ne seront interdites par la convention de La Haye que l’année suivante. Les effets sont dévastateurs : l’armée mahdiste perd la moitié de ses effectifs, dont environ 10 000 tués.
Les seuls épisodes évoquant le « grand style » des manœuvres à l’ancienne résultent d’erreurs d’appréciation : le premier assaut repoussé, Kitchener s’avança trop confiant vers Omdurman mais s’exposa au retour offensif de l’Ansar ; Mac Donald, chef de son arrière-garde surprise en ordre de marche, donc en colonne, réussit alors un déploiement en ligne, sauvant l’armée par la maîtrise de ses troupes et par sa puissance de feu.
L’autre anomalie romantique fut la charge du 21e Lanciers croyant balayer un groupe de tirailleurs mais soudain confronté à une division disposée sur plusieurs lignes. Ce fut la dernière charge de la cavalerie anglaise à cheval et… à la lance ! Y participait un lieutenant de 23 ans, également correspondant de guerre : Winston Churchill.
Des leçons oubliées ?
À part cet épisode, il n’y eut nul combat au corps à corps dans cette demi-journée : commencée à 6 heures, la bataille était terminée avant midi. Foudroyés à distance, les mahdistes n’infligèrent que des pertes minimes aux Anglo-Égyptiens : moins de 50 tués. Les débris de l’Ansar seront finalement anéantis à Um Diwaykarat le 24 novembre 1899. Quant à Kitchener, continuant vers l’amont du Nil, il parvint le 18 septembre à Fachoda, où il trouva un fort surmonté d’un drapeau français : la mission Marchand, partie du Congo à l’été 1896, était arrivée deux mois avant et avait également affronté un contingent mahdiste. La France espérait en effet profiter des difficultés du Royaume-Uni au Soudan, ou de celles de l’Italie en Éthiopie (défaite d’Adoua en 1896), pour renforcer sa présence dans la région, qui se limitait alors à la zone de Djibouti.
L’Angleterre ne l’entendit pas ainsi. Si, sur le terrain, les relations restèrent courtoises entre Marchand et Kitchener, les opinions européennes s’enflammèrent pour la « crise de Fachoda » qui s’étira sur deux bons mois. Marchand finit par se retirer, et l’Égypte britannique conserva le contrôle du Nil blanc jusqu’au lac Victoria.
Quant aux leçons tactiques, elles furent en partie biaisées par le prisme colonial : on voulut croire que la puissance de feu serait encore plus dévastatrice dans l’offensive que dans la défensive. La désillusion sera totale à l’été 1914, où l’Europe vit encore des unités charger à cheval… y compris contre des avions !
- Un hadith est une parole attribuée au Prophète et éclairant le comportement social ou l’interprétation du Coran.
- L’équivalent du credo musulman, le résumé de la foi de l’islam.
- Nom que se donnaient les Mahdistes, repris du nom des premiers compagnons de Mohamed qui l’accompagnèrent à Médine.