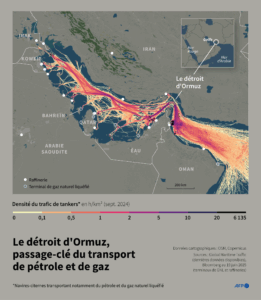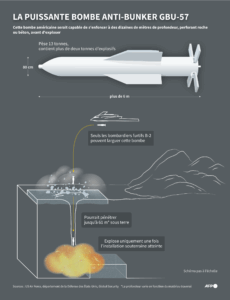À cause de ses nombreux reports, eux-mêmes dus à l’incompétence spectaculaire du gouvernement de Theresa May, le Brexit aura finalement été acté quelques jours seulement après le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Cette coïncidence est parlante. Il ne s’agit pas de faire une plaisanterie de mauvais goût sur une nation captive qui se libérerait de ses bourreaux bruxellois, mais, en tout sérieux, d’attirer l’attention sur le fait que, plus l’histoire de la guerre de 1939-1945 recule dans le temps, plus longues sont les ombres qu’elle jette sur notre présent. Le Brexit n’est compréhensible qu’à la lumière de ce qui s’est passé entre 1939 et 1945.
Pendant les deux premières années de la guerre, le Royaume-Uni était seul. Son allié français avait capitulé, ses futurs alliés soviétique et américain n’étaient pas encore entrés en guerre. Pour faire face à cette situation hautement dangereuse, surtout en 1940 après la bataille de France et pendant la bataille d’Angleterre, les Britanniques, sous le leadership de leur Premier ministre providentiel, ont puisé dans les sources profondes du patriotisme et du récit national. Certains discours de Churchill, notamment celui du 18 juin 1940 – jour pour jour le 125e anniversaire de la bataille de Waterloo ! – sont dignes de Shakespeare et s’inspirent de lui :
« Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France est terminé. La bataille d’Angleterre est sur le point de commencer. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. Notre existence britannique en dépend, ainsi que la longue continuité de nos institutions et de notre Empire. Toute la fureur, toute la puissance de l’ennemi va bientôt se déchaîner contre nous. Hitler sait qu’il devra nous briser sur cette île ou qu’il perdra la guerre. Si nous parvenons à lui résister, toute l’Europe pourra être libre, et la vie du monde progresser vers de hautes et vastes terres baignées de soleil. Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abîmes d’un nouvel âge des ténèbres rendu encore plus sinistre, et peut-être plus durable, par les lumières d’une science pervertie. Aussi, préparons-nous à accomplir notre devoir et à nous conduire de telle sorte que, si l’Empire britannique et son Commonwealth durent mille ans, les hommes diront encore : “Ce fut leur plus belle heure. »
On croit entendre Jean de Gand dans Richard II. C’est grâce à ce sursaut national que la honte de l’appeasement de 1938 a pu être lavée. Et c’est grâce à ce récit que le Royaume-Uni est resté unique en Europe après la guerre. En effet, son patriotisme et son identité nationale sont sortis intacts et même renforcés de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les autres pays européens ayant vécu la défaite ou la collaboration ou les deux, leur identité nationale a été profondément abîmée par le conflit. Dans le cas de l’Allemagne, elle a été presque aussi complètement réduite à l’état de ruines que ses villes.
A lire aussi: Grande-Bretagne : La surprise BoJo
Une identité bruxelloise, mais pas européenne
Voilà la raison pour laquelle les Britanniques ne se sont jamais sentis à l’aise au sein des institutions bruxelloises, faussement appelées « européennes » justement pour fournir une identité factice de rechange aux pays désormais dépourvus d’une vraie identité nationale. Pire, l’expérience amère de ces autres pays les a conduits à un double dédain de la démocratie : méfiance du peuple à cause de l’idéologie de masse du nazisme et du fascisme, méfiance du parlementarisme à cause de la débâcle des « pleins pouvoirs » en France. Certes, le général de Gaulle a tenté de remettre les pendules à l’heure, mais il faut bien constater avec tristesse que le gaullisme (et non pas le vichysme) n’aura été qu’une parenthèse vite refermée à partir de 1969, justement parce que la nation française avait été divisée en deux pendant la guerre. Sous de Gaulle, on ne souvenait que de la victoire ; après de Gaulle, on ne se souvient plus que de la défaite.
Cette méfiance de la démocratie, qui est aussi une méfiance à l’égard de l’État-nation, fut institutionnalisée par les premières communautés européennes. Quand Robert Schuman prononça sa fameuse déclaration – quatre jours seulement après l’entrée en vigueur du Conseil de l’Europe inter-gouvernemental et justement pour saboter celui-ci en créant, sans les Britanniques antifédéralistes, une structure supra et donc antinationale –, la seule institution qu’il proposa fut la « Haute Autorité », prédécesseur de la Commission. L’Assemblée parlementaire et la Cour de justice ne furent rajoutées qu’après coup. Difficile d’imaginer une illustration plus parfaite de cette volonté de dépolitiser la gouvernance européenne, c’est-à-dire de la dénationaliser et de la dédémocratiser, pour la remplacer par un managérisme digne des technocrates de Vichy, comme si toute l’Europe pouvait être gouvernée par une espèce de commissariat général du plan. D’ailleurs, le terme de « communauté », inventé par Schuman pour la nouvelle structure, qui n’est ni chèvre ni choux d’un point de vue constitutionnel, mais qui n’est surtout pas un État, sort directement de l’École d’Uriage [simple_tooltip content=’École nationale des cadres de la jeunesse d’Uriage, fondée en 1940 pour former les cadres du régime vichyste. Elle fut fermée en 1943.’](1)[/simple_tooltip].
Ce managérisme est donc dans l’ADN de l’Union européenne d’aujourd’hui, où la Commission continue à dominer le continent entier. À peine nommée, la nouvelle présidente de la Commission européenne a annoncé devant le mal-nommé « Parlement européen » que « notre union tout entière s’engagera dans un processus de transformation qui affectera toutes les composantes de notre société et de notre économie ». Mais de quel droit parle-t-elle ainsi d’une transformation totale de la société et de l’économie européennes ? Son « pacte vert » qui coûtera un trillion d’euros ne figura nulle part dans aucun programme électoral et, comme tous les commissaires européens, Mme Von der Leyen n’est pas élue. C’est une aberration grotesque pour un continent qui prêche la démocratie à la planète tout entière.
Pourquoi les Anglais ont choisi le Brexit
Nous avons donc affaire à des courants de très long terme. Mais il y a un autre cycle, plus court celui-ci, qui explique aussi pourquoi le Brexit a été plébiscité deux fois, en 2016 et aux législatives de décembre 2019. Le sursaut thatchérien des années 1980 n’est certes pas aussi historique que le sursaut churchillien de 1940, mais le fait est que le Royaume-Uni est depuis quarante ans sur une pente économique montante, alors que la France, qui au même moment fit le choix de l’Europe (avec le revirement de François Mitterrand de 1983, l’année de la réélection triomphale de Mme Thatcher, pour un deuxième mandat), entame depuis plus d’une génération la voie du déclin. Le fruit de ce saignement à blanc sur l’autel de l’européisme se voit partout dans les campagnes françaises dévastées et dans ses banlieues à l’abandon, alors que les campagnes anglaises regorgent de prospérité et le taux d’emploi au Royaume-Uni bat tous les records.
A lire aussi: Brexit, boulet fiscal et occasion manquée
La continuité du vieux lion
Boris Johnson n’a fait que répéter une troisième fois ce sursaut d’un optimisme vigoureux qui l’emporte sur un défaitisme lugubre. Les antonymes Chamberlain-Churchill et travaillisme-thatchérisme se réincarnent dans la victoire de Johnson sur Theresa May. Et chacun de ces trois sursauts a eu lieu à la Chambre des communes, creuset indispensable de la politique nationale britannique et donc le pivot de son histoire. Les pro-Européens sur le continent ont ricané pendant les trois années de l’administration May agonisante, voyant dans les luttes parlementaires à mort menées par les partisans du maintien la preuve que le Brexit conduisait le pays droit dans le mur. C’est précisément là qu’ils commettaient une erreur capitale de perspective. Drogués depuis des décennies par la suffisance technocratique, selon laquelle les règlements autoritaires d’une bureaucratie protègeraient leurs pays du désordre des « vaines paroles » dénoncées par Schuman le 9 mai 1950, allusion à peine voilée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les pro-Européens sont mentalement incapables de comprendre que le drame parlementaire britannique révélait le cœur battant d’une nation qui se bat et qui touche le fond justement pour mieux rebondir à partir de bases saines.
C’est donc la peur qui a été vaincue au Royaume-Uni ; cette peur qui continue, hélas, à tétaniser les Français comme leurs voisins européens. « L’Europe qui protège » est le slogan somnifère d’Emmanuel Macron, au lieu d’un quelconque « La France qui se bat », « qui se redresse » ou « qui relève les défis ». Longtemps, et notamment dans les décennies de la décolonisation, quand les Britanniques ont vécu une chute géopolitique plus brutale encore que celle de l’Espagne au début du xixe siècle, le « Projet peur » a remporté un succès indéniable outre-Manche. Il fut dénoncé en vain par les opposants à l’adhésion au Marché commun déjà dans les années 1970. Le « Projet peur » a refait surface en 2016, où il s’est ridiculisé en prophétisant un collapse économique en cas d’une victoire du Brexit. Boris Johnson fait campagne précisément sur le message évangélique – n’ayez pas peur – depuis au moins 2014, deux ans avant le référendum. C’est la clé de tout. Tant que les autres Européens ne se seront pas libérés de cette peur, héritage direct de 1940, ils en resteront longtemps les prisonniers.