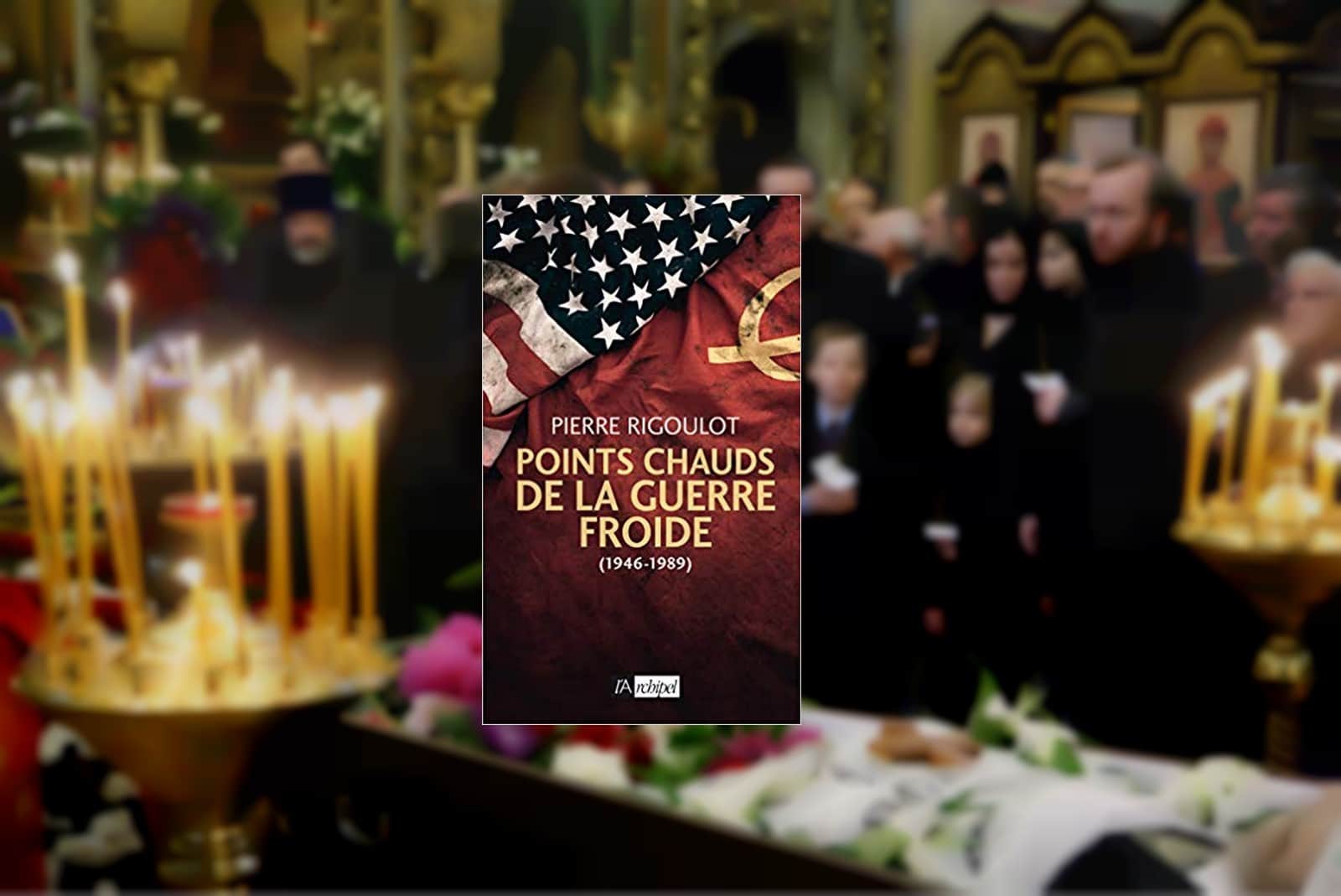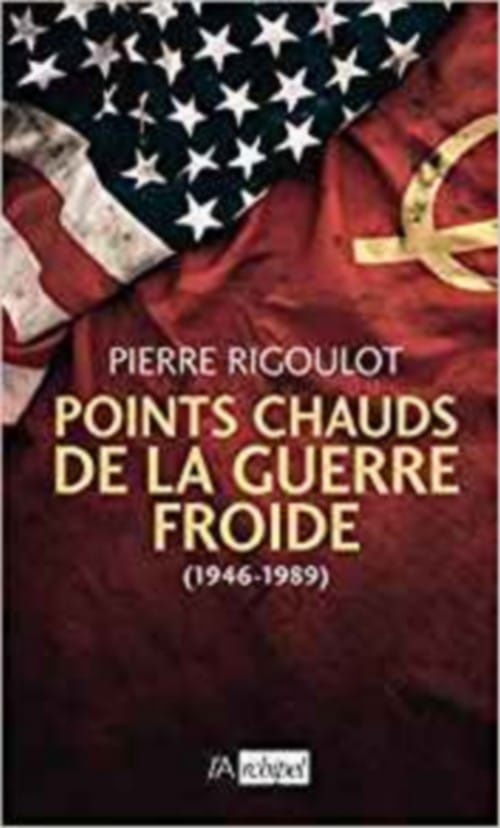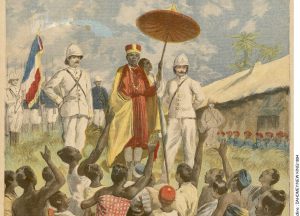Dater le début de la guerre froide, terme forgé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par George Orwell que le journaliste américain Walter Lippmann popularisa, est une question qui n’a jamais été réglée. Est-ce le 2 septembre 1945, lors de la capitulation du Japon ? Le 12 mars 1947, date du fameux message d’Harry Truman au Congrès annonçant l’aide américaine à la Grèce et la Turquie pour s’opposer à la menace communiste ? Ou doit-on la faire commencer au discours de Winston Churchill sur le rideau de fer, prononcé en mars 1946 à Fulton ?
Après des études de philosophie à la Sorbonne et une carrière d’enseignant, Pierre Rigoulot a intégré l’Institut d’histoire sociale, dont il est devenu directeur en 2016. Il a écrit divers essais liés au communisme : Des Français au goulag (Fayard, 1984), Le Siècle des camps (Lattès, 2000), Les Aquariums de Pyongyang (Laffont, 2000), Pour en finir avec la Corée du Nord (Buchet-Chastel, 2012). Il dirige la revue Histoire & Liberté. Dans cet ouvrage, il a choisi de raconter et d’analyser 25 « points chauds » de la guerre froide. Vingt-cinq, c’est loin d’être exhaustif, mais faute de place, il a dû privilégier les plus importants qui se situent entre 1946/1947 et 1989. Durant ces quelque quarante-deux ans, ce long affrontement de part et d’autre du « rideau de fer » a fait des millions de victimes.
A lire aussi: La Guerre froide de la France, 1941-1990, de Georges-Henri Soutou
Car cette guerre froide, qui devint parfois chaude à son acmé entre 1947 et 1953 puis pendant quatre courtes décennies, s’est traduite par une lutte sans merci, parfois sanglante, pour l’existence d’un monde libre face à des États totalitaires qui aspiraient à triompher sur l’ensemble du globe. Guerres de Corée (1950-1953), d’Indochine (1946-1954) et du Viêtnam (1965-1975), écrasement des révoltes de Berlin-Est (17 juin 1953), Budapest (octobre 1956) et Prague (21 août 1968), chasse aux sorcières du maccarthysme et crise des missiles à Cuba (octobre 1962), déportations en masse au Goulag et massacre de Tian’anmen du 4 juin 1989… Autant de jalons significatifs. L’Afrique, par exemple, qui est devenue, depuis le milieu des années 1975, un des théâtres d’affrontements de la guerre froide, n’y apparaît qu’une seule fois à travers l’opération Carlotta, au cours de laquelle Cuba intervînt en Angola pour aider le MPLA à prendre le pouvoir à Luanda. Ce parcours à travers les grandes étapes de ce vaste affrontement idéologique, stratégique, militaire, économique et culturel, ne se borne pas seulement à en décrire ces points nodaux, mais présente les ouvrages des dissidents Kravtchenko ou Soljenitsyne, des acteurs qui ont ébranlé la forteresse ou les débats qui ont déchiré les intellectuels occidentaux. Aux côtés de Staline, l’oncle « Joe », apparaissent les figures « mythiques » de Mao, Hô Chi Minh, Kim Il-sung et Castro. Mais aussi les figures des héroïques opposants du totalitarisme.
Pierre Rigoulot, Points chauds de la guerre froide (1945-1989), L’Archipel, 2019, 360 pages.