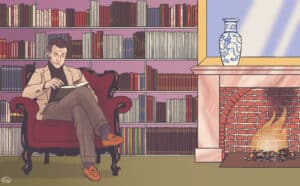Les réseaux sociaux font beaucoup parler d’eux. Jusqu’au sommet de l’État, non sans côté polémique, et tout en proclamant les dangers qu’ils recèlent, notamment lorsqu’ils seraient parfois manipulés par des puissances étrangères. Ils font pourtant désormais partie de notre quotidien, quoi qu’on en dise, et il n’est pas évident de vouloir les combattre sans au passage faire courir des risques en matière de liberté d’expression.
Par John Rivalland
Ce qui n’empêche pas, en dehors de ces questions politiques, de porter des analyses sur les mécanismes à l’œuvre en matière de diffusion d’images et d’opinions. Ce que propose ce petit ouvrage de Paul Brémond pour tenter de mieux comprendre l’un des phénomènes marquants de notre époque.
Paul Brémond, L’attaque qui a enflammé les réseaux, Éditions Brémond, juin 2025, 151 pages.
À lire également : Madagascar : le rôle clé des réseaux sociaux dans la chute du pouvoir
Les réseaux sociaux, entre liberté d’expression et excès irrationnels
Alors que nombreux sont ceux qui ont perdu confiance en la validité de l’information délivrée par les médias traditionnels, ou tout au moins qui ne la prennent plus autant pour argent comptant que ce fut le cas jadis, il n’est pas une mauvaise chose en soi que d’autres moyens d’échanges et de discussions aient pu venir offrir une alternative à ces médias ou, mieux encore, compléter l’éventail des sources de diffusion à disposition.
Cela n’empêche évidemment pas de déplorer les excès liés à ces supports de communication, comme on pouvait déplorer l’excès de caractère monolithique des supports précédents du temps où n’existait qu’une faible concurrence en la matière.
C’est dans ce cadre que le petit ouvrage de Paul Brémond intitulé « L’attaque qui a enflammé les réseaux » se propose d’analyser la propagation époustouflante à laquelle donnent lieu des informations la plupart du temps à caractère sensationnel et qui déchaînent les passions. Au détriment très souvent de la rationalité et de la nuance.
Viralité, absence d’esprit critique, diffusion à la vitesse de l’éclair d’une image ou d’une phrase parfois sortis de tout contexte donnant lieu à de multiples interprétations – voire appropriations – différentes, tels sont les signes de notre époque, à l’ère du numérique et alors que les réseaux sociaux ont le vent en poupe, prisé par une grande partie de la population qui en fait un usage quotidien, souvent de manière démesurée.
Prenant appui sur l’exemple de l’une de ces nouvelles sensationnelles circulant abondamment, Paul Brémond en décrit les effets pervers, ainsi que les ressorts fondamentaux. Pour mieux chercher à en tirer des enseignements utiles afin de tenter de les contenir, sans aller jusqu’à proposer de les interdire ou de les réguler de manière autoritaire.
Le Règne de l’émotion et de l’indignation
Il n’est pas rare, en effet, que les réseaux sociaux servent de véhicule à toutes sortes d’images, de vidéos, de messages, d’idées, ou d’informations ayant en commun de captiver l’attention, de verser dans le sensationnel, de déclencher une course à l’audience pour collectionner le plus grand nombre de vues pour le plaisir de ceux qui les diffusent ou rediffusent.
Avec tous les effets pervers que l’on connaît bien, reposant – sans les généraliser- sur nos instincts parfois un peu primaires et nos tendances voyeuristes les plus élémentaires.
Le problème mis en avant par l’auteur est avant tout celui de la simplification de ce qui peut en réalité être complexe. Les types d’images, de messages ou d’informations massivement diffusés font la plupart du temps appel à nos réactions instinctives, émotionnelles (émotions généralement collectives), sans prise de recul suffisante.
Nous vivons à l’époque des grandes peurs, ainsi que l’analyse Alexis Rostand dans son ouvrage « Au-delà de la catastrophe ». Irons-nous jusqu’à nous faire peur à nous-mêmes jusqu’à la déraison ou sommes-nous toujours capables, en définitive, de savoir faire la part des choses entre ce qui relève de la profondeur ou au contraire de ce qui va plutôt dans le sens de la superficialité ? Et qu’en dire avec l’arrivée de l’IA, capable désormais de remplacer l’homme pour créer et diffuser de l’information dans certains cas créée de toutes pièces par la machine ?
Face à l’image ou à la nouvelle qui fait sensation, qui crée l’indignation, qui nous mène tout droit à l’analyse de surface empreinte de superficialité, quel comportement adoptons-nous pour la plupart d’entre-nous ? Très souvent, celui de l’absence de recul critique et de questionnement rationnel.
La propagation se fait de manière vertigineuse, ainsi que Paul Brémond l’illustre à travers son exemple tout simple et tout à fait classique aujourd’hui, propulsée par la force des algorithmes, et les réactions éphémères, non construites, sans véritables arguments ou en tous les cas trop sommaires pour pouvoir revêtir une valeur irréprochable.
À lire également : Réseaux sociaux, conflits mondiaux

Manifestation du mouvement « Bloquons tout », Paris, septembre 2025.
Absence de nuance et biais multiples
L’absence de nuance, contrairement à l’argumentation écrite et construite, nous conduit au subjectivisme et à l’art de cultiver notre ignorance, tout en nous donnant l’illusion d’être dans la pensée, là où nous nous trouvons plutôt dans la sphère des convictions irrationnelles.
Emportés par le tourbillon de l’information, de sa vitesse de propagation et de la tyrannie de l’immédiat, nous en oublions tous nos principes élémentaires au sujet de l’objectivité dont nous aimerions pourtant pour la plupart faire preuve, jouant au contraire volontiers le rôle de relais et, par suite d’amplificateur, au sein de ce mouvement en forme de signal collectif, sorte de caisse de résonance comme la qualifiait Vladimir Volkoff quand il étudiait déjà en son temps les mécanismes de la désinformation.
À rebours de notre propre volonté, nous nous forgeons un peu vite, sans même toujours en prendre conscience, des convictions immédiates, renforçant nos biais cognitifs et allant malgré nous dans le sens de toutes les récupérations qui peuvent en être faites…
« Plus tard, lorsque le temps de la réflexion et de la vérification arrive enfin, il est souvent trop tard : l’image initiale s’est profondément ancrée dans la mémoire collective »
Fondus dans cette civilisation du loisir, mû par la recherche de la reconnaissance virtuelle, mais aussi par la peur de se trouver exclu ou marginalisé si on ne s’aligne pas sur l’opinion dominante, nous sommes touchés par le classique phénomène de contagion, à l’instar de ce que développait déjà Gustave Le Bon dans la « Psychologie des foules ».
S’enchaîne alors une succession de biais, tel celui de validation, suscité par le besoin d’appartenance. Les algorithmes prennent le relais, nos fils d’actualité se trouvant ensuite orientés vers ce type de sujets aux contenus similaires et au caractère sensationnel.
S’y additionne un phénomène tout aussi classique d’altérations du message ou de l’image au fur et à mesure de sa diffusion, renforçant encore l’impact émotionnel.
Le biais de perception est le plus emblématique de ce qui se produit sur les réseaux sociaux. Il consiste en la confirmation de ses croyances à travers les informations reçues, et au rejet de celles qui viennent les contredire.
S’y ajoutent également le biais de disponibilité, le biais d’ancrage, celui de conformité sociale, ou encore celui de représentativité. Nous avons ainsi tendance à accorder plus de poids aux informations sensationnelles qu’aux autres et la première image s’ancre plus facilement que tous les arguments ou éléments contraires qui pourront arriver après. Avec toujours ici la force des algorithmes, qui appuient sur tous les biais.
L’ancrage communautaire
Une même vidéo peut conduire à une interprétation radicalement opposée selon le réseau fréquenté et sa stratégie éditoriale, en raison du phénomène de perception sélective, fondée sur des croyances préexistantes.
Si ces contenus permettent de contrecarrer le récit dominant, souvent unique, des médias traditionnels, montre l’auteur, et revêtent ainsi une dimension démocratique, à travers une multiplicité de perspectives, il n’en demeure pas moins que l’ancrage communautaire que cela induit aggrave les fractures sociales et politiques préexistantes. Chaque communauté a alors peine à comprendre ou à connaître la validité des récits alternatifs. D’autant plus que chacun reste cantonné à sa propre sphère d’influence. Ne permettant pas de développer la conscience critique.
Le doute, la nuance, la confrontation des idées ont tendance à reculer, au profit du repli communautaire et au détriment de la complexité du réel.
Il en ressort une vision étroite et simplifiée de la réalité et un manque de remise en cause des croyances collectives. D’autant que vient jouer le phénomène des bulles cognitives.
Au sein de certaines communautés, heureusement, peuvent toutefois se développer des échanges plus nourris, susceptibles de venir alimenter l’esprit critique et d’aboutir à de vrais débats, où des idées peuvent être échangées, dont chacun peut s’enrichir en faisant, au moins partiellement, évoluer ses points de vue.
Comprendre, pour mieux agir
Ce petit ouvrage constitue en définitive, aux yeux de l’auteur, une invitation à la pensée critique, au débat, à l’échange ouvert d’idées contraires, à la nuance, à la complexité du réel, à la réflexion, à la recherche d’un débat davantage mu par la prise de recul, ainsi qu’un meilleur usage de nos réseaux sociaux, pour tenter de contenir la déraison et en revenir à davantage de réflexion comme de mesure.
Une petite pierre jetée dans l’océan de la réflexion et de l’esprit humain de notre époque, auquel on ne peut souhaiter qu’un retour vers plus de sens de la mesure et de recours à la raison…
À lire également : Les réseaux sociaux dans la guerre en Ukraine