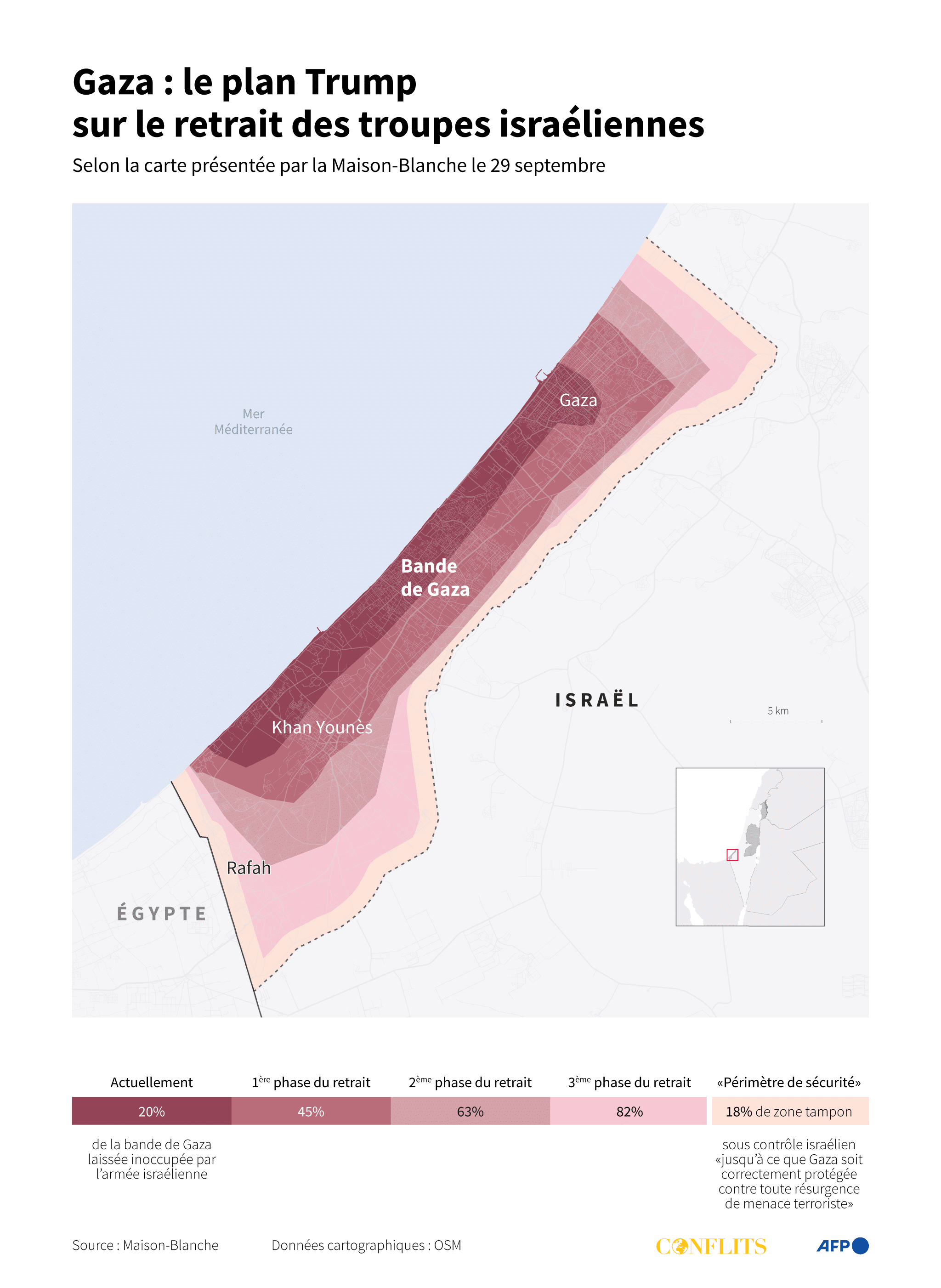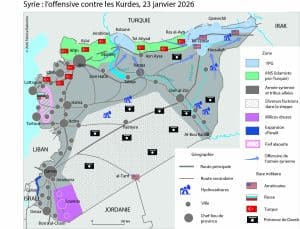Le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé un plan de paix soutenu par Washington pour Gaza, incluant une force internationale et un comité de transition présidé par Donald Trump. Une résolution controversée, saluée par ses partisans mais critiquée par le Hamas, la Russie et Israël, qui redoutent ses implications politiques.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d’une force internationale, sous la pression des États-Unis qui mettaient en garde contre le risque d’une reprise de la guerre.
Treize de ses membres se sont prononcés en faveur de la résolution. Le président américain s’est félicité d’« une des approbations les plus importantes de l’histoire des Nations unies ».
Donald Trump a remercié les pays siégeant au Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine, qui se sont abstenues.
À lire également
Le plan de paix pour Gaza — Texte complet
Une résolution profondément remaniée
Plusieurs fois modifiée lors de négociations sensibles, la résolution « endosse » le plan du président américain qui a permis, depuis le 10 octobre, un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.
Pour Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, son adoption est « une étape importante dans la consolidation du cessez-le-feu » à Gaza, ravagée par deux années de guerre provoquée par l’attaque du 7 octobre 2023.
Le Hamas a estimé que le texte, soutenu par l’Autorité palestinienne, « ne répond(ait) pas aux exigences et aux droits politiques et humains » des Palestiniens. Il « impose un mécanisme de tutelle internationale sur la bande de Gaza, ce que notre peuple […] rejette », a écrit le mouvement.
Un Comité de la paix présidé par Donald Trump
La résolution donne mandat jusqu’au 31 décembre 2027 à un « Comité de la paix », organe de « gouvernance de transition » jusqu’à la réforme de l’Autorité palestinienne, présidé par Donald Trump.
Le texte « autorise » aussi une « force de stabilisation internationale » (ISF) chargée de la sécurisation des frontières, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement « des groupes armés non étatiques », de la protection des civils et de la formation d’une police palestinienne. Sa composition n’est pas précisée.
Contrairement aux premières versions, l’éventualité d’un État palestinien est mentionnée. Après la réforme de l’Autorité palestinienne, « les conditions pourraient […] être en place pour un chemin crédible vers une autodétermination palestinienne et un statut d’État », dit le texte.
À lire également
Israël : frontières mentales et murs anthropologiques
Objections russes
Un avenir clairement rejeté par Israël. « Notre opposition à un État palestinien […] n’a pas changé », a insisté le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Danny Danon, a insisté sur le retour des corps des otages et la « démilitarisation du Hamas ».
Pour la France, qui a voté pour la résolution, elle « répond aux besoins les plus urgents des populations et permet de soutenir les efforts de paix en cours ».
« Nous nous sommes assurés que le texte inclue […] des références à la perspective d’un État palestinien », a précisé une source diplomatique.
Louis Charbonneau, de Human Rights Watch, a souligné que la résolution ne diminue en rien « l’obligation qu’ont Israël et ses alliés de se conformer au droit international ».
La Russie avait proposé un texte concurrent, jugeant que la version américaine n’allait pas assez loin concernant la perspective d’un État palestinien, affirmant un « engagement indéfectible » envers la solution à deux États.
L’ambassadeur russe Vassili Nebenzia a regretté que « le Conseil donne son aval à une initiative américaine […] accordant le contrôle total de Gaza au Comité de la paix ».
D’autres États membres ont aussi exprimé des réserves sur le manque de clarté des mandats du Comité de la paix et de l’ISF.
Une pression américaine accrue
Face à ce qu’ils ont jugé être des « tentatives de semer la discorde », les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour obtenir un feu vert.
« Voter contre cette résolution, c’est voter pour un retour à la guerre », a lancé Mike Waltz avant le scrutin.
Washington a également mis en avant le soutien de plusieurs pays arabes et musulmans (Qatar, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Jordanie, Turquie).
À lire également
Israël et les Houthis : extension périphérique d’un conflit régional