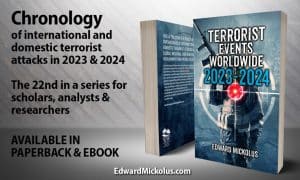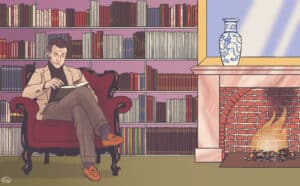Éducation nationale, histoire économique, histoire des familles, mondes arabes, histoire. Aperçu des livres de la semaine.
Henry Laurens, Question juive, problème arabe, Folio Histoire, 14,50 euros
Dans cette somme accessible en poche, Henry Laurens, professeur au Collège de France et spécialiste du monde arabe contemporain, nous fait plonger dans plus d’un siècle et demi d’histoire, depuis les débuts de la « question d’Orient » jusqu’aux convulsions du Proche-Orient actuel. Question juive, problème arabe articule deux problématiques souvent séparées : la « question juive », liée à l’émancipation des communautés juives en Europe et aux persécutions qui ont culminé dans la Shoah ; et le « problème arabe », c’est-à-dire l’incapacité du monde arabe à s’inscrire pleinement dans le système international moderne, marqué par colonisations, dépendances et conflits.
Prenant le pari de l’exhaustivité, l’ouvrage se distingue des nombreuses œuvres sur l’histoire du conflit israélo-palestinien par sa profondeur d’analyse et sa volonté d’éviter tout manichéisme. L’auteur montre comment ces deux histoires, juive et arabe, en viennent à se croiser dramatiquement en Palestine au XXᵉ siècle, faisant de ce territoire le lieu d’une collision de mémoires, d’exils et de revendications nationales. Il expose les logiques politiques, idéologiques et géopolitiques qui conduisent à l’émergence du conflit israélo-palestinien, sans jamais céder à la tentation de la simplification. L’un des apports majeurs de ce livre est de replacer la question israélo-arabe dans le cadre plus vaste de l’histoire mondiale : émancipations, impérialismes, nationalismes et décolonisations. Laurens donne ainsi les clés pour comprendre pourquoi ce conflit demeure si difficile à résoudre : il n’est pas seulement un affrontement local, mais le résultat d’un enchevêtrement historique de traumatismes et de projets contradictoires.
Un livre magistral, à la fois érudit et accessible, qui confirme le rôle d’Henry Laurens comme figure incontournable de l’historiographie de l’Orient contemporain. TY
Pascal Ory, Qu’est-ce qu’une nation ? Folio Histoire, 11,10 euros
Historien des représentations et des idées, Pascal Ory s’est imposé depuis longtemps comme une figure incontournable dans l’art d’éclairer les concepts à travers leurs usages sociaux et politiques. Dans Qu’est-ce qu’une nation ?, il propose une réflexion à la fois didactique et brillante sur ce que signifie, pour l’historien, manipuler des « notions » : démocratie, nation, révolution, mémoire, etc. Le pari est audacieux : il ne s’agit pas seulement de définir, mais de montrer comment chaque notion évolue dans le temps, se charge d’affects et d’intérêts, et devient un véritable acteur de l’histoire.
Ory invite ainsi à comprendre l’histoire non comme une succession d’événements, mais comme un champ d’expériences où les mots pèsent, façonnent et organisent les pratiques collectives. À travers un style accessible et une érudition sans lourdeur, il fait sentir combien les notions appartiennent à des « régimes d’historicité » : ce que signifiait « démocratie » au XIXᵉ siècle n’a plu le même contenu au XXIᵉ, et cette plasticité constitue un objet d’étude en soi.
Le livre vaut autant par ses exemples (issus de l’histoire culturelle, politique et intellectuelle) que par son ambition théorique : il rappelle que l’historien n’est jamais neutre face aux notions qu’il manipule. En temps de crise des repères, cette mise en garde méthodologique devient une leçon de vigilance citoyenne. Un ouvrage dense et éclairant, qui démontre, une fois encore, la capacité de Pascal Ory à conjuguer exigence savante et clarté pédagogique. TY
La France, de la préhistoire à nos jours. Une histoire économique et sociale. Sous la direction de Pierre-Cyrille Hautcoeur et Catherine Virlouvet, Passés Composés, 2025, 39 €
Le travail des éditions Passés Composés est remarquable. Ils osent publier de gros et lourds ouvrages, sur des sujets qui ne sont pas, a priori, vendables. C’est le cas avec cette histoire économique et sociale de la France, qui ne fera peut-être pas beaucoup parler d’elle, alors que l’ouvrage est remarquable en tout point.
Remarquable d’abord parce qu’il signe le grand retour de l’histoire économique, trop souvent réduite à la sociologie. La France a connu de grands experts dans ce domaine et a contribué à valoriser la connaissance historique de la France. Il est heureux que cette tradition et ce savoir-faire se poursuivent.
Remarquable ensuite par la liste des auteurs convoqués, qui témoigne de la diversité de la recherche française.
Cette histoire économique est une histoire de la France, par ses entreprises, ses travailleurs, ceux qui ont contribué à façonner les paysages et à développer son industrie. Loin de la politique qui se perd dans de vieilles querelles, c’est l’histoire même du temps long, de la profondeur et de la durée. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent aborder la France par son économie et ses inventeurs.
Simon Sebag Montefiore, Le Monde. Une histoire familiale de l’humanité, tome 1, Passés Composés, 2025, 31 €
À propos de gros livres publiés par Passés Composés, celui-ci en est un autre. Cette histoire du monde par la famille est une approche tout à fait originale et novatrice. Elle est portée par Simon Sebag Montefiore, très connu dans le monde anglo-saxon, où il vend beaucoup et où il est primé, beaucoup moins en France.
C’est une histoire par la démographie, approche essentielle pour aborder l’histoire de l’humanité. C’est-à-dire une histoire par les hommes, les femmes, les couples, les décès et les vivants. Une histoire de la croissance et de la natalité. Une histoire de l’intime qui touche l’ensemble de la population. Avec un véritable talent de conteur, l’auteur nous plonge dans cette histoire profonde de l’humanité. Un miroir envoyé vers nous-mêmes et notre époque.
Philippe Nemo, L’Éducation nationale. Origines, apogée et déclin d’une idée, Puf, 2025, 23 €
Le philosophe des idées politiques Philipe Nemo poursuit son combat pour une éducation libre et de qualité en s’en prenant à un mythe français, celui de l’éducation nationale. Remontant à l’époque médiévale, il montre comment l’école a existé bien avant Jules Ferry, mais avec une philosophie scolaire très différente de celle d’aujourd’hui. La République a marqué une rupture dans l’idée d’école. Désormais, l’école devait être à la solde du pouvoir politique, façonner des enfants pour les rendre conformes à l’idée du régime et non pas chercher à les instruire et à les éduquer. Cette grande trahison de l’éducation nationale se poursuit aujourd’hui, avec les dégâts pédagogiques que nous connaissons. Ce n’est pas une faillite, mais la continuité de l’idée de Jules Ferry : mettre l’école au service du régime et de sa philosophie et non pas des personnes et de l’intérêt général. Un ouvrage brillant qui démontre l’imposture du centralisme et du monopole de l’éducation nationale. Une école à laquelle plus personne ne croit, ni les parents, ni les professeurs. Les premiers ne veulent plus y inscrire leurs enfants, les seconds ne veulent plus y travailler. Il est temps d’en finir et de revenir à une école libre et indépendante, ce qui est la véritable nature de l’école.