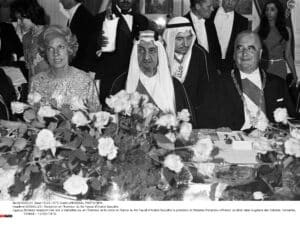Pour l’amiral Nelson, « le marin qui s’attaque à la terre est un fou ». Les Alliés, durant la Seconde Guerre mondiale, avaient montré que cette assertion était sans doute périmée, mais le débarquement américain à Incheon, dans le cadre de la guerre de Corée, en septembre 1950, acheva de le démontrer. Il rappela aussi l’intérêt militaire de troupes d’assaut amphibies spécialisées à l’heure où les « cost-killers » du budget pensaient profiter de l’avènement de l’ère atomique pour supprimer les troupes d’intervention comme l’USMC [simple_tooltip content=’United States Marine Corps : corps des marines des États-Unis.’](1)[/simple_tooltip], dont la devise reprend les premiers mots de son hymne officiel : Semper fidelis, toujours fidèle.
Créé en novembre 1775, au début de la guerre d’Indépendance [simple_tooltip content=’Rappelons qu’après la Boston Tea Party de 1773, le premier engagement de la guerre eut lieu à Lexington le 19 avril 1775. La déclaration d’indépendance des États-Unis ne date que du 4 juillet 1776, après la prise de Boston. ‘](2)[/simple_tooltip], le corps des marines est une entité autonome, dépendant du budget de la marine, mais non intégré aux unités navales et avec son propre état-major. Il se distingue donc des fusiliers marins, qui sont des marins entraînés au combat à terre et intégrés à l’équipage des navires, et ressemble plus aux troupes de marine françaises, avec davantage d’autonomie et une aviation propre depuis la Seconde Guerre mondiale. Le corps compte 485 000 hommes en 1945, où il aligne six divisions et intervient uniquement dans le Pacifique, mais est retombé sous les 28 000 sous l’effet des coupes budgétaires en 1950.
Guerre « chaude » dans la guerre froide
La guerre de Corée résulte d’un malentendu. Colonie japonaise depuis 1905, la péninsule avait été partagée en deux zones d’occupation en 1945, à l’instar de l’Allemagne : une au nord pour l’URSS, l’autre au sud pour les États-Unis. Il en était « naturellement » résulté en 1948 la création de deux États, l’un communiste, l’autre nationaliste, et des tensions récurrentes, voire des combats [simple_tooltip content=’L’historien coréen Heo Man-Ho recense quelque 100 000 morts dans les affrontements avant juin 1950. ‘](3)[/simple_tooltip], à la frontière, arbitrairement tracée le long du 38e parallèle. Après le basculement de la Chine dans le bloc communiste en 1950, le secrétaire d’État Dean Acheson rappela quels pays les États-Unis considéraient comme leurs alliés en Asie… en oubliant de mentionner la Corée du Sud. Moscou donna alors le feu vert à la Corée du Nord pour réunifier la Corée.
Leur écrasante supériorité (135 000 hommes et 200 avions de combat) permet aux Nord-Coréens de balayer les troupes sudistes, totalement surprises par l’attaque du 25 juin 1950. Ils prennent Séoul, la capitale, proche de la frontière, le 28, mais le gouvernement de Syngman Rhee ne capitule pas et dès le 27, le Conseil de sécurité de l’ONU condamne l’agression nord-coréenne par sa résolution 83, qui donne une assise à une réaction militaire des Américains [simple_tooltip content=’Cette résolution put être votée sans que l’URSS ne pose son veto, car son représentant pratiquait alors la politique de la « chaise vide » pour obtenir que le siège permanent de la Chine soit transféré à la Chine populaire en lieu et place du gouvernement nationaliste, réfugié à Taïwan depuis le 8 décembre 1949.’](4)[/simple_tooltip].
A lire aussi : La mafia chinoise, une contre-société au service du pouvoir
La 8e armée américaine renforce d’abord l’ultime réduit où se sont réfugiées les troupes sud-coréennes autour de Busan, le principal port du pays, au sud-est de la péninsule. Le front de 220 kilomètres protégeant la poche en s’appuyant en partie sur le fleuve Nakdong résiste désormais, car les forces se sont rééquilibrées (un peu moins de 100 000 Nord-Coréens assiègent environ 140 000 soldats de la coalition). C’est le moment où le général MacArthur, alors en poste au Japon, ressort le plan qu’il avait proposé en juillet : débarquer à Incheon ; mais alors qu’en juillet il voulait secourir au plus vite les troupes sud-coréennes, en septembre, Incheon se trouve à près de 300 kilomètres derrière les lignes ennemies. Quant aux défauts du site, qui avaient conduit à écarter la proposition en juillet, ils étaient toujours là, tels que les résumait un officier américain : « Nous avions dressé une liste de chaque désavantage naturel et géographique et Incheon les avait tous. » Mais la zone offrait un port équipé et un aérodrome, ce qui permettrait de renforcer rapidement la tête de pont initiale, préoccupation cruciale dans une opération de projection compliquée par la sophistication croissante des armées, exigeant une logistique de plus en plus performante – il ne suffit plus de balancer des bidons d’essence, des boîtes de ration et des caisses de munitions en vrac sur les plages…
Opération « Chromite »
La région était de surcroît un point fort nord-coréen, avec quelque 1 500 hommes autour d’Incheon tandis que Séoul, située à moins de 30 kilomètres à l’est, était occupée par près de 5 000 combattants. MacArthur en tira un argument supplémentaire : la surprise, les Nord-Coréens n’imaginant pas un assaut en cet endroit si peu adéquat ! Il semble d’ailleurs que, comme pour les débarquements en Europe, les Américains aient entretenu l’idée qu’un débarquement se préparait plus au sud, à côté de la poche de Busan. L’ampleur de l’« opération Chromite » fut évidemment bien moindre que les débarquements de la Seconde Guerre mondiale : dans les premières vingt-quatre heures, le 15 septembre, les Américains débarquent sur les trois sites de Green, Red et Blue Beach environ 13 000 hommes (soit dix fois moins qu’en Normandie), essentiellement des marines, appuyés par un peu plus de 200 navires ; le 16, il suffit de deux avions Corsair des marines pour bloquer une contre-attaque de chars T34 nord-coréens ; et au bout d’une semaine, c’est près de 55 000 soldats qui contrôlent la région et avancent vers Séoul, dont la libération est annoncée symboliquement le 25 septembre, jour anniversaire de l’invasion, mais qui prendra encore quelques jours.
Le débarquement d’Incheon survient à point nommé pour consommer l’échec de l’offensive nord-coréenne contre le périmètre de Busan, engagée fin août, début septembre. Le 15, les éventuelles avancées nord-coréennes étaient toutes stoppées, voire annulées, et l’irruption de troupes américaines fraîches sur les arrières d’unités largement épuisées et désorganisées par leurs efforts récents déclenche une retraite sur l’ensemble du front à partir du 23 septembre, sous la pression des troupes coalisées qui sortent de la « poche » pour raccompagner les envahisseurs vers le nord. La dimension politique prime toutefois sur l’aspect strictement militaire : la priorité des troupes débarquées à Incheon était bien la libération de Séoul, ce qui ne permit pas l’encerclement total des Nord-Coréens assiégeant Busan.
Mais l’armée de Kim Il-sung est virtuellement détruite : seuls 30 000 hommes en déroute repassent le 38e parallèle, ayant perdu tous leurs blindés et une grande partie de leur aviation. Même rééquipés en hâte par une aide d’urgence soviétique, comment pourraient-ils désormais s’opposer à la progression des troupes américaines, qui alignent 165 000 combattants terrestres appuyés par 85 000 marins et aviateurs – sans compter les Sud-Coréens ? Le 7 octobre, le 38e parallèle est franchi par les forces sud-coréennes et onusiennes, la capitale Pyongyang est prise le 21 et le 26, des unités sud-coréennes parviennent sur le Yalou, le fleuve marquant la frontière avec la Chine, au moment même où la 7e D.I. américaine, réitérant le « coup » d’Incheon, est débarquée à Wonsan, sur les flancs de l’armée du nord. C’est le moment que choisit l’armée chinoise pour déclencher la première phase de sa contre-offensive : la guerre de Corée prenait une nouvelle dimension, qui la prolongera jusqu’en 1953.
À cette date, le corps de marines aura retrouvé un effectif de 260 000 soldats d’active et sera définitivement « sanctuarisé » par l’adoption, le 28 juin 1952, du Douglas-Manfield Act, aussi appelé Marine Corps Bill ou, plus prosaïquement, Public Law 416 : le commandant du corps appartient désormais au comité conjoint des chefs d’état-major, autorité militaire suprême aux États-Unis, et son effectif d’active sera stabilisé à trois divisions et trois escadrilles aériennes, pour un maximum de 400 000 hommes.