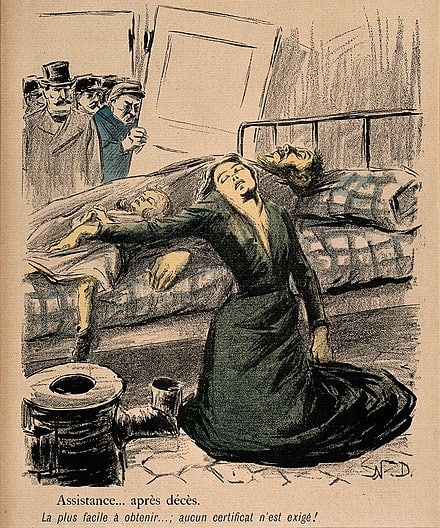La bataille de Poitiers n’est pas celle que vous croyez : compte tenu des incertitudes entourant l’événement, la « vraie » bataille de Poitiers se joue, comme la bataille d’Hernani, autour des interprétations et de la tradition lui ayant donné le statut de « bataille historique ». Aussi ne m’attarderai-je pas aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, sur l’événement lui-même, mais sur sa dimension symbolique, qui est d’une certaine façon sa réelle portée géopolitique.
Bien difficile en effet de parler d’un événement dont on connaît si peu de choses. Si la bataille et son contexte sont présents dans plusieurs sources, chrétiennes ou musulmanes, quasi contemporaines ou plus tardives, une seule en donne un récit un peu détaillé : la Chronique mozarabe, écrite comme son nom l’indique par un chrétien arabisé vivant en Espagne, sans doute à Cordoue, qui est la seule source contemporaine de l’événement. Et encore son récit tient-il en une page !
A lire aussi: L’empire arabe: la grandeur fantasmée
Où, quand, comment ?
Le lieu même du combat est incertain, mais l’épisode est situé après le pillage de la basilique Saint-Hilaire, près de Poitiers, alors que l’armée musulmane continue son avance vers le nord en direction de Tours [simple_tooltip content=’D’ailleurs, les Anglo-Saxons l’appellent plutôt « bataille de Tours » que bataille de Poitiers.’](1)[/simple_tooltip] ; la bataille a donc eu lieu quelque part entre ces deux villes, mais à quelle distance ? Aucun des lieux proposés par les chercheurs qui se sont essayés à l’exercice n’est pleinement convaincant, mais une tradition locale la situe au lieu-dit Moussais-la-Bataille, à moins de 10 kilomètres au sud de Châtellerault, le long d’une voie romaine alors très utilisée, et c’est là qu’un mémorial didactique avec table d’orientation a été installé.
Sa date n’est pas plus assurée, puisque les sources peuvent justifier une datation comprise entre 731 et 734. Les auteurs du volume qui lui est consacré dans la célèbre collection des « 30 journées qui ont fait la France » penchaient plutôt pour l’année 733, mais P. Sénac, grand spécialiste des rapports entre l’islam et l’Occident, maintient quant à lui la datation traditionnelle du 25 octobre 732.
Quant à son déroulement, on est obligé de s’en remettre à la Chronique mozarabe : deux armées qui se font face et se jaugent (pendant 7 jours), un assaut des Arabes qui se heurtent au « rempart de glace » des Francs (dont on peut donc penser qu’ils combattent majoritairement à pied, ce qui n’est pas anachronique car la cavalerie ne deviendra une arme dominante que sous les Carolingiens) avant de se retirer, laissant leur camp déserté et le champ de bataille aux vainqueurs, qui n’engagent pas de poursuite. Le site de Moussais est compatible avec ce récit du combat, l’armée franque ayant pu prendre position pour barrer la voie romaine – l’axe de progression le plus vraisemblable – en s’appuyant sur deux rivières, le Clain et la Vienne, ce qui est plutôt conseillé pour une armée d’infanterie face à une importante force de cavaliers. Cela pourrait aussi expliquer la perplexité des Arabes et la semaine d’escarmouches précédant la bataille. La seule précision factuelle, commune à la majorité des sources, est la mort de l’émir Abd al-Rahman, gouverneur de Cordoue, au cours du combat.
À chacun son Charles
Un événement aussi mal connu est idéal pour justifier toutes sortes d’interprétation et accéder au rang de symbole, sinon de mythe. C’est ce que retrace le dernier livre en date sur cette bataille, écrit par W. Blanc et C. Naudin, intitulé Charles Martel et la bataille de Poitiers – De l’histoire au mythe identitaire (Libertalia, 2015). Cet ouvrage, bien documenté et nuancé, souligne que ce n’est pas la bataille qui retint d’abord l’attention, mais Charles Martel. Au gré des périodes et des préjugés des auteurs, le maire du Palais, précurseur des Carolingiens, fut successivement considéré comme un spoliateur de l’Église ou un allié du pape, comme un homme d’État lucide ou un usurpateur, comme le fondateur d’un pouvoir royal brimant l’aristocratie ou comme l’initiateur de la féodalité…
Ces jugements n’avaient que peu à voir avec la bataille de Poitiers, longtemps reléguée en périphérie de l’histoire de France et en tout cas rarement célébrée comme un tournant historique. Son interprétation comme un choc entre islam et chrétienté, reprise aujourd’hui jusqu’aux États-Unis comme une évidence, est quasiment la dernière à apparaître et, ironie de l’histoire, plutôt de façon négative : Voltaire, dans son souci de développer une histoire « décléricalisée », voit le Moyen Âge occidental comme une période uniformément obscure et Poitiers comme une occasion manquée de s’abreuver à la source de la vraie lumière, qu’est censé incarner l’islam des premiers siècles. Cette thèse, qui est à l’origine de la contre-attaque de Chateaubriand montrant un islam agressif et envahisseur auquel les chrétiens répondent, à Poitiers ou, plus tard, par les Croisades, sera reprise sans nuance par beaucoup d’orientalistes, par les historiens positivistes et par certains auteurs arabes du xixe siècle. La fascination et les préjugés favorables des « progressistes » à l’égard de l’islam ne datent donc pas d’aujourd’hui, et inversement [simple_tooltip content=’Après la révolution de 1848, le pacha d’Égypte Mehmet Ali adresse cette proclamation étonnante au peuple français : « […] Reconnaissez enfin que nous sommes vos aînés en civilisation ; […] maudissez la mémoire des Charles Martel, des Sobielski, qui ont barré le chemin des armées musulmanes alors qu’elles venaient […] vous apporter le régime bienheureux que les apôtres du socialisme vont inaugurer aujourd’hui parmi vous. Dieu seul est grand ! Louis Blanc et Cabet sont ses prophètes aussi bien que Mahomet.»’](2)[/simple_tooltip].
On comprend dès lors que Charles Martel ne soit pas un personnage majeur du Panthéon national, que ce soit sous la Restauration, qui voit en lui l’usurpateur, sous le Second Empire, qui préfère Vercingétorix et les Gaulois aux Francs un peu trop germaniques, ou la République, qui le trouve encore trop clérical. Du reste, si le manuel d’Ernest Lavisse de 1876 destiné aux écoles primaires est sans doute le premier qui présente explicitement Poitiers comme un coup d’arrêt à la marée de l’islam partie, un siècle plus tôt, d’Arabie, cette vision est loin d’être omniprésente après la Première Guerre mondiale.
A lire aussi: Retrouver le sens des victoires françaises
Faut-il se mettre Martel en tête ?
La démonstration de MM. Blanc et Naudin souffre cependant de quelques faiblesses. Concluant le chapitre sur l’histoire de la bataille, ils résument leur avis par cette formule : « Difficile, dès lors, de considérer la bataille de Poitiers comme l’une des étapes majeures d’un affrontement séculaire, de toute façon fantasmé, entre islam et chrétienté. » Pourtant, quelques lignes plus haut, ils estiment que la bataille n’est pas anodine dans l’histoire de la Gaule, la comparant au siège de Toulouse (720), premier échec d’une expédition musulmane venue d’Al-Andalous (l’Espagne arabe). Certes, Poitiers ne met pas fin aux incursions arabo-berbères, et Charles Martel remporta d’ailleurs d’autres victoires contre eux, notamment à Sigean (ou la Berre, 737), dans cette Septimanie (Languedoc et Catalogne) qu’il ne réussit pas à arracher à l’influence sarrasine, échouant à prendre Narbonne (son fils, Pépin le Bref, s’en chargera en 759). De fait, les victoires de Charles, pas plus Poitiers que les autres, ne purent empêcher le maintien d’une présence musulmane de longue durée dans le Sud de la France, jusqu’en Provence, présence qui se renforça même au xe siècle parallèlement aux implantations en Italie et Sicile. Ainsi, le site de la Garde-Freinet, dans le massif des Maures, abrita pendant près d’un siècle une place forte musulmane, qui ne fut conquise par les Provençaux qu’en 973. Les relations entre chrétiens et musulmans n’étaient pas systématiquement violentes et la cohabitation semble avoir été pacifique et fructueuse.
Les États chrétiens eux-mêmes ne se comportaient pas nécessairement en adversaires irréductibles et intransigeants des musulmans, comme d’ailleurs leurs homologues d’outre-Pyrénées, et pouvaient à l’occasion pactiser avec eux. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait le comte d’Aquitaine, Eudes, avant de s’allier à Charles Martel devant l’expédition guerrière de 732, qui s’en prit notamment à Bordeaux.
Cette expédition était-elle une invasion en règle, autrement dit une tentative pour établir une domination politique durable au Nord des Pyrénées ? Blanc et Naudin pensent que non, et ils soulignent à juste titre que la mention de femmes et d’enfants dans l’expédition d’Abd al-Rahman est sûrement apocryphe. Mais ce « marqueur » des grandes invasions germaniques n’est pas vraiment pertinent pour la conquête arabe : le Maghreb et l’Espagne ont été conquis par quelques milliers de guerriers, Arabes ou Berbères convertis. La présence des familles n’est donc pas indispensable pour identifier un projet politique. D’autant qu’au début de la conquête musulmane, les conquérants ne cherchent pas spécialement à convertir les populations, ne serait-ce que pour des raisons fiscales [simple_tooltip content=’Les musulmans, conformément au Coran, imposaient aux « gens du Livre » (juifs et chrétiens) un impôt particulier, signe de leur statut de « protégés » (dhimmi). L’impôt sera ensuite maintenu pour les convertis.’](3)[/simple_tooltip].
On peut aussi être circonspect devant leur lecture de Poitiers comme un événement purement politique, et non religieux. D’autant qu’ils ont rappelé que les sources musulmanes élèvent Abd al-Rahman et tous les guerriers tombés dans la bataille au rang de « martyrs de la foi » ; la formule a sans doute une dimension rituelle, stylistique, mais on ne peut lui dénier tout sens religieux. Par ailleurs, la chronique mozarabe, pour décrire les protagonistes, utilise les termes « Arabes » (ce qui est quelque peu réducteur car les armées de Cordoue comprenaient sûrement des guerriers berbères) et « Européens » – c’est, semble-t-il, le premier usage du terme pour désigner une coalition chrétienne, ici des Francs et des Aquitains… De quoi relancer le débat sur les « racines chrétiennes de l’Europe » ? C’est en tout cas l’interprétation de P. Sénac, qui parle même à son propos de « choc des civilisations ».
Un signe plus qu’un symbole
Certes, présenter Poitiers comme LE moment historique où les « Arabes » furent « arrêtés » est évidemment infantile. Non seulement parce que la bataille n’a pas ce statut dramatique du « tout-ou-rien », cette portée décisive comparable à la première bataille de la Marne ou à l’appel du 18 Juin, mais aussi parce qu’à cette époque la question ne se pose pas (ou pas seulement) en des termes ethniques ou religieux. Dans l’Espagne de la Reconquista, les principautés chrétiennes ne firent pas toujours bloc contre les « Maures » et les alliances, mouvantes, mettaient souvent en présence des chrétiens et des musulmans des deux côtés. De même que les musulmans eurent parfois comme premiers ennemis d’autres musulmans, plus rigoristes et plus puissants, comme lors des deux « ré-invasions » de la péninsule par les Almoravides, au xie siècle, et les Almohades au xiie. La volonté de croyants se jugeant plus purs et plus fidèles de mettre au pas leurs coreligionnaires dévoyés ne date pas du wahhabisme ou de Daesh, et il serait d’ailleurs plus intéressant aujourd’hui d’étudier à l’école ces événements que Poitiers.
Ce dont Poitiers est un marqueur, parmi d’autres, c’est que l’influence et la présence arabo-musulmanes au nord des Pyrénées restèrent limitées. Non seulement à cause de la bataille, mais aussi parce qu’elle s’inscrit dans une « séquence historique » qui voit l’affaiblissement de la vague partie un siècle plus tôt d’Arabie et qui a submergé l’Asie de l’Ouest, l’Afrique du Nord et la péninsule hispanique : repoussés deux fois devant Constantinople, dont la dernière en 718, les Arabes remportent une victoire sans lendemain face aux Chinois à Talas, en Asie centrale, en 751, qui marque plutôt le point extrême de leur avance militaire. Car le milieu du viiie siècle voit aussi la fin de la dynastie ommeyyade, remplacée par les Abbassides, et le fractionnement de l’« empire arabe ». Restée dominée par des émirs de la dynastie déchue, Al-Andalous mènera désormais une politique plus conservatrice qu’expansionniste, malgré les incursions déjà évoquées.