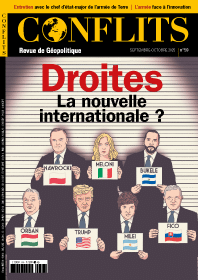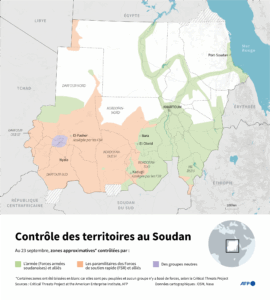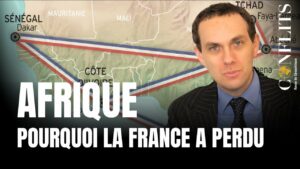En proclamant à Las Anod la naissance de l’État du Nord-Est, issu de l’administration SSC-Khaatumo, la Somalie redessine ses équilibres internes. Cette formalisation politique, reconnue par Mogadiscio, bouscule les ambitions du Somaliland, reconfigure les calculs d’Addis-Abeba et ouvre une séquence incertaine entre le risque d’escalade et l’opportunité d’une refondation fédérale.
Article de Théo Thibault-Pinon
La Somalie, pivot stratégique et historique aux portes de Bab el-Mandeb
À l’extrémité orientale du continent, la Somalie forme la proue de la Corne de l’Afrique, bordée par le golfe d’Aden au nord et l’océan Indien à l’est, avec Djibouti au nord-ouest, l’Éthiopie à l’ouest et le Kenya au sud-ouest. Les régions de Sool, Sanaag et Cayn (SSC) — épicentre de la crise — s’étirent entre le Puntland et le Somaliland, au cœur des corridors terrestres stratégiques vers les marchés et les littoraux.
Sa géographie a fait de la Somalie un pivot des routes commerciales depuis l’Antiquité, du fait de ses premiers ports intégrés au Periplus maris Erythraei, par le commerce de l’encens, de l’ivoire et des aromates ; depuis les relais médiévaux de l’océan Indien reliant la mer Rouge à l’Asie en passant par l’escale disputée par les puissances européennes qu’elle constituait à « l’ère des vapeurs » et du canal de Suez.
Les ressorts d’une « fragmentation » de fait
L’actuelle fragmentation somalienne plonge ses racines dans l’effondrement de l’État en 1991, après la chute du régime de Siad Barre. La guerre civile, la structuration de milices claniques et l’essor d’autorités régionales (déclaration unilatérale d’indépendance du Somaliland en 1991, autonomie du Puntland en 1998) aux statuts divers et contestées de part et d’autre ont durablement déconstruit l’unité politique. Le pari fédéral — amorcé sous les gouvernements de transition puis consacré par la Constitution provisoire de 2012 — a cherché à recomposer l’État autour de membres fédérés (Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, Sud-Ouest, Puntland, désormais l’État du Nord-Est), sous la pression simultanée de l’insurrection d’Al-Shabaab et des ingérences régionales.
Le baril dont la poudre prit feu : le « contentieux SSC »
Le nouvel État revendique les territoires de Sool, Sanaag et Cayn, disputés depuis des décennies entre le Somaliland — qui invoque les frontières de l’ex-protectorat britannique — et le Puntland, qui fonde ses prétentions sur les liens claniques, notamment avec le clan Dhulbahante majoritaire, aux côtés des Warsangeli. Fin 2022-début 2023, l’assassinat de figures locales à Las Anod déclenche des manifestations durement réprimées par les forces du Somaliland. Le conflit fait des centaines de morts et plus de 200 000 déplacés dans un contexte de sécheresse aiguë. En août 2023, les milices locales du SSC-Khaatumo reprennent Las Anod et ses environs, chassant l’armée du Somaliland jusqu’alors solidement présente et inversant le rapport de force. La proclamation, le 31 juillet à Las Anod, consacre politiquement cette réalité de terrain.
Une proclamation qui rebat les cartes à l’effet domino immédiat
En adoubant « l’administration SSC-Khaatumo » et en l’adossant à ses mécanismes de concertation, Mogadiscio et sa primature n’ont pas seulement corrigé une anomalie administrative : ils ont rouvert l’horloge stratégique de la Corne de l’Afrique. La « normalisation » des SSC au sein du giron fédéral — fin de l’étiquette de « zone contestée », accès direct aux aides et aux programmes de développement — traduit une double intention : réaffirmer la souveraineté de l’État central et affaiblir le narratif sécessionniste du Somaliland, qui perd Las Anod et voit son statut de « bastion de stabilité » mis en avant à l’international fragilisé. Hargeisa dénonce une provocation, mais l’équation a changé : l’avantage militaire acquis par les forces locales en 2023 a produit ses effets politiques.
À l’échelle régionale, l’épée de Damoclès tombe. L’Éthiopie, engagée depuis janvier 2024 dans un protocole controversé avec le Somaliland pour un débouché maritime, doit réévaluer ses paris : la capacité d’exécution côté Hargeisa est fragilisée, tandis que de nouveaux interlocuteurs —SSC-Khaatumo et Mogadiscio — s’invitent à la table des corridors terrestres vers le golfe d’Aden. Addis-Abeba, qui combine impératif maritime, pressions économiques internes et rivalité avec l’Érythrée, cherchera à préserver des options sans hypothéquer ses relations avec la Somalie fédérale. Le Puntland, pour sa part, oscille entre affinités claniques et défense de ses prérogatives : l’émergence d’un « État frère » unioniste renforce l’architecture fédérale mais rogne mécaniquement son influence directe sur les SSC.
Contre-terrorisme, sécurisation des espaces commerciaux et intégrité régionale : la grille de lecture européenne
Les Européens, eux, lisent la carte à travers trois vues. D’abord la sécurité maritime : tout emballement militaire entre Hargeisa et le duo Mogadiscio/SSC-Khaatumo peut perturber l’arrière-pays du golfe d’Aden et du Bab el-Mandeb, au risque de recréer les conditions favorables à la piraterie que surveille l’opération Atalanta depuis 2008. Ensuite l’antiterrorisme : une guerre intra-somalienne diluerait l’effort contre Al-Shabaab, prioritaire pour le GFS et ses partenaires, dont l’EUTM Somalia qui accompagne la reconstruction des forces fédérales. Enfin, Paris — ancrée à Djibouti — et Bruxelles privilégieront la prudence active, soutenant médiations locales et mécanismes de désescalade, tout en réaffirmant l’intégrité territoriale de la Somalie face aux arrangements bilatéraux qui la contournent.
Deux paramètres complémentaires méritent l’attention. Le premier est économique : l’intégration budgétaire des SSC — paie régulière des fonctionnaires, sécurisation des recettes douanières intérieures, priorisation d’infrastructures duales (routes, énergie, télécoms) — est le test décisif de la crédibilité fédérale. Elle conditionne la loyauté des élites locales autant que la résilience sociale dans une zone durement frappée par la sécheresse et les déplacements massifs ces dernières années de conflit. Le second est diplomatique : un canal de contact discret entre Mogadiscio et Hargeisa, sous parrainage régional (IGAD) et européen, pourrait instaurer des garanties minimales — gel des postures offensives, mécanismes d’alerte aux incidents, accès humanitaire — sans préjuger du statut final, permettant de concentrer l’effort militaire contre Al-Shabaab.
Vers une résolution du conflit dans la durée ?
Le principal danger reste celui d’une course à l’escalade — militaire et politique — entre le Somaliland et le camp unioniste, avec des effets d’entraînement dans une région qui reste éprouvée. À l’inverse, l’intégration d’une région longtemps disputée, sur la base d’un mandat local et dans un cadre fédéral assumé, peut offrir à Mogadiscio l’occasion de démontrer la viabilité dans le temps du projet fédéral somalien. La réussite dépendra de trois leviers : canaliser la compétition Somaliland/SSC vers un dialogue sécurisé ; verrouiller la priorité d’un front populaire contre Al-Shabaab ; et faire de l’aide fédérale un instrument visible de légitimation au bénéfice des populations des SSC.