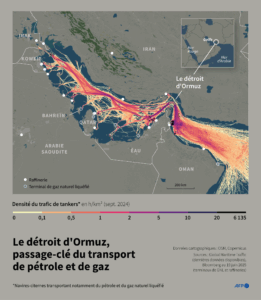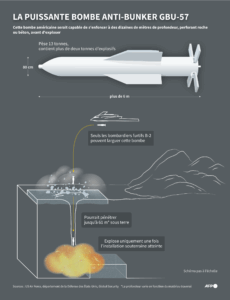D’aucuns s’inquiètent du risque d’une guerre prochaine entre les États-Unis et la Chine, puissances mondiales de premier plan en ce début de XXIe siècle. Si la Chine investit de manière croissante dans son armée, première au monde en termes d’effectifs, elle est le seul membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU à ne pas avoir tiré un coup de feu hors de ses frontières depuis 1988 . L’attitude chinoise de ne pas faire la guerre repose sur une culture stratégique ancienne et caractérisée par une certaine continuité, mais régulièrement renouvelée.
Étudier la culture stratégique chinoise revient à s’interroger sur la manière dont la stratégie est abordée par la Chine à la fois en tant qu’État doté de moyens militaires et que société productrice d’une pensée. La stratégie, définie par Georges-Henri Soutou comme « l’art de dialectique des volontés et des intelligences employant entre autres la force ou la menace de recours à la force à des fins politiques » , consiste non seulement en l’usage de la force, mais aussi en sa simple possibilité en puissance, qu’elle aboutisse ou non, ce qu’illustre le cas chinois.
Une pensée stratégique aussi ancienne qu’au cœur de l’actualité
Le traité de stratégie le plus ancien qui nous soit parvenu, L’Art de la guerre de Sun Tzu, provient de Chine. Il semble avoir été écrit autour du Ve siècle avant J.-C., époque des Royaumes combattants, États princiers qui règlent leurs différends les armes à la main. La guerre y passe de mêlées rudimentaires à une affaire d’armées permanentes, diversifiées et professionnelles, propice à l’expression de talents individuels d’officiers . Sun Tzu dispense alors des conseils qui, s’ils visent à l’emporter dans ce nouveau paradigme, dépassent celui-ci au point que, plus de deux mille ans plus tard, le stratège britannique Liddell-Hart écrit qu’ils « n’ont jamais été surpassés quant à l’étendue et à la profondeur du jugement » . En effet, Sun Tzu envisage la guerre comme « une affaire d’une importance vitale pour l’État » , omniprésente et non anormale, mais ne professe pas pour autant un usage sans bornes et permanent de la force. Bien au contraire, chez lui, le combat n’est qu’un dernier recours, lorsque l’emploi de la ruse, pour « s’attaquer aux plans de l’ennemi » et à ses « alliances » , n’a pas suffi. Il faut connaître son ennemi, au moyen d’espions. À l’inverse, il est nécessaire de feindre la faiblesse lorsqu’on est fort, et la force quand on est faible. « La guerre est fondée sur la tromperie » et le comble du savoir-faire est de l’emporter sans combattre, non de « remporter cent victoires en cent batailles ». De la sorte, « une armée victorieuse l’est avant de chercher le combat » . Une guerre prolongée ne saurait être bénéfique à l’État , aussi prendre une ville intacte vaut mieux qu’initier un long siège coûteux, et « il est des routes à ne pas prendre, des troupes à ne pas frapper, des villes à ne pas assaillir et des terrains à ne pas disputer » . L’intérêt prévaut et la volonté de surprise ne doit jamais mener à des risques irréfléchis. Mieux vaut parfois laisser l’ennemi prendre une ville, pour atteindre des buts plus importants sur le long terme, et mieux vaut un général rationnel qui, au besoin, désobéit au souverain, qu’un chef de guerre intrépide. Avant tout, il faut savoir s’adapter aux situations existantes. Ce conseil général permet aux préceptes de maître Sun une éternelle jeunesse. Sa pensée est une pensée des variations, du circonstanciel : l’art de la guerre est une dialectique entre fins politiques et moyens militaires, les uns devant s’ajuster aux autres sans cesse, quel que soit le contexte du conflit.
Force est de constater l’influence des treize chapitres sur la Chine jusqu’au temps de la République Populaire de Chine (RPC) qui naît, en 1949, de la victoire des communistes dans la guerre civile qui les oppose aux nationalistes du Kuomintang (KMT). Après le désastre de Nan Ch’ang, Mao Zedong préfère suivre les conseils de Sun Tzu plutôt que les ordres du Comité central du Parti, en entamant, d’octobre 1934 à octobre 1935, la Longue Marche, vaste retraite de 10 000 km vers le nord-est de la Chine visant à éviter le combat contre un ennemi en meilleure posture qui a l’initiative. Mao fait plaquer quatre slogans : « L’ennemi avance – nous reculons, l’ennemi s’arrête – nous l’inquiétons, l’ennemi est harassé – nous le frappons, l’ennemi recule – nous le poursuivons ! » . En effet, la manœuvre lui permet de passer dialectiquement de la défensive à la contre-offensive, une fois dans les montagnes du nord où la population est favorable aux communistes et l’ennemi loin de ses bases. Là, induit en erreur par l’assurance excessive qui l’a gagné à force de poursuivre une Armée rouge qu’il croyait faible, celui-ci est vaincu.
La stratégie que Mao fait ensuite suivre au régime reste, entre les lignes, imprégnée de cette pensée ancienne. La « stratégie nucléaire d’autodéfense », en visant à la réalisation d’une force de dissuasion du faible au fort par la possession d’un arsenal nucléaire suffisant pour infliger à l’ennemi des dégâts du même ordre que ceux qu’il provoquerait avec une frappe nucléaire , donne une actualité renouvelée au conseil de ne faire usage de la force qu’en dernier recours.
À lire également
Nouveau Numéro spécial : Regards sur la guerre
Force au-dedans, diplomatie et subterfuges au-dehors ? La culture stratégique en actes
L’Empire chinois, qui dura du IIIe siècle avant notre ère à 1911, se voulait tian xia, maître de « tout ce qui est sous le ciel ». Découlait de cette prétention symbolique à l’universalité une vision concentrique du monde. Le premier cercle comprenait l’espace impérial délimité, et le dernier l’extérieur du monde chinois ; entre deux se trouvaient les États tributaires limitrophes, dernier cercle où l’Empire se réservait le droit d’intervenir. S’il ne s’agit pas d’un expansionnisme à l’occidentale, puisque la Chine n’a pas imposé sa culture à d’autres par la force , sa stratégie n’a guère dévié de cette conception. L’expédition de l’amiral Zheng He au XVe siècle en Afrique n’a jamais connu de lendemains : la dernière intervention chinoise au-delà des mers remonte au XVIIe siècle. Parfois encore, la Chine invoque le concept de tian xia pour revendiquer la souveraineté sur l’ensemble des territoires de l’Empire Qing à sa chute. Mao Zedong comme Tchang Kaï-chek ont cherché à ainsi unifier le pays par l’emploi de la force, la Chine se voulant un État multinational comprenant des minorités ethniques : il est hors de question pour elle de travailler à des compromis avec des « brigands » ou des « séparatistes » qui pourraient mettre à mal l’État . L’actualité nous montre quelles exactions peuvent en résulter sur la population ouïghoure.
Les interventions extérieures passées de la Chine ont répondu à cette même logique : éviter le chaos interne. L’envoi de troupes en Corée en 1950 visait à stabiliser le régime contre des forces « contre-révolutionnaires » internes qui pourraient sortir renforcées d’une victoire du camp capitaliste . L’usage de la force à l’étranger, même pour des hostilités idéologiques de la guerre froide, répond à une visée stratégique propre, liée à l’intérieur du premier cercle.
De grandes victoires chinoises sont toutefois le fruit de la diplomatie. En 1997 et 1999, Hong Kong et Macao sont respectivement rétrocédés par le Royaume-Uni et le Portugal, rejoignant la RPC moyennant le statut de régions administratives spéciales (RAS) qui leur permet de conserver leurs spécificités et leur autonomie pendant 50 ans. Cependant, le jour même de ces rétrocessions, l’Armée Populaire de Libération (APL) fait son entrée dans ces territoires, les marquant comme relevant du cercle ex-impérial, unifié. En 2019 et 2020, les manifestations de Hong Kong voient Pékin menacer d’employer l’armée en cas de demande du gouvernement local, le statut de RAS y subordonnant le recours à la force militaire et freinant ainsi une culture stratégique qui le prévoit, y compris pour le maintien de l’ordre – on se souvient de la répression de la place Tiananmen. C’est le principe de Deng Xiaoping, « un pays, deux systèmes », censé également valoir pour Taïwan.
Une seule Chine : la culture stratégique à l’épreuve de la question taïwanaise
La question taïwanaise est l’une des grandes problématiques stratégiques de la Chine contemporaine. Récupérée sur le Japon en 1945, Taïwan est gagnée à la fin de la guerre civile par le KMT, défait sur le continent, qui prend Taipei pour capitale provisoire. Taïwan est, aujourd’hui, le seul vestige du régime nationaliste, et son gouvernement se revendique toujours « République de Chine », ne reconnaissant pas la RPC, alors que cette dernière considère l’île de Taïwan comme sienne. La « politique d’une seule Chine », selon laquelle le continent comme l’archipel taïwanais font partie d’un même pays, fait paradoxalement consensus des deux côtés du détroit, mais les deux régimes divergent évidemment quant à savoir qui doit gouverner cette Chine.
Comment dès lors réaliser l’unité ? « La meilleure politique, c’est de prendre l’État intact », disait Sun Tzu : il serait coûteux et hasardeux pour les deux régimes rivaux d’en venir aux mains alors que chacun vise à l’unité chinoise. D’abord, il faut « s’attaquer à la stratégie de l’ennemi » puis « lui faire rompre ses alliances » . En effet, la RPC s’impose rapidement comme une puissance géopolitiquement incomparable à sa rivale, et s’adonne à un jeu performatif quant au principe d’une seule Chine, en posant comme prérequis à l’ouverture de relations bilatérales avec tout pays tiers la reconnaissance par celui-ci de la RPC comme seul gouvernement de la Chine. En 1971, c’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui la reconnaît comme telle, l’amenant à remplacer le régime nationaliste au Conseil de sécurité. La visite en 1972 du président américain Richard Nixon représente une victoire diplomatique et stratégique. Sept ans plus tard, les États-Unis reconnaissent à leur tour le régime, tout en promulguant le Taiwan Relations Act qui les engage à « garantir la sécurité de l’île, son peuple, son système économique et social ». Ils rappellent ainsi à Pékin que, s’il est reconnu comme gouvernement légal de la Chine, cela ne saurait pour autant constituer un blanc-seing à une invasion. La RPC n’est pas pleinement parvenue à ses fins diplomatiquement, aussi se livre-t-elle à des dépenses militaires et à des démonstrations de force. Qu’elle prévoie ou non d’attaquer Taïwan, elle sait que baisser la garde ferait courir le risque d’une déclaration d’indépendance, cas dans lequel l’île serait envahie en vertu de la loi anti-sécession de 2005.
Ces ultimatums de part et d’autre semblent empêcher tout recours à la force et voir se pérenniser un Taïwan indépendant de facto à défaut de l’être de jure, mais ce n’est pas là un véritable statu quo : d’un commun accord, les liens entre les deux rives sont de plus en plus étroits, la circulation de capitaux et de touristes entre continent et archipel allant croissant. Les économies gagnent en intégration, favorisant une possible unification future selon le principe « un pays, deux systèmes » respectueux de leurs différences. La RPC dilue progressivement sa rivale en elle, lui tendant un nœud coulant à long terme. En négociant avec le KMT même lorsque celui-ci est dans l’opposition, elle joue des clivages politiques taïwanais. Si, selon Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, la question taïwanaise semble montrer que la politique est, pour la Chine, la continuation de la guerre par d’autres moyens.
À lire également
La guerre pour Taïwan ? Précédents historiques et risques militaires
Un développement pacifique ?
La Chine semble toujours fidèle au principe de non-ingérence dans les affaires d’un pays situé hors du monde chinois , lequel entre en adéquation avec le caractère désormais illégal de l’emploi de la force dans les relations internationales. Dans ce contexte, la culture stratégique chinoise connaît aujourd’hui pour déclinaison le concept de « développement pacifique », élaboré vers 2005 au sein du réseau d’instituts de recherche et de think tanks qui inspirent au Parti communiste chinois (PCC) sa stratégie étrangère, se référant aux théories européennes et américaines des relations internationales . Cette approche prévaut à la recherche « d’une situation qui soit la plus favorable possible à ses intérêts économiques et stratégiques » .
En 2013, dénonçant la présence américaine encore importante dans la région indo-pacifique, Xi Jinping a proposé aux pays de la région des « principes de base pour la stratégie du bon voisinage » : le développement de relations d’amitié, la recherche de la sécurité et d’une prospérité commune, des relations gagnant-gagnant et non exclusives. Les pays d’Asie seraient liés par une « communauté de destin » sur le plan de leurs intérêts respectifs . De fait, l’intégration de leurs économies respectives est manifeste – surtout en faveur de la Chine. Dans le même temps, l’Organisation de Coopération de Shanghai, créée en 2001, permet à celle-ci de renforcer ses relations avec ses voisins, face à un OTAN présent en Asie centrale . S’y lisent des velléités chinoises non d’expansionnisme, terme employé par certains penseurs américains, mais de sécurisation des frontières . C’est un « jeu des alliances dangereux » que celui de la Chine, qui apporte une aide économique et militaire à un Pakistan avec qui elle partage une certaine animosité pour l’Inde, entretenant de la sorte un « triangle nucléaire » entre les trois puissances . L’APL ne joue d’ailleurs pas un moindre rôle dans les équilibres géopolitiques régionaux, comme en témoigne la stratégie du « collier de perles », consistant en l’établissement de bases navales en mer de Chine du Sud et dans l’océan Indien. Situées pour certaines sur les territoires d’autres pays et dans des zones disputées, elles constituent des relais chinois dans l’ensemble de la région. En 2017 ouvre, pour la première fois, une base militaire terrestre hors de Chine, à Djibouti. La Chine s’établit au-delà des mers, menaçant des États voisins qui seraient mal avisés de s’en prendre à elle. Il s’agit de parvenir à une hégémonie régionale dont la manifestation est pour partie d’ordre militaire. Le dixième des Trente-six stratagèmes, traité chinois du Moyen Âge redécouvert au XXe siècle, recommande de « dissimuler une épée dans un sourire » . La culture stratégique chinoise, qui promeut non seulement la diplomatie, mais une forme de double jeu à travers celle-ci, trouve aujourd’hui, dans la géopolitique de l’Indo-Pacifique, un terrain favorable à son expression.
Par-delà la guerre, aux confins du monde
La Chine est en première ligne de l’anticipation de la guerre future. Sa culture stratégique a connu un important renouvellement intellectuel peu après la guerre du Golfe, avec la publication par les colonels Qiao Liang et Wang Xiangsui de La guerre hors limites. Les officiers de l’APL y prennent acte du fait que, désormais, « l’humanité confère à tout espace le sens d’un champ de bataille », qui est désormais « partout ». La guerre nouvelle se caractérisera par un brouillage croissant de ses frontières avec la non-guerre, elle sera « une chose que nous n’avons jamais considérée comme guerre », mobilisant des moyens civils préexistants dans les domaines cyber, financier ou commercial, aux mains d’un « combattant numérisé » . Sans forme claire, la guerre serait désormais « hors limites », et c’est un « nouvel art de la guerre » – on notera la référence à Sun Tzu –, englobant tous ces domaines, qu’il faudrait maîtriser pour l’emporter. Il faut une cohérence, un emploi combiné réfléchi de ces moyens tenant à une « volonté unique », disent-ils, employant les mots de Yu Fei, général du XIIe siècle . Ainsi est actualisée une culture stratégique qui ne promeut l’usage des armes que si les approches non militaires se sont montrées inefficaces, et recommande l’emploi combiné de la « force ordinaire » (Cheng) et de la « force extraordinaire » (Ch’i). La force n’est plus, désormais, qu’un fragment, un aspect parmi d’autres de la guerre.
L’État chinois l’a bien compris, n’ayant de cesse d’investir dans les secteurs destinés à être au cœur de la guerre à venir, en premier lieu le domaine spatial. En 2007, il a montré, par la destruction avec un tir de missile antisatellite de l’un de ses propres engins, situé à 850 km , ses capacités de frappe dans l’espace, qu’elle investit et militarise au point d’y concurrencer les États-Unis : il y a lancé 260 tonnes pendant la décennie 2010-2020 . Depuis 2015, la force de soutien stratégique, composante nouvelle de l’APL, est chargée de l’espace, ainsi que du domaine cyber. En innovant sur le plan de la pensée comme sur celui du progrès technologique et scientifique, la Chine s’impose comme une puissance de premier plan en vue des hostilités, militaires ou non, à venir.
De fait, depuis plusieurs décennies, la pensée stratégique chinoise a aussi investi le champ de l’économie et du commerce, qui sont désormais un moyen privilégié d’expansion. On connaît les succès de la politique économique et commerciale menée par la RPC depuis les années 1970. En 2013 a été dévoilé le projet One Belt One Road (OBOR), devenu Belt and Road Initiative (BRI), qui vise au développement des échanges internes au continent eurasiatique à travers un « corridor économique » reliant la Chine à l’Europe de l’Ouest via l’Asie centrale et le Proche-Orient, moyennant de grands projets d’infrastructures. Cette « nouvelle route de la soie », ainsi dénommée en référence à un temps glorieux pour la Chine, concrétise la « Grande stratégie nationale » définie par le général Liu Yazhou, qui appelait en 2001 à « avancer vers l’ouest » au moyen d’un « pont terrestre entre Europe et Asie » afin de neutraliser l’encerclement américain de la Chine . Cette réflexion, ancrée dans le XXIe siècle, ne s’inscrit pas moins dans la tradition d’une stratégie qui préfère le contournement à l’affrontement frontal, en faisant emprunter aux biens et services des routes non contrôlées par les États-Unis. En sus d’intérêts commerciaux, il s’agit en effet pour la Chine de s’affirmer comme une puissance indépendante, à la tête d’un ordre international alternatif à celui que mènent les États-Unis . Tous les États concernés n’y aspirent pas pour autant, y voyant pour certains un moyen pour la Chine de servir ses seuls intérêts , n’ignorant pas l’art de l’ambigüité et de la dissimulation qui est au cœur de sa culture stratégique. À la Chine de paraître sympathique auprès de ces derniers : c’est ce à quoi vise la mise en valeur par le PCC, depuis 2007, du soft power chinois, avec le développement, d’abord en Asie du Sud-Est, des instituts Confucius et échanges avec des centres universitaires et culturels. En 2008, le pays accueille les Jeux olympiques et l’exposition universelle, dans la lignée de la diplomatie du ping-pong qui a contribué à son rapprochement avec les États-Unis. La Chine, qui sait que le soft power a fait défaut à l’URSS, a compris l’intérêt de ce procédé qui, non violent, ne va pas à l’encontre de sa tradition stratégique.
La Chine veut-elle la guerre ? Rien n’est moins sûr. La culture stratégique chinoise promeut le détournement plutôt que l’affrontement, elle vise à parvenir à ses objectifs sans recourir à la force. Cette pensée trouve aujourd’hui une expression concrète dans les visées de la République Populaire de Chine sur sa région, visées d’unité et d’hégémonie, mais non de conquête. Peut-être n’accuserait-elle pas le coup dans une guerre frontale, conventionnelle, contre les États-Unis : de fait, ses buts stratégiques ne sont pas ceux-là. Face à une puissance américaine qui consacre énormément de moyens à des guerres à l’étranger sans nécessairement arriver à ses fins, la Chine peut marquer des points en contestant l’ordre international. C’est autant, sinon plus, pour cette stratégie de long terme qui est la sienne que pour sa force brute qu’on aurait tort de la sous-estimer.