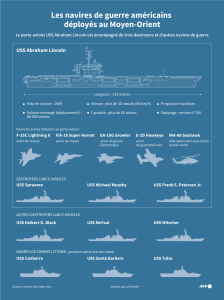La rencontre Trump Poutine à Anchorage signe la manifestation de la nouvelle Guerre froide. Dans la scénographie, le choix des symboles et l’effacement des Européens, tout rappelle les années de Brejnev. Mais nouvelle Guerre froide ne signifie pas retour à l’ordre ancien. Analyse de Jean-Robert Raviot
Fin 2016, je publiais avec plusieurs collègues un livre intitulé Russie : vers une nouvelle guerre froide ? Il est vraiment temps d’enlever le point d’interrogation ! La nouvelle guerre froide : nous y sommes. Ce sommet vient de le montrer de façon emblématique.
Hier, à Anchorage, on a pu constater l’omniprésence des éléments dramaturgiques et des didascalies de la guerre froide – l’ancienne – telle que chorégraphiée par Hollywood. Des limousines noires glissaient tels des monstres marins vers une austère base militaire, sous les cieux mats et blancs de la fin de l’été arctique, emportant les créatures présidentielles vers des décors dont on imagine qu’ils sont dignes du bunker du Docteur Folamour de Kubrick.
Dans cette scénographie, Vladimir Poutine était comme un poisson dans l’eau. Il joue parfaitement son rôle d’espion qui venait du froid, ménageant son entrée en scène – qui débute avec une descente assez peu solennelle de l’avion présidentiel, dévalant l’escalier d’une manière comme toujours un peu pressée, comme s’il descendait les escalators du métro de Moscou en doublant par la gauche – стойте справа, проходите слева comme le dit la chanson – avant de se fondre immédiatement dans le décor. Une fois campé sur le tapis rouge déployé sur le tarmac, le président russe esquive les hugs et autres tentatives de tapes dans le dos que Trump essaie d’imposer pour le soumettre à ses codes à lui… Que dire, côté Trump, de l’orchestration de l’épisode des B2 qui survolent la piste au moment même de la première poignée de mains ? Démonstration de force réussie ou mise en scène hollywoodienne qui dévoile une fois de plus la nature clownesque de la présidence américaine ? On se serait cru dans une parodie. On pense immédiatement aux premières scènes de Mars Attacks…

Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump pose on a podium on the tarmac Sergey Bobylev / Sputnik//SPUTNIK_11290153/Credit:Sergey Bobylev/SPUTNIK/SIPA/2508161230
Donald Trump, lui, en revanche, ne collait pas trop avec la scéno. L’oligarque américain n’entre pas très bien dans le décor. Il apparaît tendu et étriqué. Cliché pour cliché, on le verrait plus à son aise sur un yacht au large des Bermudes, entouré de créatures, un verre à la main, dans un grand bar un peu clinquant où l’on entendrait le bruit des machines à sous… Et pourquoi ne pas avoir organisé ce sommet sur un yacht, dans les eaux internationales ? Poutine n’aurait jamais accepté. En 1990, le sommet de Malte s’était déroulé sur un yacht. Ça ne s’était pas trop bien passé pour Gorbatchev. Sur le moment, pourtant, il pensait avoir obtenu la garantie que l’OTAN ne s’étendrait jamais vers l’Est (« Not one inch… »), en échange de son acceptation d’une Allemagne réunifiée et membre de l’Alliance atlantique. On connaît la suite…
Anchorage 2025 marque donc une nouvelle étape de la nouvelle guerre froide, commencée quelque part entre le discours de Munich de 2007 et l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 : cette fois-ci, la Russie qui a pris le contrôle des codes. Trump l’a-t-il compris ? Pas sûr. Il est clair que ce sommet a été marqué par une maîtrise russe de toute la signalétique. J’aborde ici brièvement deux points caractéristiques de cette nouvelle guerre froide.
L’éternel reset de 1945
Les images d’Anchorage nous ramènent aux bons vieux temps des sommets Est-Ouest dans les grisâtres Genève ou Helsinki, à cet ordre international régi par les « deux grands » de l’ancien monde bipolaire. La nouvelle guerre froide n’a plus rien de bipolaire, mais elle induit tout de même un point essentiel : pas de refonte d’un ordre international possible sans la Russie. Voici l’alpha et l’oméga de la politique extérieure russe. Anchorage 2025 n’est donc pas un nouveau Yalta, mais une énième séquence qui rejoue encore et toujours la partition de la Victoire (soviétique) de 1945, dont elle est l’aggiornamento, le dernier avatar. Pour le président russe, cette présence physique en Alaska, sur le sol américain, est une revanche sur son absence aux célébrations du débarquement de Normandie en 2024 et sur l’absence des Occidentaux aux festivités du quatre-vingtième anniversaire de 1945 sur la Place Rouge. Le narratif de la seconde guerre mondiale continue d’alimenter les images mentales et discursives de la nouvelle guerre froide, comme il alimentait celles de la guerre froide. La Russie garde l’avantage et capitalise son image du grand vainqueur.
La discussion américano-russe a porté sur les modalités de la sortie du conflit, mais pas sur les conditions précises de celle-ci. Comme il était prévisible, aucun cessez-le-feu n’a été décidé. En revanche, un accord semble s’être esquissé sur la nécessité de mettre fin à la guerre à des conditions acceptables pour chacun des deux adversaires les plus nucléarisés de la nouvelle guerre froide, à charge pour les Ukrainiens et les Européens de s’y soumettre, ou de subir les conséquences d’une poursuite de la guerre sans soutien américain. Trump n’a pas obtenu le cessez-le-feu qu’il se vantait de pouvoir obtenir en vingt-quatre heures avant sa prise de fonction. Poutine n’a pas cédé sur une de ses exigences depuis presque vingt ans : pas question que l’Ukraine rejoigne l’OTAN. Anchorage : avantage Poutine, donc.
Un ordre international de grandes puissances sans voisinage hostile
Je ne sais pas comment le choix de l’Alaska a été fait, mais il semble clair qu’il donnait d’emblée et avant toute négociation un avantage symbolique éclatant à Vladimir Poutine. La localisation même de ce sommet sert la rhétorique officielle russe. Quelques explications.
La nouvelle guerre froide imite la guerre froide, mais elle ne la reproduit pas. Anchorage est assez maussade, mais ce n’est ni Genève, ni Helsinki. Le rideau de fer n’existe plus et le partage de l’Europe n’est plus à l’ordre du jour. L’Europe elle-même, d’ailleurs, n’est plus trop à l’ordre du jour, ayant quitté la scène des grands acteurs politique de l’Histoire. Sa vassalité politico-stratégique et, de plus en plus, sa soumission économique et énergétique à l’égard des Etats-Unis semble être tenue pour un fait. Le président russe et le président américain l’ont d’ailleurs dit ouvertement et sans trop de précaution oratoire, chacun à sa manière, au cours de ces derniers mois.
Anchorage est la capitale d’un état américain qui a ceci de particulier qu’il fut le territoire de l’Empire de Russie pendant une petite centaine d’années, entre la fin du XVIIIe siècle et 1867, date à laquelle ce territoire assez faiblement colonisé par les Russes – il est établi que la population russe de cette « Amérique russe » a atteint son maximum vers 1825, avec environ… 700 habitants ! – a été vendu aux Etats-Unis pour 7,2 millions de dollars de l’époque. La Russie entretenait déjà d’excellentes relations d’affaires avec les Etats-Unis au sein de la Russian-American Company, fondée par Paul Ier en 1799. Cette entente russo-américaine avait permis de repousser les velléités des concurrents britanniques d’investir un territoire très riche en or et en minerais. Pendant tout le dix-neuvième siècle, la Russie – faute d’avoir les moyens de le contrôler durablement – s’ingénie à attiser les rivalités américano-britanniques autour de ce territoire, par le jeu des concessions en matière de droits d’exploitation des ressources… Outre la mainmise sur les ressources naturelles, l’acquisition de l’Alaska permet aux Etats-Unis de poursuivre l’expansion territoriale de la Ruée vers l’or, donnant à Washington un accès direct au littoral arctique, dominé jusqu’ici par la Russie et la Grande-Bretagne. Le Canada est alors un dominion britannique et la maîtrise de la côte Nord-Pacifique de l’Amérique, encore peu développée, est un enjeu stratégique majeur. Le rattachement de l’Alaska aux Etats-Unis permet à ces derniers de mieux circonscrire la puissance britannique, de sécuriser leur voisinage du Nord-Ouest et de réaffirmer leur volonté de domination de tout l’hémisphère occidental (à savoir la totalité du continent américain), exprimée dès 1823 dans la célèbre doctrine Monroe, que l’on peut résumer ainsi : les Etats-Unis ne tolèrent aucune présence européenne sur le continent américain.
Quel symbole que d’opter pour un territoire dont l’histoire même symbolise la vision politique russe portée par Vladimir Poutine, qui constitue une sorte de « doctrine Monroe » à la russe, que l’on peut résumer ainsi : les grandes puissances sont légitimes à faire valoir, dans leur voisinage, un droit à la sécurité qui exclut le déploiement militaire et l’ingérence politique d’autres grandes puissances ; que les puissances moyennes et « petits Etats » voisins s’en accommodent et ajustent leurs politiques à la réalité géopolitique des rapports de force!… Dans la vision russe, assez brutalement réaliste, un nouvel ordre international doit être reconstruit par un dialogue et des négociations entre « grands », un nouvel ordre international fondé non plus sur des règles dictées imposées par le plus puissant des « grands », comme par les Etats-Unis après leur victoire sur l’URSS dans la guerre froide, mais sur un jeu d’équilibre de grandes puissances régionales qui s’abstiennent d’ingérence mutuelle dans leurs voisinages respectifs.
Trump avait-il conscience, en proposant l’Alaska, de servir aussi bien les desseins de la diplomatie russe ? Il a voulu se poser « en voisin » afin de mieux engager le dialogue. En mesurait-il toutes les implications ?